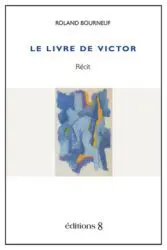Extrait d’un récit à paraître aux Éditions 8 en mai 2024
Il me faudrait mettre un terme définitif au mythe de la maison natale que je traîne depuis si longtemps. Le petit pavillon à demi caché dans un bouquet d’érables plein de recoins et de mystère n’a jamais existé que dans mon imagination. Peut-être aussi dans celle de mes deux frères aînés, je ne sais, nous n’en avons jamais parlé dans les quelques années où nous avons vécu ensemble comme adolescents.
Quand mon père est parti à la guerre vers ce lieu vague qu’on appelait « front de l’Est », nous sommes restés sans ressources. Les autorités avaient promis une aide aux épouses des prisonniers ou plutôt aux veuves de guerre, nous n’en avons jamais vu la couleur. Mon père n’est pas revenu. Je ne sais trop comment la mère allait se débrouiller pour nous faire vivre tous les quatre. Des travaux de ménage, d’aide aux personnes âgées, peut-être, mais elle était vaillante et nous n’avons pas souffert de la faim. Nous avons déménagé quatre ou cinq fois dans des logis délabrés au fond d’impasses puantes où l’on voyait à peine de ciel, dans des banlieues minables où s’entassaient les plus pauvres de ceux qu’on nommait « les réfugiés » et des quantités de gamins. Rien qui pût offrir l’illusion du cocon familial. Mes frères bricolaient de leur côté, réparant de vieilles bicyclettes, fabriquant des semelles avec des morceaux de pneus et quoi encore. Moi j’étais trop jeune pour être utile et rapporter un peu d’argent.
Ce furent mes années noires que je revois aujourd’hui tout en sachant comment la perspective du passé peut changer plusieurs fois, selon le présent où nous sommes. L’ambiance de la famille d’abord, si l’on admet que nous en faisions une, la mère toujours en train de trimer et se demandant si nous aurions assez d’argent pour la semaine, les frères envolés ou absents qui n’étaient d’aucun support. J’allais à l’école bien sûr, pour y bâiller et dormir. Aussi pour avoir un repas chaud. D’une année à l’autre, je retrouvais ma place parmi les cancres au fond de la classe. La mère reçut des avertissements concernant mes résultats. Que pouvait-elle répondre ? Que je devais travailler le plus vite possible pour l’aider. Mon seul plaisir était de jouer au foot sur le terrain de l’école avec d’autres galopins de mon âge. Je n’étais pas maladroit et mon gabarit précoce faisait de moi un arrière difficile à contourner. Le prof de gym chargé de « l’éducation physique », matière scolaire unanimement méprisée comme le dessin ou le chant, fut le seul à prendre ma défense, bien en vain, quand le directeur me montra la porte de l’établissement.
Alors ? Trouver du travail, l’urgence donc. Je me présentai à une épicerie où je fus engagé pour coltiner des paquets de journaux et des cageots de fruits et de légumes. Après quelques semaines, je montai de grade – mais non de salaire – quand je fus chargé des livraisons chez le client. À l’école, envers et contre tout, j’avais appris à lire, à écrire et un peu d’arithmétique. Il me fallait souvent épeler mon nom, « Tixaire » avec a-i-r-e à la fin, comme « solitaire ». Et pas bavard. À qui aurais-je pu parler ? La mère ressassait ses griefs contre l’un ou l’autre de l’entourage et le patron était toujours de mauvais poil.
Je peux bien le dire, mon enfance a été triste comme l’époque toujours sous l’ombre d’un nuage gris, ou noir selon les années, qui nous couvrait tous. L’absence de mon père ou plutôt sa disparition s’est mêlée à celle d’une vraie maison familiale, une absence se confondant dans ma mémoire avec l’autre.
La guerre allait vers sa fin, on le sentait, on en parlait. Ernest notre aîné, devenu majeur, décida alors de s’engager avec les compagnons de la Libération, peut-être pour avoir lui aussi un peu de gloire. Il faisait en uniforme de brèves apparitions à la maison avant de repartir pour, disait-il, participer aux derniers combats. Quant à Jean, il disparaissait lui aussi quelques jours et quand il revenait, il répondait à peine à nos questions. Je remarquais qu’il portait un beau chapeau et des souliers vernis. Il avait les poches pleines de cigarettes et de flacons d’alcool. Il déposait sur la table quelques billets et disparaissait à nouveau jusqu’à ne plus revenir.
Et un jour la mère est morte, comme cela, d’un coup. On l’a rapportée à la maison dans une charrette à bras. Il y eut le cimetière. Un prêtre dit une prière. Deux ou trois personnes vinrent me serrer la main et me taper sur l’épaule. Je restais seul devant la fosse où l’on avait descendu le cercueil. Pauvre mère, elle avait fait son possible pour nous protéger dans toute sa vie sans horizon.