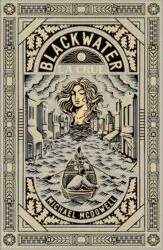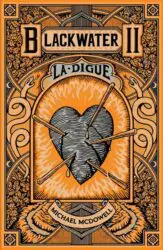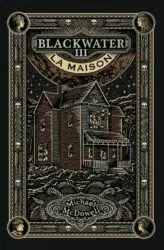Emporté par le sida à la veille de la cinquantaine, Michael McDowell (1950-1999) est reconnu aux États-Unis comme un maître de la littérature d’horreur. Auteur de romans gothiques méridionaux tels que Les brumes de Babylone (1980) et Cauchemars de sable (1981), il a aussi scénarisé Beetlejuice(1988) de Tim Burton et coscénarisé L’étrange Noël de Monsieur Jack (1993) d’Henri Selick. La saga en six volumes1 intitulée Blackwater, qui paraît pour la première fois en français, relate le destin des Caskey, riche famille de propriétaires d’une scierie, dans une petite ville de l’Alabama, entre 1919 et 1968.
Les six romans ont initialement paru aux États-Unis chez Avon Books en 1983, à raison d’un tome par mois à partir de janvier, conformément au vœu de l’auteur, qui souhaitait imiter la périodicité des feuilletons. Les éditions Alto, associées à Monsieur Toussaint Louverture pour la traduction française, y sont allées au rythme de deux volumes par mois entre mai et juillet 2022. Avec ses somptueuses couvertures embossées, conçues par l’illustrateur espagnol Pedro Oyarbide, cette série propose une expérience de lecture exceptionnelle.
Elinor sauvée des eaux
Tout commence à Pâques de l’année 1919. Perdido, une petite ville du sud de l’Alabama, se retrouve submergée par l’eau noire de la rivière sortie de son lit. La crue est si forte que les résidents sont chassés de chez eux et que la région est transformée en marais. En parcourant les lieux du sinistre à bord d’un canot, Oscar Caskey, héritier d’une riche famille de propriétaires, découvre Elinor Dammert, une étrange jeune femme prisonnière d’une chambre d’hôtel depuis quatre jours. Originaire de Fayette, au nord de l’État, la rescapée, qui arbore une flamboyante chevelure rousse, prétend être venue à Perdido dans l’espoir de s’y faire engager comme institutrice. Or, sa valise contenant son diplôme et ses lettres de recommandation a été avalée par les flots. Il faut donc la croire sur parole. C’est ce que fait James, l’oncle d’Oscar, en l’accueillant chez lui, pour le plus grand plaisir de sa fille Grace. Mais Mary-Love, la mère d’Oscar, voue à la nouvelle venue une antipathie spontanée et tenace, seulement surpassée par la haine que lui inspire sa belle-sœur Genevieve, l’épouse de James, le frère de son défunt mari Randolph.
Randolph Caskey est mort, son frère James est « marqué du fameux sceau de la féminité2 » et le jeune Oscar fait preuve d’une étonnante passivité, ratant par exemple plusieurs occasions de se révolter contre sa despotique mère. Si d’autres personnages masculins apparaissent au cours de la série, ils font relativement pâle figure en comparaison de leurs vis-à-vis féminins. « À Perdido, les femmes se moquaient toujours des hommes », explique le narrateur ; « c’étaient en réalité les femmes qui dirigeaient la ville3 ». La plus fascinante – parce qu’on aime la détester – reste assurément la matriarche, Mary-Love Caskey. Personnage autoritaire et manipulateur, elle détient une grande partie de la fortune familiale mais refuse de donner de l’argent à ses enfants, Oscar et Elvennia, afin de conserver son emprise sur eux. Elvennia, dite Sister, semble longtemps incapable de sortir de son giron mais, dans Blackwater, il ne faut présumer de rien. Les personnages évoluent tous de façon importante et McDowell réserve de nombreuses surprises à ses lecteurs. Autre personnage fascinant, mais pour de tout autres raisons : celui d’Elinor Dammert. Ses motifs restant connus d’elle seule, elle semble s’être servie de la crue de 1919 pour faire son entrée dans la famille Caskey. Elle devient bientôt la femme d’Oscar, son « sauveur » – les guillemets sont de mise puisque la jeune femme n’avait manifestement pas besoin d’être secourue : elle possède la capacité mystérieuse de nager là où n’importe qui d’autre se noierait. L’une de ses premières initiatives chez les Caskey consiste à planter des chênes d’eau qui poussent anormalement vite. On comprend vite que ce personnage a partie liée avec des phénomènes surnaturels.
Une saga familiale d’horreur
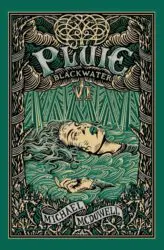
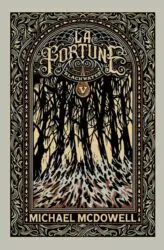
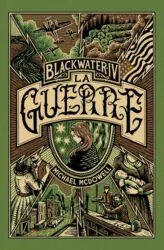 L’incorporation d’éléments fantastiques, voire terrifiants, à une trépidante saga familiale procure donc un plaisir de lecture de double nature et contribue à faire de Blackwater une œuvre complètement à part. On suit l’existence mouvementée d’une famille sur quatre générations, avec des événements historiques en arrière-plan (la crise économique de 1929, la guerre, la mort de Roosevelt, l’assassinat du président Kennedy, le mouvement des droits civiques, etc.). L’opposition épique entre une belle-mère (Mary-Love) et sa bru (Elinor) constitue l’un des principaux centres nerveux de l’intrigue, mais il serait réducteur de ne retenir que l’animosité qu’éprouvent les deux femmes l’une pour l’autre ; disons plutôt que chacune veille à sa façon au bien-être des Caskey. Autour d’elles, McDowell fait évoluer plusieurs personnages féminins forts : l’athlétique Grace (la fille de James), les sœurs rivales Miriam et Frances (les filles d’Oscar et Elinor), la résiliente Queenie Strickland (belle-sœur de James) et sa fille Lucille, pour n’en citer que quelques-unes. McDowell ne traite pas le thème de la famille de façon conventionnelle. Ainsi, un fait récurrent (et déconcertant) chez les Caskey consiste à s’approprier l’enfant d’un autre. Par exemple, Miriam est élevée par sa grand-mère (qui l’a troquée contre une maison), alors que Danjo (fils de Queenie né d’un viol) est adopté par James (qui l’échange à son violeur de père contre une voiture neuve). Mais les bouleversements au sein du clan Caskey ne forment qu’un versant de Blackwater. L’autre semble tout droit sorti des univers de H. P. Lovecraft et de Stephen King. De singuliers phénomènes se produisent à intervalles réguliers. Ce sont tantôt des morts violentes (par noyade, démembrement ou dévoration) et tantôt des événements inexpliqués (apparitions, maison hantée, monstres marins). Une œuvre en six volumes peut paraître monumentale, mais McDowell suscite si adroitement l’adhésion du lecteur que l’on poursuivrait volontiers la lecture pendant six autres tomes.
L’incorporation d’éléments fantastiques, voire terrifiants, à une trépidante saga familiale procure donc un plaisir de lecture de double nature et contribue à faire de Blackwater une œuvre complètement à part. On suit l’existence mouvementée d’une famille sur quatre générations, avec des événements historiques en arrière-plan (la crise économique de 1929, la guerre, la mort de Roosevelt, l’assassinat du président Kennedy, le mouvement des droits civiques, etc.). L’opposition épique entre une belle-mère (Mary-Love) et sa bru (Elinor) constitue l’un des principaux centres nerveux de l’intrigue, mais il serait réducteur de ne retenir que l’animosité qu’éprouvent les deux femmes l’une pour l’autre ; disons plutôt que chacune veille à sa façon au bien-être des Caskey. Autour d’elles, McDowell fait évoluer plusieurs personnages féminins forts : l’athlétique Grace (la fille de James), les sœurs rivales Miriam et Frances (les filles d’Oscar et Elinor), la résiliente Queenie Strickland (belle-sœur de James) et sa fille Lucille, pour n’en citer que quelques-unes. McDowell ne traite pas le thème de la famille de façon conventionnelle. Ainsi, un fait récurrent (et déconcertant) chez les Caskey consiste à s’approprier l’enfant d’un autre. Par exemple, Miriam est élevée par sa grand-mère (qui l’a troquée contre une maison), alors que Danjo (fils de Queenie né d’un viol) est adopté par James (qui l’échange à son violeur de père contre une voiture neuve). Mais les bouleversements au sein du clan Caskey ne forment qu’un versant de Blackwater. L’autre semble tout droit sorti des univers de H. P. Lovecraft et de Stephen King. De singuliers phénomènes se produisent à intervalles réguliers. Ce sont tantôt des morts violentes (par noyade, démembrement ou dévoration) et tantôt des événements inexpliqués (apparitions, maison hantée, monstres marins). Une œuvre en six volumes peut paraître monumentale, mais McDowell suscite si adroitement l’adhésion du lecteur que l’on poursuivrait volontiers la lecture pendant six autres tomes.
1. Les six volumes ont respectivement pour titre La crue, La digue, La maison, La guerre, La fortune et Pluie. Ils ont été traduits de l’anglais (États-Unis) par Yoko Lacour avec la participation d’Hélène Charrier.
2. La digue, p. 70.
3. La crue, p. 37.
EXTRAITS
Là où se trouvait l’étroit affluent, le courant était peu profond, clair et rapide, contrairement aux eaux de la Blackwater et de la Perdido, abyssales, sombres et puissantes. Il sinuait à travers la forêt, suivant un tracé qui semblait changer chaque année. Déchirant le tapis d’aiguilles pour mettre à nu la couche de terre meuble qui se trouvait dessous, il creusait des cavités dans la roche et régurgitait sable et cailloux en minuscules îlots.
La crue, p. 48.
Les enfants de Perdido ne se faisaient pas mordre par des chiens enragés et ne tombaient pas au fond de puits asséchés, ils ne succombaient pas à un tragique accident en « jouant » au barbier ou en se déchargeant un pistolet dans le crâne. À Perdido, les enfants malchanceux se noyaient dans la rivière, un point c’est tout. Si on mettait de côté la confluence, les membres les plus jeunes de la communauté menaient une existence paisible. Seulement, la rivière réclamait régulièrement son dû.
La digue, p. 202.
Frances dévora ses bras. Au cours de ce festin, Travis mourut. Lorsque sa faim fut rassasiée, Frances porta le cadavre jusqu’au nid d’alligators, sur la berge qui jouxtait le pâturage. Attirées par l’odeur du sang, les bêtes étaient là pour l’accueillir.
La guerre, p. 171.
Et puis, il y eut de nouveaux bruits. Quelque chose qu’elle n’avait encore jamais entendu semblait parfois secouer la maison. Les pendeloques en cristal du chandelier sur la table de la salle à manger se mettaient à carillonner, comme si quelqu’un s’était trouvé dans la pièce – pourtant fermée à clé –, à tourner en rond fébrilement quoique sans bruit autour de la table, la faisant vibrer de ses pas. Ou bien l’une des fenêtres qui donnaient sur la cour tremblait dans son montant, comme si quelqu’un arpentait furtivement le porche.
Pluie, p. 74.