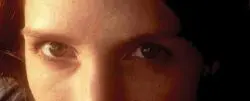Le livre que je n’ai jamais lu, The Blue Bird for Children, était sa création à elle, à Georgette Leblanc. Son oiseau bleu de la mémoire a réveillé la voix qui sommeillait en moi.
Le livre que je n’ai jamais lu, The Blue Bird for Children, était sa création à elle, à Georgette Leblanc. Son oiseau bleu de la mémoire a réveillé la voix qui sommeillait en moi.
À l’époque, impossible d’imaginer comment écrire, devenir auteure. Impossible d’imaginer vivre de sa plume ni de considérer que la création puisse être vocation. J’avais grandi dans un monde rural, merveilleusement complexe et riche. Fondé en 1768 par un groupe d’Acadiens revenus de la déportation de 1755, le petit village nommé Pointe-de-l’Église par les arrivants français et Chicaben par ses premiers habitants, les Mi’kmaqs, est l’un des 23 villages acadiens qui s’enfilent, tel un rosaire, le long du littoral du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Bordée de prusses taillés par le vent salé de la Baie Sainte-Marie, cette région est l’une des sept régions acadiennes de la Nouvelle-Écosse. C’est aussi celle qui, en 1890, s’est dotée d’un des deux premiers collèges classiques des provinces maritimes, aujourd’hui l’Université Sainte-Anne.
Selon Benedict Anderson, l’Acadie, comme le Canada, les États-Unis, la France et toutes les autres expressions nationales, est une « communauté imaginée ». Comme toutes les communautés imaginées, l’Acadie s’est créé un discours officiel pour raconter et remémorer les événements et les personnages importants. Ce discours officiel et écrit est un moteur identitaire important qui nourrit la communauté. Qui sont les auteurs de l’histoire de cette communauté imaginée ? Quels événements considèrent-ils comme importants ? Quels personnages deviennent des héros et selon quels critères ? Où sont les héroïnes ? Comment faire pour ne pas perdre de Mémoire ces expériences culturelles qui ne correspondent pas aux schémas privilégiés ?
À la Baie Sainte-Marie, jusqu’au premier Congrès mondial acadien1, le discours oral et populaire a été évacué du discours textuel. C’est peut-être la raison pour laquelle, chez moi, on se méfie parfois des auteurs et des artistes. C’est peut-être la raison pour laquelle j’étais tellement méfiante envers moi-même. Comme écrire ? Comment choisir ? Quelle langue choisir ? Comment écrire sans me trahir et sans trahir ma famille ? Comment faire pour créer de façon authentique sans me laisser restreindre par le cadre ? En même temps, impossible de taire les voix, les personnages, les images et l’univers qui se tissaient et travaillaient en moi. Je brûlais d’une envie folle de les communiquer – de les partager. Or, malgré moi, j’écrivais. J’écrivais dans mes langues officielles sans oser toucher l’essentiel.
J’insiste un peu sur tout ça parce que je comprends, aujourd’hui, ce qui a contribué au choc électrique que j’ai eu en voyant son nom à elle – mon nom – pour la première fois sur la page. En fait, c’était comme si je participais, pour la première fois, au rituel de l’Écrit, du textuel. On a beau célébrer la noblesse de l’oralité, le temple du monde occidental demeure la bibliothèque. Comment y être, comment y participer, sans se travestir ?
Le jour où j’ai trouvé le nom de Georgette Leblanc dans le journal d’Anaïs Nin a été profondément marquant. Je ne sais plus où est ma copie de ce journal de Nin. Je n’ai pas non plus trop cherché à la retrouver – ayant lu et largement préféré son grand ami, Henry Miller. Depuis ce jour, j’ai perdu ces objets et leurs traces, mais le moment demeure incisif, inscrit dans ma mémoire corporelle et trahissant ce qu’on raconte sur la régénération des cellules. Ce moment-là, c’était comme si j’avais vu pour la première fois mon corps, ma sensualité, mon accent, ma famille, toutes les Baie Sainte-Marie, sur la page. Électrique. J’ai senti dans mon corps, pour la première fois de ma vie, le possible.
Quelques jours après ma « découverte » de Georgette Leblanc, j’ai reçu par la poste le livre que je n’ai jamais lu : The Blue Bird for Children, un des quelques livres qu’elle a écrits dans ses dernières années sur terre. Cet oiseau bleu de la mémoire (pour les enfants de l’Amérique) était le fruit d’un mariage puissant avec Maurice Maeterlinck, cet homme qu’elle était allée « conquérir » et avec qui elle signa plusieurs performances et créations. Georgette Leblanc, grande cantatrice des années 1920, darling de Jean Cocteau, diva qui fut l’Inhumaine de Marcel L’Herbier, m’est venue sans chanter, sans tout le corps de son âme. Elle m’est venue silencieuse et discrète, comme une nouvelle partition musicale. J’ai reçu son livre, comme si elle-même me l’avait envoyé. J’ai admiré sa charpente. J’ai osé l’ouvrir quelques secondes pour sentir le toucher du papier, le temps d’admirer les gravures et depuis, il ne m’a pas quittée. Je l’ai traîné partout comme une relique.
Grâce à ce livre, une porte s’est ouverte. J’ai commencé à croire. J’ai commencé à sentir le pouvoir – la force de se voir, de se reconnaître pour la première fois. C’est aussi grâce à Georgette Leblanc et à ce livre que j’ai rencontré tous ces autres hommes et femmes, ces guides qui allaient m’aider dans ma quête. C’est grâce à elle que j’ai connu les femmes qui tournaient autour de Gurdjieff, « The Ladies of the Rope », ces Margaret Anderson, Jane Heap. C’est grâce à Georgette Leblanc que je suis arrivée à connaître l’univers de Gertrude Stein et l’ampleur des Ballets russes, de la faune de Nijinski, de cette révolution qui est celle du modernisme – celle de rompre avec la tradition et ses cadres, de s’affranchir des schémas et des arcs narratifs prévisibles, pour exprimer l’expérience, la sensualité complexe du « je » sujet.
Je me permets, peut-être à tort, de raconter ces instants de narcissisme parce que je crois qu’ils sont nécessaires. Il faut arriver à se reconnaître et à s’aimer avant d’être en mesure d’aimer l’Autre et de se faire aimer par l’Autre. Il faut que l’individu se reconnaisse et s’aime pour être en mesure de participer dignement au collectif. Moi qui avais grandi « minoritaire » dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Moi qui avais compris très tôt l’importance et la valeur que peuvent représenter les cadres et la tradition pour des groupes qui veulent continuer d’exister. Quel cadeau important que de lire Anaïs Nin et Gertrude Stein. Chez la première, de lire quelqu’un tracer par le moyen du journal intime un des portraits les plus saillants de son époque. Et chez Stein, dans L’autobiographie d’Alice B. Toklas, de trouver sa vérité, son histoire personnelle dans la voix de l’Autre. Il ne suffit pas de se reconnaître, d’être réflexif. De ces femmes et de leurs œuvres, j’ai appris ce que je disais déjà : que le singulier peut être pluriel. Que le bris du cadre et de la tradition peut amener à une nouvelle communion entre l’individu et le collectif. Que l’esprit du « j’sons » (qui se dit toujours à la Baie Sainte-Marie) est de tous les temps. Quelque part, mes sœurs écrivaient en acadien.
J’ai traîné mon oiseau bleu avec moi au fil des ans, en étant profondément loin des cafés et de la lumière de la Belle Époque. Avec ce livre que je n’ai jamais lu, je traînais tous ces personnages et auteurs. J’emmenais Satie et Debussy. Je gardais l’idée qu’il n’était pas question de transcrire et de reproduire une langue et un monde. Que tout est mouvement. Tout est tension. Que le présent est un énorme cadeau rempli d’expériences. Qu’il est pluriel aussi ; des horizons glissant les uns par-dessus les autres que l’acte d’écriture fixe, telle une photo. The Blue Bird for Children était là pour m’encourager à aller vers l’univers que je sentais, que je voulais créer et communiquer au monde. Pour ce faire, il faudrait d’abord que j’arrive à écrire, en blanc et noir dans la langue de ma naissance, celle de mon corps aux accents de ma mère.
Sachant que ce Paris, cette bulle lumineuse qu’était Paris à la Belle Époque, n’est plus, j’ai traîné le livre comme un testament, comme un legs, comme une mémoire qu’il fallait à tout prix faire revivre. The Blue Bird for Children fut comme un pont jeté des vieux pays à l’Amérique par Georgette Leblanc. Pas question de répéter. Il faut revivre, révolutionner, écrire des réponses et non des adaptations, comme le proposait Grotowski. Notre génération se doit de répondre. De créer, d’écrire, de chanter et d’aimer profondément ancrés dans l’étrange et unique potentialité de nos instants fugitifs. Notre ville ne peut plus n’être que Paris, ne peut plus n’être qu’une ville. Ma ville est virtuelle. C’est Inmateria2. C’est le lieu de la Rencontre.
1. Tenu au Nouveau-Brunswick en 1994 [NDLR].
2. Compagnie de création et de recherche récemment fondée par Georgette LeBlanc et Eric Tribut [NDLR].
EXTRAIT
Alma était dans la cuisine. Faulait qu’elle raguerne la râpure pour les goules qu’alliont havrer. Il y avait trois sacs de farine à décharger, des petits à feeder. Elle se fermit même point les yeux quand ce que Pierrot larguit son cri. Elle était dans la cuisine. Parmi les corbeaux. Dans l’eau de mousse et la poussière des pissenlits. Elle était grande et solide astheure. Sa peau comme une neuve écorce tendre.
Alma, Perce-Neige, 2006, p. 112.