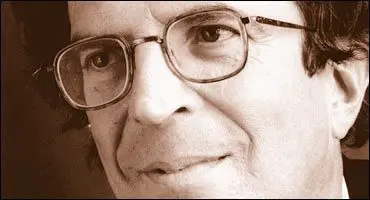Né en 1937 à Montréal, Yves Préfontaine est anthropologue de formation. Il fait paraître son premier recueil de poésie à 20 ans : Boréal. Et fait étonnant, six mois plus tard, il publie chez le même éditeur un recueil tout aussi fort, Les temples effondrés. À la fin de 1959, il se joint au comité de direction de la revue Liberté et en devient rédacteur en chef en 1961-1962, « en tandem » avec Hubert Aquin, aussi directeur à cette époque.
En 1960, Yves Préfontaine est l’un des membres fondateurs du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), le seul écrivain du groupe. Pendant plusieurs années, il anime pour la radio des émissions de jazz ainsi que de nombreuses séries portant entre autres sur les cultures amérindiennes, les problèmes de l’homme américain, les littératures antillaise et africaine d’expression française. En 1967, il publie Pays sans parole pour lequel il obtient le Prix France-Québec. D’autres recueils s’ajouteront et Préfontaine, malgré ses phases de silence, s’installera parmi les voix majeures en poésie québécoise.
Une voix dans le noir
L’obscurité jette une tout autre lumière, un éclairage neuf sur les êtres et les mots, une clarté insoupçonnée. J’éprouvais cet étrange sentiment un soir d’octobre 1989, au Festival de poésie de Trois-Rivières, alors qu’en coulisse j’écoutais Yves Préfontaine réciter un extrait de Nuaison, publié en 1981. La voix s’élevait dans le noir, grave et apaisante, et j’étais envoûtée par la musicalité des textes, l’euphonie, la beauté des sons et le propos tendrement excessif, ou excessivement tendre. Je comprenais alors à quel point Yves Préfontaine est davantage qu’un « poète du pays ». Parole tenue : poèmes 1954-1985, qui lui a valu le Prix Québec-Paris 1991, confirme nettement que cette étiquette collée à l’auteur ne révèle qu’un volet de son œuvre dont on oublie souvent l’aspect ontologique, très présent. Ce qu’écrit Préfontaine n’est pas que musique et son, mais révèle une quête de l’essence, de l’être. J’ai rencontré le poète, et, durant un long moment, il a parlé de son cheminement parfois pénible, troué de joie, d’angoisse, d’explosions et de silence. Il a évoqué ce vacarme et ce murmure pour atteindre l’être en expansion, le souffle primordial.
« La littérature alchimique m’a beaucoup fasciné quand j’avais entre 15 et 20 ans. Transmuer matière vile en matière précieuse m’intéressait sur le plan symbolique. L’alchimie symbolique n’était qu’une symbolique ; toutes ces descriptions d’étapes jusqu’à la pierre philosophale, c’était un cheminement mystique au fond. Ce désir de transformer le vil en précieux, qui serait la révélation de la vérité absolue, se retrouve dans toutes les grandes cultures. »
Yves Préfontaine s’interroge constamment sur les limites du langage. Dans l’« indice » de Débâcle, il écrit : « Qui donc s’attachera vraiment, en mobilisant et la ductilité et la brutalité du langage infirme qui nous est imparti, à nommer […] ». Ce constat de parole malade revient souvent. « Oui, parce que j’ai une exigence épouvantable à l’endroit du langage. Il s’agit d’un fantasme mais j’ai toujours rêvé d’une pangraphie, d’une graphie totale. C’est ça le poème total. C’est de pouvoir ou d’avoir pu, si on pouvait dans un poème immense ou court, contenir toute la réalité, les vérités, l’être en expansion. Parce que je perçois l’être uni. Le poème absolu, l’archipoème, ça c’est un rêve. Vraisemblablement, celui qui arriverait à écrire un poème absolu n’écrirait plus parce que tout serait dit et ce serait l’illumination totale, la connaissance absolue. Parvenu à l’état de béatitude, on n’écrit plus. C’est le silence. »
Le chaînon manquant
Parole tenue regroupe des corpus parallèles qui se croisent et s’entrecroisent. Même si cet ouvrage figure dans la collection « Rétrospectives » à l’Hexagone, il importe de souligner que plus du tiers de ce livre est composé d’inédits. Parmi ces inédits, on remarque des textes en prose ainsi que différents « indices » qui sont des textes fouillés, auto-explicatifs, de véritables phares sur l’œuvre, qui creusent sans être des essais. Et bien sûr, un recueil-clé : Les épousailles. « Les épousailles m’ont toujours causé un cauchemar et c’est le grand trou qu’il y a entre L’antre du poème et Pays sans parole. Il y a une courbe, un paroxysme dans Les épousailles, cette volonté d’exprimer l’espace, l’obsession de l’espace, l’obsession du territoire, l’obsession de la matière. La géographie devient une géographie de symboles qui sert à exprimer autre chose. J’éprouvais une résistance à publier Les épousailles. Quand je suis arrivé au bout de ce livre, j’ai failli craquer, j’ai craqué. Il m’était arrivé de craquer à 23 ans : j’étais rendu au bout d’un trip, d’un cycle et j’ai eu une période extrêmement dure, extrêmement difficile, sur le plan personnel, intérieur. Tu sais, vraiment une crise à la Saint-Denys Garneau, ou appelle ça comme tu veux, silence, une incapacité d’écrire qui a duré quelques mois. C’est comme si j’avais ressenti charnellement, nerveusement, dans tout mon système, l’incapacité de dire, qui est un de mes leitmotive, l’impossibilité de tout dire toujours, qui m’obsède. J’avais l’impression qu’avec Les épousailles j’avais atteint le fond du tonneau, et tout ça dans un énorme vacarme, parce que c’est bruyant Les épousailles, sauf certains textes, ici et là, qui sont plus doux. Mais c’est quand même une tentative assez folle, cette poésie des origines. C’est comme si j’avais voulu rejoindre un dieu à travers la parole. Les épousailles, c’est dans le sens d’épousailles cosmiques, les épousailles entre le moi, l’homme que je suis, et moi comme symbole de l’être humain, de l’espèce. »
L’engagement politique
Pays sans parole, que Préfontaine se plaît à appeler son best-seller, a fait l’effet d’une bombe au moment de sa parution. « J’étais plein de colère, plein d’agressivité. Et dans ce que j’écris, il y a une violence qui a été évidemment soulignée souvent par les critiques ou même les lecteurs, une violence verbale mais qui exprime aussi une violence intérieure. Cette passion passait dans la poésie et elle s’est canalisée également dans mon action politique. »
En plus de faire partie du groupe qui a jeté les bases du rin en 1960, le poète s’est souvent exprimé sur la question nationale ; on se souviendra de l’éditorial du numéro 23 de Liberté (mai 1962) intitulé « Parti pris », avant que naisse la revue du même nom. Lors de la crise d’Octobre, Préfontaine a vu son appartement perquisitionné mais il n’a pas été emprisonné, comme d’autres qui ont vécu plus douloureusement cette crise. « Je n’ai pas l’aura de cet héroïsme Dès qu’ils ont vu ma carte d’identité de professeur à l’Université McGill, ils ont conclu que je ne devais pas être dangereux parce que je travaillais pour les Anglais. C’est une des plus grandes insultes de ma vie. Ils sont entrés chez moi, j’étais sur la liste. Je le voyais bien, ils avaient une liste. Le flic tenait une liste de noms, et il passait d’un endroit à l’autre, je suppose, c’est facile à imaginer. J’avais une mitraillette contre la bedaine. J’étais accoté sur le mur avec un gars qui me tenait en joue pendant que d’autres cognaient dans le fond des garde-robes de mon appartement. Ils cherchaient des placards avec double-fond. Les types cognaient à coups de crosses de mitraillettes. Je ne comprenais pas, et je me disais : – Ils sont fous les gars ! – J’étais à la fois énervé et, en même temps, c’était un mélange de frousse, parce qu’il faut bien dire qu’on a la trouille dans ces moments-là. Je n’ai pas de honte à le dire : n’importe qui a la trouille à cinq heures du matin avec une mitraillette sur le ventre. »
Le poète évoque la haine vivace qu’il ressent toujours pour les artisans de cette crise : « C’est plutôt une haine totale pour Trudeau et sa bande, mais cette haine, je l’éprouvais bien avant. C’est une haine froide, glacée, pour les gens qui ont été les auteurs et les acteurs de cette crise réelle mais qui a été artificialisée par nos politiciens, particulièrement Trudeau et Bourassa, mais surtout Trudeau et Lalonde. J’éprouve pour Trudeau et Lalonde le plus souverain des mépris. Chrétien était là bien sûr, comme une espèce de marionnette inqualifiable. Tu sais, c’est inqualifiable Chrétien. Je ne connais pas d’adjectif en français ; il faudrait aller chercher un terme dans une autre langue, ou inventer les mots pour qualifier un être tel. Mais les deux âmes, les deux Machiavel – et encore là j’ai trop de respect pour Machiavel pour le rapprocher de ces Jésuites ratés que sont Pierre-Elliott Trudeau et Marc Lalonde »
Puis le récit se poursuit et Préfontaine ajoute qu’en janvier 1964, son appartement de la rue Lacombe avait été mis à sac par la police. Il n’a jamais su ce qui avait motivé cette intervention. Ses articles ? Ses relations amicales avec quelques membres de l’ALQ (Armée de Libération du Québec) et du premier FLQ ? Qui sait ?
De 1978 à 1980, Préfontaine travaille à titre de directeur de cabinet du ministre d’État au Développement culturel, le Dr Camille Laurin, père de la loi 101. Encore maintenant, la question linguistique est au cœur des préoccupations de l’écrivain. « La question linguistique me rend malade parce qu’on vit dans un pays dont la langue, contrairement à ce qu’on se raconte, est constamment menacée. Et elle le sera même si on devenait indépendant. On sera toujours une culture menacée, même avec des lois, même avec tout ce que tu voudras. Une génération de notre peuple peut toujours décider d’en avoir marre à un moment donné, et dire : – Merde on est en Amérique du Nord après tout ! Ce serait bien plus simple de parler l’anglais et on ferait plus d’argent même, à écrire en anglais –. On n’est même pas capables de percer le marché français, sauf exception rarissime. Nos gouvernements ont dépensé des millions pour essayer de créer des liens entre les éditeurs québécois et les Français en profitent. Parce que j’ai aussi une dent contre un certain type d’impérialisme français. Remplacer l’impérialisme des Canadiens anglais par un impérialisme français, je ne veux pas de ça. On est assez fort culturellement, on l’a fait, la preuve. Reste un problème de communication avec le monde entier, c’est-à-dire que pour être traduit en allemand, ou en japonais, il faut passer par Paris nécessairement. Je ne connais pas d’auteur québécois qui ait été édité par un éditeur québécois et traduit en japonais. On va le traduire en anglais à la rigueur, il va passer en France chez un éditeur français ou des petites maisons qui font de la coédition. »
Se purifier, s’unifier
La poésie d’Yves Préfontaine est élevée et exigeante, elle engage tout l’être, corps et âme. L’excès des débuts fait de plus en plus place au dépouillement, à la sobriété. « Je pense que si je ne me dépouillais pas, je serais un fort mauvais écrivain. On est condamné au dépouillement d’une certaine manière, surtout quand on part d’un verbe aussi excessif que celui qui était le mien quand j’avais 17 ans et 25 ans. J’arrive à des poèmes extrêmement réduits ; c’est l’être, le sens et le non-sens de ce qui est. Enfin, ça devient une poésie quasi métaphysique. Je ne sais pas si c’est encore de la poésie. On explose pendant des années et on va vers la simplification et la purification du verbe. »
Il y a une phrase de Préfontaine qui valse souvent en moi, une phrase en italiques dans un poème intitulé « Les mots d’ici » et dédié à Hubert Aquin. Une phrase d’une prodigieuse émotion : Blessure est ma force. Comme si dans la blessure il existait des assises pour se fortifier, ou se détruire.
Yves Préfontaine a publié, entre autres :
Boréal, éditions d’Orphée, 1957, Estérel, 1967 ; Les temples effondrés, éditions d’Orphée, 1957 ; L’antre du poème, éditions du Bien Public, 1960 ; Pays sans parole, l’Hexagone, 1967 ; Débâcle suivi de À l’orée des travaux, l’Hexagone, 1970 ; Nuaison, Poèmes 1964-1970, l’Hexagone, 1981 ; Le grainier, Le Grainier, 1969 ; Le désert maintenant, Écrits des Forges, 1987 ; Parole tenue : poèmes 1954-1985, Prix Québec-Paris, l’Hexagone, 1990.