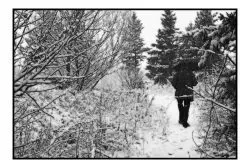Pierre Chatillon, né à Nicolet en 1939, est un poète libre. Il poursuit, à l’écart des kermesses poétiques et depuis plus de 60 ans, une œuvre singulière et riche. Il n’a jamais cessé de créer de la beauté en écrivant poésie, romans, nouvelles et essais, mais aussi en composant de la musique.
Son père, optométriste, redonnait en quelque sorte des yeux neufs à des gens dont la vue avait diminué. Et si Chatillon avait continué la profession de son père ? Car n’est-ce pas également un des rôles du poète d’aider à retrouver le regard de l’enfant et son émerveillement ? Henry David Thoreau disait : « Je crains bien que l’enfant qui cueille une fleur pour la première fois n’ait une intuition de sa beauté et de sa signification que le botaniste ensuite ne gardera pas ». Chatillon est de ces poètes qui n’ont pas oublié l’enfance et la découverte première du monde. Il vient de faire paraître, aux Écrits des Forges, un magnifique recueil intitulé Un voyage d’hiver1. Le titre rappelle l’atmosphère du célèbre cycle de lieder de Schubert. Comme si le poète venait de vivre, à sa façon, une sorte de Winterreise.
Pierre Chatillon a toujours construit ses livres de poésie de façon minutieuse. En trois mouvements comme une œuvre musicale. Ici, la première partie est consacrée à des préoccupations actuelles, la deuxième est une méditation sur l’hiver, la troisième est une quête de sagesse. Je lui ai posé quelques questions.
De quel voyage d’hiver s’agit-il ?

J’en aurais long à dire sur l’hiver. Chose certaine, je ne pourrais pas chanter « Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver ». Comme une multitude de Québécois, qu’on appelle snowbirds, je n’aime pas cette saison. Je suis plus inspiré par une baigneuse émergeant de la mer scintillante que par un banc de neige.
Pendant une vingtaine d’années, j’ai eu le privilège de m’évader sur l’île d’Anna Maria, en Floride, où j’ai créé avec bonheur et abondance poésie et musique. J’aurais aimé y demeurer, mais j’ai dû revenir et affronter, depuis deux ans, la rigueur de l’hiver. C’est de cette réalité qu’est né mon recueil. Et une grande question s’y pose : l’hiver peut-il inspirer des poèmes ? « Rien à dire / devant la page blanche / de la neige […] / comment écrire / avec des mots de verglas / des blocs de mots durcis / morts de froid ? / comment épanouir / le sourire d’un poème solaire / sans l’alphabet des fleurs d’été. »
Écrire ce recueil m’a ramené 50 ans en arrière, à l’époque douloureuse où je composais Le mangeur de neige. J’espérais ne jamais effectuer un retour à cette période de ma vie. L’hiver était pour moi une agression des puissances de mort. Toute vie, toute sensualité disparaissant pendant ces longs mois.
Dans un poème de mon recueil, je raconte l’histoire d’un homme qui pénètre dans la pleine lune d’hiver et s’y retrouve emprisonné. De la même façon, j’avais la sensation d’avoir été piégé par le froid. Pourquoi ? L’hiver n’est pas que froidure, c’est aussi le règne de la blancheur, de la pureté. J’étouffais dans la blancheur. Si j’effectue une équation, cela donne ceci : blanc égale mort, pur égale mort.
Mon enfance s’est écoulée dans cette période mortifère qu’on appelle la Grande Noirceur, alors que l’oppression de l’Église était absolue. Alors qu’on terrifiait les enfants avec le péché, le mépris de la chair, la haine du plaisir. Alors qu’on survalorisait une pureté qui menait à la désincarnation. Cette javellisation du corps conduisait à un culte de la blancheur. Or je constate que si je hais le froid, ce que je rejette c’est aussi le blanc. Dans Moby Dick, Melville consacre un chapitre à expliquer pourquoi la baleine que chasse le capitaine Achab est blanche. C’est qu’elle représente le puritanisme. Ce roman grandiose illustre donc le combat que Melville livre au puritanisme. Dans Le mangeur de neige, c’est un combat apparenté à celui-là qui s’engage. Après Le mangeur de neige, pour célébrer ma victoire, j’avais écrit ce grand hymne au soleil et à l’amour qu’est La mort rousse. Et je m’étais bien promis de ne jamais revenir en arrière.
Mais le destin me force à affronter de nouveau la mort blanche. Privé de l’inspiration que me procuraient les fleurs, les oiseaux, les parfums, les couleurs, la mer et le soleil d’une île floridienne, il me faut redécouvrir une écriture adaptée à cette situation si je ne veux pas cesser de créer. C’est ce projet que j’ai tenté de réaliser. Faut-il parler d’une réconciliation ? Peut-être.
Au fond, je ne déteste probablement pas autant que cela la saison froide puisque, dans ma jeunesse, j’ai beaucoup aimé faire du ski. Et il est indéniable que certains paysages hivernaux sont d’une grande beauté. Puisqu’il m’arrive de tomber en admiration devant l’immaculée splendeur d’une plaine couverte de neige neuve et d’y voir le symbole d’une innocence originelle perdue, ne serait-ce pas que le sens du mot pureté aurait été perverti par le puritanisme ? Et qu’il faudrait corriger la déformation de ce mot en en rétablissant la signification authentique ?
L’hiver, tel que je le conçois dans mon imaginaire poétique, fait référence à de nombreux facteurs qui relèvent davantage de l’inconscient que de la raison.
C’est pourquoi je veux préciser que dans mes poèmes il s’agit plutôt d’un hiver intérieur que d’un hiver extérieur.
Mais il n’est pas question que d’hiver dans le recueil?
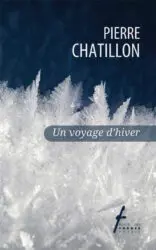 En effet. La troisième partie, qui a ma préférence, évoque une sorte d’épanouissement du cœur, pour ne pas dire d’accession à un éternel printemps. Elle se compose de poèmes lumineux atteignant une sérénité à laquelle j’avais toujours rêvé. Sérénité qui est probablement l’apanage du grand âge. « Une musique suave / émane d’un nuage / translucide / sans musiciens visibles / sans instruments / mon ouïe affinée par les ans / capte ces sons diaphanes / c’est une mélodie d’avant le temps / d’avant la Terre et les planètes / une harmonie d’avant toute matière. » Une béatitude où s’apaisent toutes les angoisses, où se résolvent toutes les quêtes, une félicité qui répond à toutes les grandes interrogations. Un apprivoisement de l’au-delà. « On dirait que je m’évapore / je m’habitue à disparaître sans souffrir / à me fondre telle une note / dans la joie d’une musique céleste / comme si rien au monde / n’était plus naturel. » Un abandon à un sublime ravissement : « un fleuve de lumière / coule au milieu du ciel / il suffit d’y plonger mon esprit / comme en une source miraculeuse / pour être transfiguré / dans mon visage s’ouvrent / des yeux d’aurore ». Il semble que tous les tourments de mon œuvre conduisaient à cette quiétude-là.
En effet. La troisième partie, qui a ma préférence, évoque une sorte d’épanouissement du cœur, pour ne pas dire d’accession à un éternel printemps. Elle se compose de poèmes lumineux atteignant une sérénité à laquelle j’avais toujours rêvé. Sérénité qui est probablement l’apanage du grand âge. « Une musique suave / émane d’un nuage / translucide / sans musiciens visibles / sans instruments / mon ouïe affinée par les ans / capte ces sons diaphanes / c’est une mélodie d’avant le temps / d’avant la Terre et les planètes / une harmonie d’avant toute matière. » Une béatitude où s’apaisent toutes les angoisses, où se résolvent toutes les quêtes, une félicité qui répond à toutes les grandes interrogations. Un apprivoisement de l’au-delà. « On dirait que je m’évapore / je m’habitue à disparaître sans souffrir / à me fondre telle une note / dans la joie d’une musique céleste / comme si rien au monde / n’était plus naturel. » Un abandon à un sublime ravissement : « un fleuve de lumière / coule au milieu du ciel / il suffit d’y plonger mon esprit / comme en une source miraculeuse / pour être transfiguré / dans mon visage s’ouvrent / des yeux d’aurore ». Il semble que tous les tourments de mon œuvre conduisaient à cette quiétude-là.
Vous êtes un grand lecteur, quels sont les poètes dont vous vous sentez proche ?
J’aime une multitude de poètes aussi différents que Lautréamont et Rabindranath Tagore. En passant par Baudelaire, Rimbaud, Nelligan, Supervielle, Shelley et Whitman. Je reconnais même ma dette envers l’auteur anonyme d’un ouvrage médiéval intitulé le Merveilleux voyage de saint Brandan au paradis.
Dans le présent recueil, on pourrait déceler une influence de certains « poètes des choses » comme Guillevic ou de quelques poètes américains « objectivistes ». Car je relève le défi de transfigurer par la poésie des sujets qui peuvent sembler rébarbatifs. Mon livre débute par quatre poèmes inspirés par des actes terroristes. Un autre poème parle d’une chaise en plastique brisée. Un autre décrit une plongée dans un de ces terrifiants trous noirs qui fascinent les astrophysiciens. Cette façon de procéder existait déjà dans mes autres recueils : j’ai consacré des poèmes à des automobiles et même aux morceaux qui constituent les freins d’une auto ! Toutefois, cette particularité n’apparaît qu’occasionnellement et elle ne m’empêche pas d’être avant tout un chantre lyrique de la nature et de l’amour, ce qui me distancie totalement des poètes dont je viens de parler.
Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune poète ?
Sois toi-même. Mais attention, pour être soi-même il faut se connaître et cela prend des années. Médite cet aphorisme de Goethe : « Deviens qui tu es ».
* Le marcheur au parapluie, ©Sophie Gagnon-Bergeron.
** Pierre Chatillon ©Marie-Claire Boucher.
1. Pierre Chatillon, Un voyage d’hiver, Écrits des Forges, Trois-Rivières, 2020, 87 p. ; 16 $.
EXTRAITS
De la mort de toutes les fleurs
émane tel un parfum blanc
l’éblouissante pureté
de la neige
mais faut-il vraiment que meurent
toutes les couleurs
pour que règne à l’infini
la splendeur de cette lumière glacée
dont l’éclat nie la vie ?
p. 31
Je n’étais rien
je retourne au néant
mais d’où vient que ce rien
a tant rêvé de beauté ?
p. 72
N’en parle à personne
va dans un bois profond
colle ton oreille aux troncs
tu entendras parfois
battre un cœur discret
tu comprendras que d’autres
l’ont fait avant toi
tiens-toi droit parmi les arbres
attends que tes orteils
s’enracinent dans le sol
et que la sève dans tes veines
remplace ton sang
p. 24