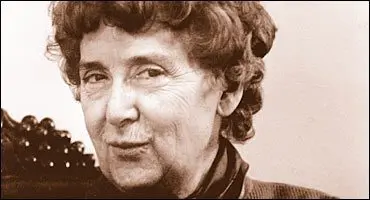Figure majeure de la poésie québécoise moderne, Rina Lasnier poursuit toujours une œuvre étonnamment riche et diversifiée. L’exigence et la rigueur marquent son écriture ; chez elle, l’intensité de l’expression se double d’une profonde passion pour la vie sous toutes ses formes.
Une vingtaine de livres témoignent de cette existence tout entière consacrée à la poésie.
Nuit blanche : Rina Lasnier, qu’est-ce qui fonde et justifie l’expérience poétique comme aventure de langage ?
Rina Lasnier : Il faut bien que la pensée s’exprime par ce moyen des mots ordonnés vers un sens qu’on appelle le langage. L’écriture, prose et poésie, tente donc non seulement d’exprimer la pensée, mais encore de la dépasser. La poésie est toujours un langage qui ne se contente pas de nommer les choses, mais les réincarne ou les incarne.
Plus le langage de l’écriture est personnel, plus il atteint à l’universel. Il arrive que ce langage profond du poète le révèle à lui-même. Ne l’oublions pas, c’est d’abord le langage qui s’adresse à l’écrivant et non l’inverse ; ce qui signifie que le langage profond commence dans le silence, dans l’écoute des signes et des correspondances qui s’établissent à différents niveaux du conscient et du subconscient. Ces signes nous livrent la transparence de l’être, de la chose à saisir par le langage. C’est ce que Heidegger appelle la SOUVERAINETÉ du LANGAGE, de l’écriture créatrice.
Quelle est pour vous la fonction de l’écrivain ; à partir de quoi se définit-elle ?
R. L. : Ce doit être d’abord son identité personnelle Cette part reçue, que je nommerai le don, qui centre ce qui se passe pour le conduire à l’essence de la beauté-vérité. Voilà le moteur ; disons mieux, le lieu profond et intime de la connaissance directe de la poésie. Tout ce qui se passe de commentaires, d’analyses, très loin des jeux de l’esprit, des méthodes, des engagements intellectuels. Gratuité du balbutiement et du bruissement initial, jusqu’à ce que l’effort silencieux de la vision, traversée de signes, nous jette dans le courant de la musique du poème. Tout cela à travers des émotions diverses, fugaces, des aridités desséchantes, et soudain, à cause de la disponibilité, c’est l’effusion de la poésie, comme si l’âme avait trouvé le contact profond et intuitif de l’inaudible.
L’écrivain reste donc un chercheur nocturne, comme le plongeur sous-marin. Et pourtant, c’est son rôle et sa bienheureuse dérive de choisir entre l’apparence et l’essence, entre l’inintelligibilité et le mystère éclairant.
L’expérience poétique doit laisser le poète en état de perpétuelle gestation ou d’attente intérieure, sans concentration, sans volontarisme, comme dans la grâce de son don de poète, une intuition qui est au-dessus de la raison. C’est par l’intuition poétique que les choses, même ordinaires, regorgent de sens, de significations.
Qu’importe ici la technique, elle est comme disparue dans la conscience des mots et la transcendance du langage rayonnant ; je veux dire sans fixation dure de moyens intellectuels, plus fabricateurs que créateurs. Comment une matière psychique si mobile, si dérivante pourrait-elle être soumise, avec profit, à des techniques inventées soit par la mode, soit par l’impuissance, soit par l’inespoir de l’inspiration ? Toute contrainte extérieure qui entrave la fusion de l’imaginaire et de l’émotion me paraît une fiction, un mensonge. Le danger réel ? C’est que, par ces techniques trop rigoureuses, l’inconscient lui-même finisse par se mécaniser ; que la matière brute ne passe plus par l’enrichissement de la personnalisation du poète. C’est Virginia Woolf qui disait : « Celui qui ne croit pas en SA POÉSIE, et est dogmatiquement sûr de ses techniques, prouve qu’il n’a pas le don. »
Dans quelles conditions écrivez-vous ? De quoi avez-vous essentiellement besoin pour écrire ?
R. L. : De toute l’infinitude et profondeur du SILENCE. De nos jours, ce silence que l’on compare à l’or est encore plus rare et plus précieux. Et si la valeur économique d’un pays est basée sur l’or, la qualité de la poésie dépend du silence, le double silence extérieur et intérieur. Je ne ferai pas le procès honteux du bruit et du vacarme des villes, des campagnes, des maisons comme des lacs et rivières, mais si vous cherchez une victime quotidienne du bruit, regardez vers l’enfant et l’artiste. Le cancer de l’intelligence, de la connaissance, de l’émerveillement, de la liberté profonde, c’est le bruit la machine bruyante, le chien aboyeur, la radio et la télé omniprésentes ; les images aussi omniprésentes que la parole commerciale ou inutile.
Il reste quelques bordures de silence, quelques plages peu fréquentées, et quelques montagnes inaccessibles, réservées, elles aussi soit aux riches de ce monde, soit aux ermites alpinistes
Aux écrivains québécois, il reste le béni calfeutrage de l’hiver, le plus beau cloître du monde, si l’on possède une rangée d’arbres pour entendre la neige se taire et l’arbre s’ajuster à son ascèse. Toute la nature est un silence vivant et vivifiant, c’est le seul temple où chacun peut entrer comme dans une plénitude qui délivre et qui comble à la fois. Chacun l’établit à sa manière ; et nombreux sont ceux qui ont choisi le silence relatif de la nuit pour écrire. Quant au mien, je suis obligée de me servir de la musique pour dresser un mur contre les bruits ambiants et inévitables. Et commence la conversation entre le silence et ma parole ; le silence écoute, la parole balbutie, se clarifie, s’embrouille, se reprend, saisit, se chante un chant d’allégresse puis s’affale comme une feuille morte de son fruit trop lourd. Puis recommence l’échange ; entre le regard intérieur et l’expression à ajuster à cette vision.
À sa table, le poète silencieux est un étranger, un exilé, un absent, un tacite comme l’eau au fond du puits. Mais toute la vie bouge en lui, car c’est aussi un parturient, un géniteur, fût-il sans trop de génie.
Le silence au sommet, qu’est-ce, sinon une lutte, celle de Jacob contre l’Ange, cet appel de l’homme assailli par le sacré, qui monte plus haut que l’échelle de l’ange lutteur. QUEL EST TON NOM, toi qui me ronges le cœur et me laisses la hanche brisée et je resterai un boiteux entre l’inégalité de l’humain et du divin, peut-être un témoin de la Passion du silence et de la Parole transfiguratrice.
Quelle part occupe l’écriture dans votre vie ? Autrement dit, de quelle liberté disposez-vous ?
R. L. : Celle que nous laisse le temps de vivre, les obligations pratiques de toutes sortes : de la secrétaire, de la ménagère, de la femme de lettres que je suis, et vivant seule tout ce quotidien, souvent envahi par les imprévus, les fatigues migraineuses, les visiteurs intempestifs. J’estime qu’il me reste moins de six mois par année pour écrire, et naturellement, ce sont ceux de l’automne et de l’hiver que je me réserve.
Parfois, la liberté devient comme débordée, noyée sous la poussée puissante de ce dire comme anonyme qui nous envahit, et c’est à peine si l’intelligence vient à bout de ce beau désordre qui bouscule ses dons. Au fond, cela dépend beaucoup de la préparation éloignée et fidèle. Tout peut servir, au début, toujours à notre insu. Nous ne connaissons pas à l’avance, dans cette vaste dérive de l’imaginaire, ce qui portera racine et fruit. Moi, c’est cette dépendance du presque rien transformateur et transfigurateur qui m’émerveille toujours. S’asseoir à une table de travail, c’est parfois une ascèse, puis si le buisson épineux s’enflamme, pose une énigme, s’établit la scansion rythmique en même temps que l’image ou l’idée.
Deux choses restent concomitantes au moment de la création, une sorte d’innocence et un amour certain. Ce que l’on écrit a été aimé avant d’être partagé. Et la preuve que le poète parle dans l’innocence ou la pureté, n’est-ce pas qu’il est courant de dire que la poésie est profanée quand elle n’est pas reçue selon son être originel et original?
J’imagine que le livre et la lecture occupent une place importante dans votre vie d’écrivain ; êtes-vous de ces personnes qui ne vivent que par les livres ?
R. L. : Loin de là ! Et si je vous répondais que je ne suis peut-être pas une véritable intellectuelle ?
Certes j’ai lu énormément et je lis encore beaucoup et de tout. Lire, c’est recevoir, puiser, réfléchir, c’est accepter ou refuser. Plus loin encore, écouter avec son cœur ou son âme, c’est partager une civilisation, une culture, une vérité, une beauté, c’est se connaître soi-même. Rien ne remplacera, malgré tout, le contact humain ; il reste l’enrichissement le plus vivant, même lorsqu’il déçoit. S’il limite et appauvrit, c’est que nous n’avons pas eu la patience de découvrir dans l’insuffisance ou la faiblesse de l’autre, ce petit point de feu, cette étoile capable d’éclairer une large part de ténèbres.
Heureux qui referme ses livres pour un regard humain, pour une lente méditation, ou pour la vive préhension de la beauté. Une lecture qui ne s’achève pas par un émerveillement, une détresse heureuse comme celle qu’apporte la musique, a pu nous distraire, mais ne nous a pas stimulés ou changés.
Pour résumer, ne pourrait-on pas affirmer avec Bachelard qu’une âme élevée est profondément bonne ? Si donc une lecture ne nous élève pas, c’est que manque la qualité d’âme et d’être de l’auteur.
Issue d’une expérience spirituelle, votre poésie n’en demeure pas moins sensuelle, voire érotique comment réagissez-vous à une telle remarque ?
R. L. : J’ai mes cinq ou six sens à ma disposition pour connaître, choisir et goûter à tout l’univers créé et incréé. La sensualité est la nécessaire médiatrice entre le corps et l’âme.
Ce que nous oublions peut-être, c’est cette sorte d’omniprésence de nos sens qu’on peut comparer à de très sensibles antennes captatrices. Si l’oreille entend, elle voit aussi, elle touche ; et ainsi de tous nos sens dont les sensations, les avertissements nous précèdent, nous accompagnent et nous suivent. Songez aux mains du pianiste, à celles du sculpteur, à ces gestes qui gardent le corps en alerte aux avant-gardes de l’esprit.
Les profondeurs de l’homme, vous le savez, ne s’atteignent pas par le sensualisme, mais bien par les voies spirituelles de la connaissance contemplative. Certes, il y a une continuité des sens à l’esprit, mais il faut distinguer entre la connaissance sensible, la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. Les sens connaissent du dehors, l’âme spirituelle, du dedans. Ce flux incessant entre le corps et l’âme reste d’une trop grande complexité pour que nous en percevions les phases. C’est tout le champ de bataille à explorer entre l’action et la contemplation.
Rina Lasnier a publié :
Textes choisis, Fides, 1965 ; La part du feu, Songe, 1970 ; Images et proses, Richelieu, 1970 ; La salle des rêves, HMH, 1971 ; Mémoire sans jours, Fides, 1972 ; Madones canadiennes, Fides, 1972 ; Le rêve du quart jour, Richelieu, 1973 ; L’échelle des anges [épuisé], Fides, 1976 ; Les signes, HMH, 1976 ; Matin d’oiseaux [épuisé], HMH, 1978 ; Paliers de paroles, HMH, 1978 ; Voir la nuit, HMH, 1981 ; Entendre l’ombre, HMH, 1981 ; Le choix de Rina Lasnier, Presses Laurentiennes, 1981 ; Chant perdu, Écrits des forges, 1983 ; L’ombre jetée 1, Écrits des forges, 1988 ; Le soleil noir, Presses Laurentiennes, 1988 ; Présence de l’absence, « Typo », 1992.