Un superbe matin d’automne, rue Saint-Louis, à Québec ; ma première entrevue pour Nuit blanche. Anxieux, mais heureux, j’attends Michel Serres au Consulat de France. De la fenêtre, je fouille la rue, à la recherche d’un académicien grave et solennel. Un joggeur apparaît : c’est lui, Hermès qui vient d’arpenter les bords du Saint-Laurent pendant une heure, pour se remplir de cette lumière qu’il trouve si belle au Québec.
Michel Serres se promène dans la vie et le monde comme un péripatéticien souriant. Quant à l’Académie française, qui vient de l’accueillir, il me confiera un peu plus tard : « Quand on a mon âge, on se moque tellement de l’Académie qu’on peut y entrer ! »
Nuit blanche : Michel Serres, des bords de la Garonne, où vous êtes né, aux bords du Saint-Laurent…
Michel Serres : … Il y a un lien, vous savez. Quand on termine la Garonne, on tombe sur les vignobles de Bordeaux, dont le Margaux. Pour nous, c’est un vin, mais, pour les gens du Saint-Laurent, le margot c’est le Fou de Bassan. Quand Pierre Perrault, poète et cinéaste québécois, m’a expliqué ce que voulait dire margot, les deux rivières se sont pour moi réunies.
Toute votre œuvre philosophique et littéraire est un voyage entre deux rives, entre deux terres, entre les systèmes et leurs écueils, entre les thèmes et les styles.
M. S. : C’est tout à fait juste. Mon livre Le tiers-instruit est une sorte d’élaboration d’une culture entre les sciences et les humanités, qui se tournent le dos depuis déjà presque un siècle. Je crois que le philosophe est un homme de l’errance ; il n’a pas de point fixe. Ça m’a pris très jeune, vous savez. Dès le secondaire, j’ai fait à la fois des études en mathématiques et en lettres classiques. J’ai toujours continué dans cette tierce voie, avec plus d’inconvénients que d’avantages. Quand vous faites un livre sur Lucrèce, par exemple, et que vous y parlez de science, les scientifiques se moquent parfaitement du latin et les latinistes de la science ; alors vous tombez dans une sorte de vide. C’est une voie qui coûte un peu cher, mais elle est d’avenir.
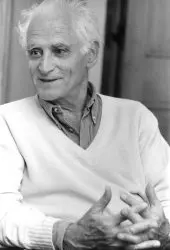
Et pourtant, on n’arrête pas de parler d’interdisciplinarité.
M. S. : Voilà : on en parle énormément mais c’est cosmétique. Dans les universités, l’interdisciplinarité est un dogme vide. Comme toutes les carrières se font au centre des disciplines, celui qui se trouve à la marge n’est pas pris au sérieux, surtout quand il se met à parler de l’autre spécialité et qu’il fait le pont. Or, si on y regarde de près, les grands prix Nobel de biochimie, par exemple, ont tous été inspirés après la guerre par un livre qui avait été écrit par un physicien en 1937. Comme si la physique avait inspiré ou ensemencé la biologie.
Chaque spécialiste reste enfermé dans son propre espace, et pourtant l’histoire des sciences nous apprend que c’est presque toujours grâce à des visites inter-territoriales, à la tangente – pour reprendre un mot que vous aimez – que les découvertes se font.
M. S. : Il faudrait faire une sorte de sociologie des sciences pour expliquer ces replis. L’interdisciplinarité est un discours de circonstance et n’est jamais pratiquée pour des raisons professionnelles, alors que tout le monde en pressent la nécessité. Je me souviens très bien avoir commencé ma carrière dans des universités où les lettres et les sciences se partageaient à parts égales les espaces, les fonds, les professeurs et les étudiants. La proportion s’est déséquilibrée : 95 % environ pour les sciences, le reste pour les lettres. La science est montée comme jamais en puissance, attirant une grande partie des bons cerveaux. On voit même des étudiants faire des études scientifiques alors qu’ils manifestent de réels talents littéraires, mais ceux-là reviendront peu à peu du côté de la littérature.
La langue française est assez rigoureuse pour se payer le luxe d’aller jusqu’à la beauté
Et pourtant, en France, les gouvernants sont le plus souvent des littéraires.
M. S. : C’est une vieille tradition profondément française, même s’il est arrivé qu’on voie en Allemagne des premiers ministres musiciens. Louis XIV était un excellent traducteur des commentaires de Jules César. Édouard Herriot ou de Gaulle étaient de très bons écrivains. Je crois que c’est assez caractéristique d’un pays qui, à beaucoup d’égards, est le pays du livre ! Le Québec participe de la même tradition : c’est un pays où on aime le livre, la lecture, la chanson, la chose littéraire. Cette culture-là nous est commune, avec la langue.
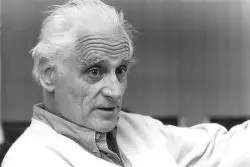
Nous parlions tout à l’heure des forteresses disciplinaires de la science. La littérature permet-elle une ouverture plus grande ?
M. S. : Je crois plutôt que c’est à l’histoire qu’il faut attribuer ce mérite d’inspirer nos hommes d’État : Louis XIV, de Gaulle, Mitterrand sont d’abord des historiens. Il est bon qu’un homme d’État ait et sache derrière lui l’épaisseur d’une tradition. Mais, inversement, les Québécois sont bien placés pour savoir que cette importance de l’histoire a coûté très cher. Napoléon était aussi un historien et il emmène ses savants en Égypte, à l’Est, pendant que les Anglais vont à l’Ouest. Les Québécois ont beau dire à Napoléon de venir à l’Ouest, comme il est historien, il va vers l’Est.
Les philosophes vous reprochent d’être un littéraire…
M. S. : Les philosophes me reprochent tout, de ne pas être heideggérien, de ne pas être de l’école analytique, de ne pas être ceci ni cela. Tout le monde n’aime pas Michel Serres, voilà tout ! Pardonnez-moi cette première réponse, de type ethnologique. La vraie réponse est la suivante : on ne peut philosopher que dans le droit fil de sa propre langue. Depuis cinquante ans, les philosophes français ont philosophé en allemand ou en anglais. Or, il y a une tradition profonde d’écriture presque artiste, à la limite de la littérature, chez les philosophes français : les œuvres de Montaigne, Diderot, Voltaire, Rousseau, Bergson sont à la fois des monuments de philosophie et de littérature. La langue française est assez rigoureuse pour se payer le luxe d’aller jusqu’à la beauté. Je suis un traditionnel de la langue française.
Être dans le droit fil de la pensée la plus profonde
Quand je vous entends insister sur la tradition, l’enracinement nécessaire, je pense à vos origines paysannes.
M. S. : Vous avez raison de parler de la terre : il y a un enracinement du philosophe dans la terre de sa langue. Je voyage assez pour savoir que, lorsqu’on utilise une autre langue que la sienne, on n’atteint pas complètement la profondeur voulue de l’analyse. On voit ce que ça veut dire, mais on n’est pas dans le droit fil de la pensée la plus profonde.
Alors, pourquoi les philosophes français sont-ils allés chercher ailleurs ce qu’ils auraient pu trouver au bas de leur vigne ?
M. S. : Il y a en France une autocritique dévastatrice. Voilà six ans, j’ai lancé un corpus des philosophes de langue française qui en est à son soixantième volume. J’avais observé que les Français ne lisaient pas du tout leur tradition philosophique. Les Français ont toujours entretenu un rapport très ambigu à leur propre culture : ils l’aiment, mais ils la détestent. Si vous voulez écouter de la musique française, allez donc aux États-Unis. Quant aux grands musées de peinture française, ils sont à l’étranger.
Venons-en au Contrat naturel. J’ai cru d’abord que vous aviez succombé à la mode de l’écologie, mais en le lisant, j’ai fini par y voir une tentative pour tracer une tangente entre une philosophie de la nature et une philosophie du droit.
M. S. : Je n’avais bien sûr aucune envie de faire un livre d’écologie. Je suis parti d’une idée toute simple, à la fois grande et traditionnelle : il n’y a pas de grande philosophie qui ne demande à un moment de trouver un lieu d’où l’on voit à la fois la science et le droit. Voyez Platon, Aristote, Rousseau, Hegel, c’est vrai de tous les philosophes. Il y a une dizaine d’années, la France m’avait désigné comme expert, en compagnie d’un biologiste et d’un médecin, pour étudier en un séminaire international l’opportunité d’un sommet des sept grands sur les problèmes éthiques posés par la biologie. Nos origines, nos convictions, nos sensibilités étaient si différentes que je me suis vite rendu compte que le droit était le seul discours qui pouvait mettre d’accord des gens qui avaient des opinions, mais aussi des intérêts extraordinairement divergents. Je me suis donc remis à l’école et j’ai pris des cours de droit, comme un fou. J’ai constaté un conflit formidable entre les juristes et les scientifiques. « As-tu le droit de faire telle expérience ? » demande le juriste. Et le savant de rétorquer : « Je cherche la vérité, de quel droit ? » C’est ce conflit qui a été l’occasion de mon livre, dont le succès a presque été un malentendu.
Derrière le philosophe et l’écrivain, il y a chez vous un physicien amoureux du monde.
M. S. : Depuis soixante, soixante-dix ans, toutes les philosophies ne parlent que du langage, l’américaine avec l’école analytique, l’allemande avec la phénoménologie, la française avec l’étude du discours, de l’écriture, de la rhétorique, des formes. Depuis que je suis né, et derrière des apparences très opposées, l’analyse du langage accapare la philosophie. Or, pour moi, l’objet de la philosophie, c’est le monde. J’ai toujours été fasciné par le monde, la terre, la physis. J’ai toujours aimé le monde, le monde est beau, c’est ainsi. C’est comme suivre le Saint-Laurent sous cette lumière que vous ne voyez plus tellement vous y êtes habitués, cette lumière du Québec, si précise et si douce, qui vous donne les larmes aux yeux dès que vous arrivez ici, une clarté comme nulle part ailleurs au monde.
Le philosophe, c’est l’homme de la nuit
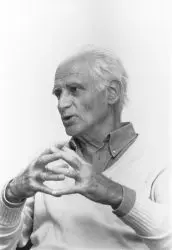
Le premier texte que j’ai lu de vous évoquait les tourbillons de l’eau, les nSuds néguentropiques qu’on peut saisir dans le courant. Votre héros, c’est Hermès, mais ce pourrait être Ulysse, voyageant d’une île à l’autre, d’un nœud à l’autre.
M. S. : Dès qu’on met la main en aval d’un tourbillon, on s’aperçoit qu’on le tient quand même, qu’il y a un main-tenant. Vous voyez comme les choses nous apprennent en dehors du langage. Et c’est vrai que l’idée d’une route simplement marquée de stations est une idée méthodique un peu archaïque, alors que l’idée d’aller d’échangeur routier en échangeur routier, comme des nSuds sur un réseau, est un modèle qu’en effet j’adopte souvent. J’ai publié un gros livre qui s’appelle Éléments de l’histoire des sciences, où j’ai essayé de montrer qu’il y a des réseaux dans le corps, le monde, la technique, que les choses circulent en réseaux, c’est-à-dire en connexions réciproques.
C’est la connexion qui est intéressante et pourtant l’homme de science se concentre sur un objet délimité plus que sur ses frontières ou ses connexions avec d’autres objets.
M. S. : Il a raison en partie, parce qu’on ne fait pas du bon travail si on ne focalise pas sur un objet bien défini, marqué, concentré, et les résultats confirment cette nécessité. Quand je travaille sur un objet, je m’efforce à cette précision. Mais je crois précisément que c’est dans le précis qu’on retrouve souvent tout. Je vais vous donner un exemple. On a toujours pensé que la lumière était la bonne analogie pour la connaissance : la clarté, le siècle des Lumières, le Roi-Soleil, etc. Chez Platon, le soleil illumine et il est vrai qu’à midi, un jour d’été, c’est la connaissance sans ombre. Le Soleil a toujours été la métaphore optimale pour la connaissance. Et tout d’un coup, les astronomes ont découvert que le Soleil était une « naine jaune », et que la nuit, nous sommes sous des milliards de soleils. Vous vous rendez compte ! Alors qu’à l’époque des Lumières, on assimilait la nuit à la méconnaissance, on a fini par découvrir, curieusement, que la nuit était la totalité des jours. Le spécialiste, c’est l’homme du jour ; le philosophe, c’est l’homme de la nuit. Les spécialités et les centres de la connaissance sont multiples. La nuit du philosophe, c’est la somme des jours.
Philosophe mobile de la lumière noire, Michel Serres est un « homme de l’errance » qui nous laisse un bagage de pensées à chaque escale.
Michel Serres a publié :
Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, 2 vol., Presses Universitaires de France (PUF), 1968 et 1 vol., PUF, 1982, 1990 ; Hermès I, La communication, Minuit, 1969 et « Points », Seuil, 1984 ; Hermès II, L’interférence, Minuit, 1972 ; Jouvences sur Jules Vernes, Minuit, 1974 et 1991 ; Hermès III, La traduction, Minuit, 1974 ; Auguste Comte, Leçons de philosophie positive, t. I, Hermann, 1975 ; Zola, Feux et signaux de brume, Grasset, 1976 ; Hermès IV, La distribution, Minuit, 1977 ; La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce, Fleuves et turbulences, Minuit, 1977 ; Esthétiques sur Carpaccio, Hermann, 1978 et Livre de poche, 1983 ; Hermès V, Le passage du Nord-Ouest, Minuit, 1980 ; Le parasite, Grasset, 1980 ; Genèse, Grasset, 1982 ; Rome, Le livre des fondations, Grasset, 1983 ; Détachement, Flammarion, 1983 et 1986 (édition revue) ; Les cinq sens, Grasset, 1985 ; Statues, Le second livre des fondations, François Bourin, 1987 et « Champs », Flammarion, 1989 ; L’Hermaphrodite, Flammarion, 1987 et « GF », 1989 ; Éléments d’histoire des sciences, en collaboration, Bordas, 1989 ; Le contrat naturel, François Bourin, 1990 et « Champs », Flammarion, 1992 ; Cours de philosophie positive I, Philosophie première, en collaboration, Hermann, 1990 ; Le tiers-instruit, François Bourin, 1991 ; Éclaircissements : entretiens avec Bruno Latour, François Bourin, 1991 ; La légende des anges, Flammarion, 1993 ; Les origines de la géométrie, Flammarion, 1993 et « Champs », Flammarion, 1995 ; Atlas, Julliard, 1994 ; Éloge de la philosophie en langue française, Fayard, 1995 ; Les messages à distance, « Les grandes conférences », Fides, 1995.









