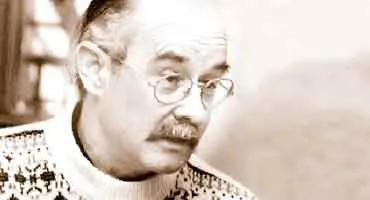La parution, en 1986, de L’aventure d’un médecin sur la Côte-Nord (récit de voyage) annonce, pour Jean Désy, le départ de l’Aventure de l’écriture ! Depuis, d’autres récits de voyage, des nouvelles, des romans, des essais, de la poésie , bref une vingtaine d’ouvrages, individuels ou collectifs, ou des articles parus dans des revues spécialisées démontrent que l’Aventure se poursuit.
Jean Désy a décroché un DEC en sciences pures (1973), un doctorat en médecine (1978), un doctorat en littérature québécoise (1990), une maîtrise en philosophie (1996). Une profonde préoccupation l’anime : élargir sans cesse sa découverte du sens de la vie, progresser dans l’aventure extérieure tout en restant centré sur l’aventure intérieure et vivre en harmonie. Passionné du Grand Nord, haut lieu de sa « destinée », il y pratique la médecine à titre de généraliste ; il ressent partout dans le « désert » nordique la présence suprême de l’Esprit ; il écrit. Quatre enfants qui vivent dans le Sud sont son point d’ancrage dans la ville, dans une société où il ne peut plus fonctionner et dont il ne peut être solidaire. Il voyage entre le Sud et le Nord, passe du récit de voyage au travail médical, du rêve à la réalité, de la fiction à la poésie et à sa propre écriture, dans une unité palpable, presque magique. Nuit blanche l’a rencontré à Québec en octobre 1998.
Le goût du voyage
Le capitaine d’un voilier l’a invité à faire avec lui la traversée de l’Atlantique Nord, de Québec à La Rochelle. Il n’est pas matelot, mais se joindra à l’équipage et sera seul à la barre, le temps de son quart, bon temps mauvais temps. Aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, il hésite à poursuivre la traversée ; l’épreuve de l’« amarinage » est rude, la voile est un sport violent physiquement ; mais Jean Désy, pour qui l’important est de lire et d’écrire, fera pourtant la traversée. De ce voyage, un livre, Lettres à ma fille, publié en 1997.
« J’aime, ces années-ci, être en situation de voyage. J’ai la chance et je provoque la chance de voyager ; mon travail y est associé et j’y trouve mon équilibre. Jusqu’à maintenant, c’est ce qui correspond le mieux à mon état d’être.
« Une des portes menant au contact avec les autochtones, Amérindiens ou Inuits, passe par le nomadisme. Les Cris, plus nomades que les Inuits, d’origine asiatique, abordent la vie avec la réserve due au sacré. Dans le Nord, les animaux doivent servir de nourriture aux hommes ; la chasse fait partie de la vie. Ce que les gens de la ville comprennent mal. » Un jugement de valeur très fin de siècle relie trop facilement sédentarisation et civilisation.
« Ce dont les hommes ont besoin, c’est de donner un sens à leurs actions. Sur un voilier, tu es obligé de descendre en toi-même. Si tu cherches le sens dans l’aventure extérieure, tu butes rapidement sur la limite ; dans l’aventure intérieure, il y a plus d’espace. L’aventure extérieure oblige à vivre l’aventure intérieure ; il faut avancer dans les deux. Si j’ai modifié ma vision de Proust, les deux pieds dans un bac d’eau chaude, de son univers un peu encrassé, cela dit indépendamment de la grandeur de l’œuvre, c’est que son aventure m’apparaît de plus en plus d’ordre intérieur. J’aime par ailleurs beaucoup Saint-Exupéry qui nous fait vivre une aventure stimulante par la littérature. Son écriture est condensée, son travail sur le langage est d’ordre méditatif. J’aimerais que la qualité de mon écriture puisse un jour rejoindre la sienne Tout tourne autour du sens et il faut sans cesse chercher à l’élargir. L’écriture oblige à un travail sur le langage. Récemment, j’ai découvert Pessoa. Il me fait voir le monde sous un angle nouveau. C’est un choc ! »
Le monde des souffrants
Docteur Wincot (1995) présente dix-sept nouvelles, inspirées par les expériences du médecin Jean Désy. Plusieurs présentent la réalité telle qu’elle a été vécue, il n’y entre aucun élément de fiction. D’autres sont une réflexion alimentée par l’expérience du « monde des souffrants ». Le médecin n’est pas toujours à l’aise dans ce monde ; il lui faut des réserves d’amour pour poursuivre son travail et résoudre des problèmes pour lesquels il n’y a pas de solution toute faite.
Ainsi Jean Désy, dans l’une de ses nouvelles, évoque le cas d’une femme victime d’une rupture d’anévrisme cérébral. Transportée de Kangiqsualujjuaq à Montréal, elle meurt à l’arrivée. À l’hôpital, un médecin se prépare à prélever sur le corps un rein pour le greffer à une jeune malade, mais celle qui vient de mourir n’en a pas donné l’autorisation et son frère s’y oppose : la greffe ne se fera pas. Et Jean Désy s’interroge sur les limites à apporter à l’intervention médicale.
« À cause des limites de ce qu’on peut offrir, on doit toujours se demander jusqu’où on doit aller. C’est ainsi quand on soigne, quand on réanime, quand on greffe Je pense à cet Australien à qui on a greffé un bras. Il y a des centaines de handicapés dans le monde ! Est-ce que chacun va pouvoir ou vouloir réclamer un bras, une main, un œil ? C’est un immense problème et je crois que c’est, avant toute chose, une affaire de dignité, pas seulement une question scientifique. Tant que les poètes, les écrivains, les artistes, les religieux aussi qui ont un point de vue plus spiritualiste, ne viendront pas tempérer les points de vue académique, ou scientifique, ou administratif, ou économique, on n’aura pas résolu ce problème majeur. Dans le cas évoqué, il apparaît assez évident que la jeune malade aurait pu recevoir un rein, intervention que l’absence d’une signature a compromise, mais
« Dans le monde inuit, le rapport au corps n’est pas celui qui est répandu en Occident. Il n’est pas évident qu’on puisse intervenir sur le corps des morts. Il est par ailleurs beaucoup plus facile de s’occuper des mourants chez les Inuits. Quand on dit à quelqu’un, après douze traitements de chimiothérapie, qu’il pourrait encore en recevoir deux, ce qui entraîne 15 000 $ de frais d’avion, mais qu’il mourra trois mois plus tard, la personne dit non. Ce n’est pas qu’elle veut mourir ; c’est qu’elle est prête à mourir sans autre intervention, c’est plus facile ainsi. Je crois qu’intervient ici une question de dignité avant tout. Plus la science avance, plus il y a une disproportion croissante entre ce qui est techniquement possible et ce qu’on va réaliser. Cela pose un problème éthique important. Le passage vers la mort est souvent plus douloureux quand on joue d’une certaine façon avec elle. »
Le suicide assisté
Une autre nouvelle du recueil présente un médecin spécialiste et une étudiante, future omnipraticienne ; connivence et estime réciproque les ont rapprochés pour un temps. Vingt ans plus tard, il l’appelle : il a un cancer et lui demande de le soigner. Il ne veut ni séjour à l’hôpital, ni chirurgie, ni thérapie agressive. Il a en réserve des fioles d’insuline qui, au moment voulu, lui permettront de se suicider. L’amour va-t-il à la fois refuser et accepter ce suicide ?
« Cette histoire n’a rien de fictif. L’euthanasie active est toujours justifiable quand c’est sur un fond d’amour ; c’est injustifiable quand c’est sur un fond d’indifférence et de technicité. C’est autour de cela que tourne ce grand problème d’éthique dans le monde contemporain. Beaucoup de gens pensent que le suicide assisté est finalement une belle porte de sortie ! »
Une autre fiction fait frémir mais pourrait, selon Jean Désy, devenir assez rapidement une réalité acceptée dans notre société. Dans cette nouvelle, le gouvernement met sur pied des cliniques spécialisées où chaque client choisit le jour et l’heure de sa mort. Avec les vieillards et les malades incurables, le directeur de la clinique ne rencontre aucune difficulté, heureux de les soulager rapidement et de mettre fin à leur vie sans souffrance. Les suicidaires essaient parfois de revenir sur leur décision pourtant, ce qui pose certains problèmes !
« C’est sur fond politique qu’il faut s’interroger sur le suicide et sur sa propre mort. Que la médiatisation soit tout à coup en faveur de l’euthanasie active, c’est quand même bizarre. On se demande si, la médiatisation allant dans ce sens, il ne faudrait pas aller dans l’autre sens. La littérature nous fait toucher des zones plus incertaines, plus mouvantes, plus grises, la question s’y révèle dure, difficile ou bouleversante : elle y est un peu plus vraie. »
L’amour parental, un miracle !
Le treizième texte n’est pas vraiment une nouvelle ; c’est une réflexion sur les naissances toujours possibles d’enfants mongoliens, trisomiques, ou affectés d’autres anomalies.
« Si un fStus est reconnu comme mongolien, mérite-t-il de continuer à vivre ? Ma raison accepte sans regimber qu’un fStus mongolien de dix semaines soit éliminé ; mais je le dis avec un serrement dans la gorge. Si une femme vient me voir parce qu’elle porte en son sein un être bourré d’anomalies chromosomiques, et qu’elle me dit qu’elle veut un avortement, je lui donne mon plein assentiment. Mais pourquoi ce nSud dans ma tête, ce frisson glacé dans mon dos lorsque j’exprime ce qui est pour moi une évidence ? Pourtant, il arrive que l’amour parental s’ouvre à un enfant trisomique ; cet amour-là est irrationnel, il est miraculeux ; la relation d’amour à un enfant handicapé est parfois très intense. D’où vient cette possibilité d’aimer ce qui, si l’on rationalise, serait non aimable ? En littérature, lieu de fuite, on peut jongler avec les concepts. On peut toujours, dans une nouvelle, s’interroger sur le bien-fondé d’une affirmation. Mais si on est soi-même confronté avec un avortement, c’est une autre paire de manches. »
Le réel et le rêve dans la littérature
« On se frappe presque toujours sur le mur du réel, dans le monde des malades, dans le monde des mourants. Le réel est plus fort que le reste. Raconter ce réel permet à la littérature de lui donner un supplément de sens. Rimbaud reste le poète par excellence d’un univers auquel on n’osait pas rêver. On reste toujours comme accroché entre deux mondes, celui de la fiction et celui du réel, et, par bonheur, on trouve parfois un lieu où règne un peu plus d’harmonie entre eux. Une des raisons pour lesquelles j’écris, c’est que l’écriture ne me prive pas de la joie que j’éprouve à parler avec des amis des sujets qui me préoccupent dans ma pratique. Et quand, parmi eux, quelques-uns ont lu mes textes, ça nourrit les échanges et ça me permet d’aller encore plus loin. Ce qui est plus rude que le monde des malades, c’est l’environnement médico-administratif ! »
« Si on peut avoir l’impression de réaliser certains de nos rêves, tant mieux. Mais les vrais rêves sont presque toujours irréalisables. Sans le contact avec l’imagination et l’imaginaire, la vie serait intolérable pour tout le monde. C’est intolérable quand la mort frappe à 30 ans ; quand à 60 ans, on se retrouve devant rien. On est toujours proche de l’intolérable. Une des fonctions qui rendent la vie tolérable, c’est la possibilité de rêver. Des fois, la vie rêvée est plus réelle. J’ai tendance à me sentir extrêmement à l’étroit dans toute forme de réel. J’apprécie beaucoup la mouvance dans ma vie, le voyage entre le Sud et le Nord, entre l’écriture et la réalité. Si cette vie-là ne puise pas dans les zones de rêve, avec suffisamment de constance, c’est comme si j’étais toujours confronté à rien, au néant. Et le monde dans lequel on vit me semble plus que jamais confronté au néant. Il n’y a rien de mieux que d’être pendant six mois aux prises avec le blizzard ou le caribou ! »
Le fantastique, un lieu de jonction
Un autre recueil de six nouvelles, Un dernier cadeau pour Cornélia (1989), plonge au-delà du réel, dans le fantastique. Une plante carnivore entre par la fenêtre et mange le corps de Jean-Paul. Un homme accumule, toute sa vie durant, les accidents et les maladies de toutes sortes, mais n’est pas plus heureux, une fois mort et enterré. Après les funérailles de son mari, Cornélia sort une bouteille où baigne un nez, une autre contient une oreille, d’une troisième sortent deux mains qui caressent son corps, la langue dansera sur le tapis du salon !
« Le fantastique comme genre littéraire, c’est une espèce de porte d’entrée entre l’univers du rêve et l’univers du réel. Le fantastique a son point de départ dans la réalité, c’est un lieu de jonction ; c’est un lieu comme au-delà du réel, c’est la quatrième dimension. Le genre d’ailleurs permet des échappées dans des univers qui ne sont pas si irréels puisqu’ils nous habitent. C’est un lieu privilégié où l’on a accès au rêve. »
La poésie, autre lieu privilégié du rêve
« Le lieu poétique m’apparaît être le lieu par excellence où l’inconscient et le conscient parfois se touchent. Ce n’est pas l’inconscient qui devient conscient. Ce qui nous émeut en poésie ce n’est pas ce que l’on comprend. On pressent intuitivement et irrationnellement que quelque part il y a un univers autre auquel on est appelé, qui est de l’ordre de l’inconscient cosmique. C’est là que tout poète essaie d’arriver. En lisant Rilke, je sens que je participe, que je comprends ; c’est de l’ordre du religieux et du mystique, mais il y a contact avec ce que je pressens en moi. J’ai l’impression que c’est ça qui me tient en littérature. »
L’amour du Nord, un rêve d’enfance
« Le Grand Nord est un monde auquel j’ai aspiré longtemps ; j’en ai rêvé dans la cour de mon enfance. Lorsque je m’y retrouve, c’est comme si j’avais accès à un espace où tout à coup je suis libre de laisser voguer et mes émotions et mon sentiment d’appartenance au monde, de m’abandonner à une espèce de jouissance face à l’air et au silence, dans une société, primitive à certains égards. C’est aussi le lieu où je sens que je peux encore gagner ma vie comme médecin. Il me semble que là je suis utilisé à juste escient, je sens cela dans mes contacts avec les sages-femmes par exemple. C’est aussi un pays qui m’éblouit, comme aucun autre pays ne m’a jamais ébloui. Je n’arriverai jamais à passer à travers ce pays-là et je suis très content d’avoir tant travaillé à mon dernier livre, Ô Nord, mon amour. Donner un cours au cégep ou parler en public demande un certain talent. Mais pour écrire, il faut travailler très fort. C’est douloureux d’aller dans les chemins où l’on se sent obligé d’aller ! Pour la première fois, j’ai un peu le sentiment d’avoir pu amener des gens, que je les connaisse ou pas, dans un lieu qui est le mien. Avant, ce que j’écrivais était de l’ordre de l’apprentissage et dépendait d’un million de contingences. Pour la première fois, j’ai pu un peu, oui un petit peu, faire partager, non pas ce qu’intellectuellement et rationnellement je vis dans le noir, mais ce qu’émotivement je vis dans le noir. Évidemment ça passe par le langage, par des mots pas trop compliqués ; la joie partagée de méditer avec des mots parfaitement appropriés au Grand Nord, des mots comme igloo ou kayak, tellement plus jolis que canot ; dès qu’on entend le mot tuktu par exemple, il fait plus caribou que caribou pour quiconque a senti les tuktus galoper dans la toundra. Les langages existent parce qu’ils disent, à leur manière, géographiquement et culturellement, ce que sont les choses pour les gens qui les ont inventés. C’est pour ça que la poésie, c’est difficilement traduisible ! »
L’Esprit ou Dieu au bout de soi-même
Le « désert nordique », cette absence d’agitation hystérique qui est l’agitation des grandes villes, contribue à une mise en situation qui mène au divin. Même s’il est vrai qu’on peut trouver Dieu en toute circonstance.
« Au Grand Nord, je suis moins bousculé par le temps, par les circonstances, et aussi par des éléments qui m’agressent au point de me rendre odieux. Cette passion du Nord, c’est la contrepartie à des moments de profonde lassitude, dans lesquels j’étouffe littéralement. Participer à l’activité de la ville, dans une espèce de tourbillon sur lequel je n’ai aucun contrôle, cela m’enlèverait les moyens spirituels nécessaires au travail en littérature. Je suis en conflit avec un univers qui est celui de mon enfance, mais ce qui s’annonce pour l’avenir ne me plaît pas beaucoup. À certains moments, je n’ai vraiment pas envie de continuer d’y participer.
« De façon très sensible et très lucide, le monde de la poésie a plus que jamais un rôle à jouer contre l’agitation des médias, la profonde hystérie qui fait qu’on se noie dans le pareil et qu’on s’éloigne à toute vitesse de l’être. J’ai l’intime conviction que les médias sont l’instrument d’une grande maladie collective.
« Notre monde n’a pas encore contrôlé son environnement… Et si aucun Inuit ne voudrait revenir aux années 50 ni retourner vivre dans un igloo, il y a en même temps, dans ce non-contrôle relatif sur l’environnement, un espace qui oblige à plus de paix. J’aime affronter le froid et le blizzard, parce que ça m’oblige à plus de paix intérieure. Dans notre rapport avec la nature, c’est un privilège de pouvoir la combattre. »
La littérature n’est pas un jeu
« L’écriture me lie au monde de l’art. Les artistes, malgré leurs difficultés, leurs défauts, leurs névroses parfois, forment le groupe le plus tolérant et le plus ouvert au monde ; plus leur apparence est fragile, plus leur âme apparaît nue, fraîche, surtout pas conventionnelle. J’ai beaucoup de joie à les côtoyer. Laissé à moi-même, j’aurais tendance à faire avec l’écriture ce que je fais avec ma vie, me lancer dans l’aventure, rêver de projets, les réaliser, y emmener les autres avec moi puis passer à autre chose. Travailler avec d’autres m’oblige à plus de rigueur. La collaboration avec les éditions du Loup de gouttière me pousse en avant, toujours un peu plus loin, avec chacun des textes nouveaux. J’ai la conviction que je suis maintenant arrivé à une qualité relative dans l’écriture. Je n’y suis pas encore arrivé dans l’aventure extérieure. Qualité d’être et qualité d’écriture, tout ça va ensemble. Si on ne plonge pas plus loin dans son être, on ne peut pas aller très loin en littérature. Ne pas se contenter de raconter des histoires. Être capable d’exprimer ce que les autres ressentent et le dire avec suffisamment de clarté et d’éloquence pour que chacun s’y retrouve. C’est beaucoup de travail que d’arriver à peaufiner un texte ! Ô Nord, mon amour va plus loin que Kavisilaq (1992), c’est évident. Si j’avais été seul en jeu, j’aurais augmenté le nombre de manuscrits et j’aurais moins peaufiné. Mieux écrire, c’est monter un escalier à genoux ! Je sais par contre que dans ma vie, il y a des états que je n’atteindrai que par l’écriture. Et chez certains lecteurs, j’ai peut-être activé la possibilité de rêver, et mené à l’espèce d’envol qu’ils souhaitaient. Si la littérature n’était qu’un jeu, je pense que ce serait un jeu bizarre et ce jeu ne m’intéresse pas. »
Jean Désy a publié :
L’aventure d’un médecin sur la Côte-Nord, Trécarré, 1986 ; Pour moi…la mer…, Le palindrome, 1988 ; Un dernier cadeau pour Cornélia, XYZ, 1989 ; Urgences, récits et anecdotes, Un médecin raconte, La liberté, 1990 ; Miction sous les étoiles, Le palindrome, 1990 ; La rêverie du froid, La liberté/Le palindrome, 1991 ; Baie Victor, Septentrion/Pélican, 1992 ; Kavisilaq, Impressions nordiques, Loup de gouttière, 1992 ; Voyage au nord du Nord, Loup de gouttière, 1993 ; La saga de Freydis Karlsevni, l’Hexagone, 1995 ; Docteur Wincot, Loup de gouttière, 1995 ; L’espace Montauban, Le dernier roman scout, La liberté, 1996 ; Lettres à ma fille, Loup de gouttière, 1997 ; Ô Nord, mon amour, Loup de gouttière, 1998.