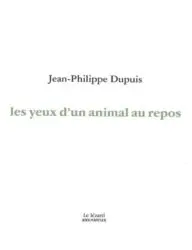Né à Montréal en 1966, Jean-Philippe Dupuis est cinéaste et poète. Cinéaste, il a remporté, en 2011, le Prix du meilleur film canadien pour Saint-Denys Garneau, au Festival international du film sur l’art (FIFA) de Montréal. Poète, il a fait paraître, depuis 1999, quatre recueils, dont Langue maternelle, finaliste aux prix littéraires du Gouverneur général en 2014.
Les yeux d’un animal au repos, son plus récent livre, évoque l’enfance et ses jeux, la nature, les premiers remous de l’amour mais aussi la présence de la mort. Le regard du poète est celui des commencements. Chez Dupuis, l’écriture semble jouer le même rôle que la caméra : elle nous fait voir le monde. Rencontre avec un poète discret et attentif à la fragilité des êtres.
Michel Pleau : Pour commencer, je vous propose l’exercice, pas si facile, mais parfois très évocateur, de faire une sorte d’autoportrait.
Jean-Philippe Dupuis : Comme autoportrait, je pense à une œuvre peinte. Avec un peu d’invention. Comme un peintre repasse sur un trait. Une toile qui remonte à bien longtemps et qui en réalité n’existe pas. J’ai seize ans, je suis assis à ma table et je tiens dans ma main la plume-fontaine de mon père. Une Parker en argent. Une plume d’homme d’affaires. Je porte des lunettes, une chemise appartenant à mon frère. Je suis gaucher. J’ouvre un cahier. On devine que c’est le premier.
J’ai longtemps écrit avec la plume-fontaine de mon père. Les cartouches d’encre noire, bleue, et verte. Ce vert foncé incroyable. Du temps de mon film sur Garneau, j’ai pu feuilleter, avec des gants blancs, les cahiers de son journal conservé dans les archives de la bibliothèque nationale, à Ottawa. Parfaitement émerveillé, je suis tombé sur des pages écrites avec la même encre verte. C’est un signe, m’étais-je dit.
Ce sont souvent des souvenirs qui remontent à la surface quand on cherche à se définir. C’est peut-être là le rôle principal de l’écriture, un travail qui permet la découverte de soi.
P. : Qu’est-ce qui est à l’origine de votre désir d’écrire ? Et pourquoi écrire de la poésie ? Comment est arrivée cette présence dans votre vie ?
J.-P. D. : Les premiers poèmes sont influencés par des livres d’importance pour moi, comme Le calepin d’un flâneur de Félix Leclerc et Les Pavés secs de Jacques Godbout.
Je n’ai jamais écrit avec confiance, avec un plan bien défini, avec méthode. La langue souvent faisait défaut. Je n’étais pas très fort en français. Mais j’écrivais. La forme brève est venue spontanément, naturellement.
Et j’accorde depuis ce temps beaucoup d’importance au poème. Ça n’a rien de facile.
Comme je suis une personne éparpillée intellectuellement, si je puis dire, qui s’intéresse à tout, qui a des goûts éclectiques, l’écriture me permet de me centrer, de mettre de l’ordre dans ce que je crois être. Il y a une dimension autobiographique bien présente dans mes poèmes. Sans doute un peu trop marquée dans le dernier recueil.
J’écris sans doute pour me donner de la chair, de la consistance, parce que j’ai souvent le sentiment d’être sans substance, simplement une présence effacée. J’ai longtemps senti cela dans ma jeunesse, et c’est encore aujourd’hui un sentiment qui m’habite parfois, bien que je sois père de quatre enfants, en couple avec C. depuis plus de trente ans. Une partie de notre personne n’a pas d’identité. Comme une partie flottante, étonnée d’être là. Et c’est de ce lieu intime que naît le poème.
Je me demande parfois pourquoi j’écris. On n’y pense pas, et puis soudainement on est pris au piège. Pourquoi écris-tu ? C’est un mystère. J’ai l’impression d’avoir toujours écrit. Cela a commencé par la notation de chiffres, puis de nombres sur des feuilles. Ma grand-mère maternelle m’a un jour parlé de mon grand-père, que je n’ai jamais connu. Il était directeur de crédit. Elle me disait qu’il étudiait de grands livres comptables aux pages vert pâle couvertes de colonnes de chiffres ; elle faisait ce geste admirable dans l’air devant moi : son doigt glissait le long de la page, s’arrêtait sur un nombre puis poursuivait jusqu’au bas. J’ai commencé à mon tour, peu de temps après, à tracer sur des feuilles des colonnes de chiffres. Je me suis rendu dans les dix mille… Je ne sais pas pourquoi je faisais cela. J’aimais certainement le geste lui-même. Écrire.
J’ai toujours lu. J’ai souvent un livre sur moi. Plus jeune, j’en avais toujours un dans mes poches. Adolescent, je me souviens avoir hésité à en glisser un dans mon sac de hockey avant de me rendre à pied à l’aréna. Je me disais : je pourrai lire un passage sur le banc, entre deux shifts. Mais bon, là, j’exagérais…
C’était un peu comme le cellulaire aujourd’hui pour plusieurs, toujours le nez fourré dedans, le matin dans le métro que je prends pour me rendre au travail. Mais la lumière qui montait des pages était autre que celle des écrans…
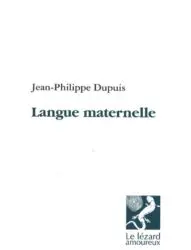 Mais on n’a pas toujours en soi ou sur le bout des doigts les mots qui permettent ces lentes plongées en nous-même. Et quand je parle de lentes plongées, ça n’a rien d’exceptionnel. On fait tous ça. On est à la fois dans la lune et attentif à ce que nous sommes.
Mais on n’a pas toujours en soi ou sur le bout des doigts les mots qui permettent ces lentes plongées en nous-même. Et quand je parle de lentes plongées, ça n’a rien d’exceptionnel. On fait tous ça. On est à la fois dans la lune et attentif à ce que nous sommes.
C’est aussi tracer les mots avant que le sens se fige, s’échappe. C’est la tentative d’une définition de soi. Comme une lettre à soi dans l’avenir. Tu ne me liras peut-être pas, mais je t’écris quand même, à toi qui n’es pas encore. À la promesse de soi. C’est marquer, griffer un tronc, graver la surface d’un pupitre. C’est certainement laisser une trace.
Et j’ai de la difficulté à me définir poète ou cinéaste. On n’est pas poète tous les jours. C’est davantage un état dans lequel on se trouve et qui nous pousse vers un crayon et une feuille ou dans le bloc-notes de notre cellulaire. Je ne peux pas m’en sortir. Ça peut venir à tout moment, mais cela n’occupe pas beaucoup de mon temps.
Je crois que c’est la fragilité des êtres qui me fait écrire, la vulnérabilité. Et l’écriture est une ouverture vers ces personnes. Comme je l’ai écrit dans un poème : on voudrait s’ouvrir et tout dire d’un coup. Mais comme dit Paul Auster : « [I]t’s rare when others are willing to listen to you in everyday life ». Alors on écrit pour soi et on se cache dans un texte qui nous fait du bien, et on pense que cela fera du bien à quelqu’un qui le lira en silence. On parle à quelqu’un quand on écrit…
Nous vivons dans un monde violent. La destruction, la méchanceté, l’insensibilité de l’homme, les guerres de territoires, les intimidations de toutes sortes, les inégalités, oui, j’en suis conscient. On a les deux pieds dedans en permanence ; les médias en particulier nous envoient tout ça à coups de claques au visage. Mais je ne veux pas oublier la beauté de la nature, des animaux, de l’enfance dans nos gestes, des sourires spontanés. L’émerveillement devant tout ça est toujours nouveau, je ne m’y habitue pas. Tout cela est bien présent et je cherche à me rapprocher de ces forces. Je me tourne naturellement vers le bon côté des choses. C’est en ce sens que l’ouverture de l’enfance vient me protéger.
P. : Vous êtes également cinéaste. Je vous ai d’abord connu grâce au visionnement, lors du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, de votre très beau documentaire sur les dernières années de Saint-Denys Garneau. Quel a été l’impact, dans votre écriture, de cette fréquentation de l’œuvre du poète ?
J.-P. D. : La poésie de Garneau est, pour moi et pour plusieurs, une présence familière. J’y reviens depuis l’adolescence, depuis plus de 40 ans. Des vers, quand je m’en éloigne, remontent au hasard : « Je préfère avoir tout perdu ; Le pas étrange de notre cœur ; On n’avait pas fini de ne plus se comprendre ; Nous allons détacher nos membres ». Il y a aussi les lettres à ses amis et son journal. Une vivacité, un humour parfois étonnant. Si je le lis encore aujourd’hui, c’est simplement pour être avec lui. Sa poésie, sa voix est devenue avec les années une présence amicale, la parole d’un grand frère ou d’un grand-oncle disparu trop tôt. Sa poésie est le témoignage d’un profond amour de la nature, une complexe leçon d’humilité, un exemple de persévérance, de force. Cela est très inspirant. Il y a aussi les photographies que nous connaissons de lui, et les photographies récentes trouvées dans un fonds d’archives. Il y a là-dedans des images filmées de Garneau. Tournées par son ami Georges Beullac. La pellicule existe toujours. On le voit dans un salon avec des amis. Il est là, il bouge et on le voit rire. Comment ne pas vouloir s’asseoir à ses côtés, dans ce salon, les boiseries, la tapisserie sur les murs. Des détails si familiers. La maison de nos grands-parents. Borges a écrit quelque part que « chaque écrivain laisse deux œuvres. L’une est son œuvre écrite et l’autre, peut-être la plus importante, est son image ».
Il y a dans mon dernier recueil une sorte d’abandon, d’ouverture qui me vient peut-être de Garneau.
P. : Dans Les yeux d’un animal au repos, vous tournez votre regard, j’allais dire votre caméra, vers l’enfance. On pense aux Regards et jeux dans l’espace. La poésie est-elle possible sans l’enfance ?
J.-P. D. : La poésie est possible sans l’enfance. Oui. Mais si on considère l’enfance comme un premier regard, alors non, la poésie n’est pas possible sans elle. Philippe Delerm a écrit un livre intitulé Écrire est une enfance. C’est un beau titre. Pour moi, l’enfance est souvent un point de départ. C’est vrai.
P. : Outre l’enfance, on remarque dans vos poèmes la présence de la mort, mais aussi l’évocation sensible des premières amours et de la nature. Pouvez-vous nous parler de l’histoire de votre recueil ?
J.-P. D. : La publication du recueil m’a fait un bien énorme. Il y avait en moi depuis des années une série de nœuds que je gardais cachés, de nombreuses peines. On écrit des textes, on les oublie, ils refont surface. On y retourne avec des mots de plomb, on descend jusqu’à nous et on retravaille. En souhaitant laisser intacte l’émotion première. Puis on entend un jour une voix nous dire tout bas : « Bon, OK, open up, stand straight, let it go… » Dans mon cas, cette voix impérative me vient souvent en anglais. Il y a dans ce livre de nombreuses peines, certaines camouflées et d’autres laissées volontairement nues. Comme après avoir pleuré un bon coup. Je ne veux pas trop m’étendre là-dessus.
P. : Quelle est votre famille poétique ? Autrement dit, parlez-nous des poètes que vous aimez.
 J.-P. D. : Je ne sais pas si on peut parler de famille. Je lis en somme peu de recueils de poèmes. Il y a des poètes vers qui je retourne souvent. Il y a Jean Follain que j’admire, Saint-Denys Garneau bien sûr, François Charron, José Acquelin, par exemple son recueil L’oiseau respirable. Des ailes nous poussent dans le dos, on sent l’air autour de nous. Les poèmes de Borges. Le recueil L’homme approximatif de Tristan Tzara ; j’ai toujours l’exemplaire acheté usagé au début de la vingtaine, un « Poésie Gallimard » de poche un peu, pas mal, jauni. Une poésie où tout est remis à zéro. Le recueil de Gérald Leblanc, Le plus clair du temps. J’aime les poèmes de Seamus Heaney, la sonorité, la musique de sa voix irlandaise. Philip Larkin. Et je ne parle pas des romanciers. Le Grand Meaulnes, d’Alain-Fournier…
J.-P. D. : Je ne sais pas si on peut parler de famille. Je lis en somme peu de recueils de poèmes. Il y a des poètes vers qui je retourne souvent. Il y a Jean Follain que j’admire, Saint-Denys Garneau bien sûr, François Charron, José Acquelin, par exemple son recueil L’oiseau respirable. Des ailes nous poussent dans le dos, on sent l’air autour de nous. Les poèmes de Borges. Le recueil L’homme approximatif de Tristan Tzara ; j’ai toujours l’exemplaire acheté usagé au début de la vingtaine, un « Poésie Gallimard » de poche un peu, pas mal, jauni. Une poésie où tout est remis à zéro. Le recueil de Gérald Leblanc, Le plus clair du temps. J’aime les poèmes de Seamus Heaney, la sonorité, la musique de sa voix irlandaise. Philip Larkin. Et je ne parle pas des romanciers. Le Grand Meaulnes, d’Alain-Fournier…
P. : Et si vous aviez à définir la poésie ?
J.-P. D. : Tenter de définir ce qu’est la poésie est un exercice difficile. On peut se retrouver coincé à dire n’importe quoi, ça peut partir dans toutes les directions. C’est un état d’attention au monde. C’est un style, une façon de voir. C’est un premier regard qui trouve ses propres mots. Ce n’est plus une chose qu’on entend distraitement ; on est à l’écoute, attentif. Et le poème est un moment figé dans une capsule.
Le poème est souvent un instantané, un premier jet rapide où les mots forment un chemin rapide vers l’image. Et parfois la syntaxe prend le bord. On écrit de peur d’oublier, on fait sauter les virgules comme on arrache des petits clous. La langue se comprime, des shortcuts se forment pour aller à l’essentiel. On a les mots avec soi, la couleur, les sons, la forme des lettres sur la feuille.
C’est un état d’éveil qui monte en nous et nous pousse vers la création. Et par l’écriture, dans la pleine lumière des mots, on peut être là à nouveau sans trop fausser la réalité. On est là précis entre les mots, à la surface des mots. Retourner à ce présent éternel de l’enfance, à cette énigme, où tout est, à la fois, perpétuellement enregistré et oublié. Comme un présent numérisé, aussitôt oublié.
P. : Comment imaginez-vous votre poésie à venir, mais aussi l’avenir de la poésie ?
J.-P. D. : Difficile de me prononcer sur les écrits à venir. Je ne travaille pas de nouveaux poèmes depuis la parution du dernier recueil. Je tourne en rond. J’ouvre et ferme des dossiers dans mon ordinateur. Je fouille, à la recherche d’un poème oublié, qui viendra m’allumer. Je dois dire que c’est de plus en plus en mouvement que le poème se précise. Comme si je devais m’éloigner, jouer à l’innocent, feindre je ne sais quelle occupation, m’arranger pour détourner l’attention de la personne qui m’observe, cette personne étant moi. Me fuir. Et j’ai parfois le sentiment que je vais me tourner vers la fiction, si j’en trouve le souffle. Pour me distancer de l’autobiographie, quand même assez présente dans mes poèmes. Ce qui est une illusion bien sûr, tout écrit étant en grande partie autobiographique. La question demeure : comment me suis-je rendu jusqu’ici ?
Jean-Philippe Dupuis a publié :
Les yeux d’un animal au repos, Le lézard amoureux, Montréal, 2023, 78 p.
Langue maternelle, Le lézard amoureux, Montréal, 2014, 51 p.
Table de nuit, Triptyque, Montréal, 2004, 72 p.
Attachement, Triptyque, Montréal, 1999, 76 p.
EXTRAITS
ma voisine à l’automne dans sa cour arrière
a brûlé dans un baril ses cahiers d’adolescence
des flocons noirs de papier montaient avec la boucane
pour retomber ailleurs en papillons calmes
je voyais dans ses yeux les agrafes rouges
sur le point de fondre en larmes
Les yeux d’un animal au repos, p. 9.
Retrouvé dans une boîte à gants
Le premier vers d’un poème à venir
Sur l’emballage d’une ampoule longue vie
Langue maternelle, p. 5.
dans ta voix se mêlent des temps incomplets
lourds comme des poches de linge
Les yeux d’un animal au repos, p. 8.