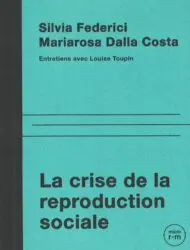Dans la collection « micro r-m » du Remue-ménage, nous trouvons quatre titres. Il s’agit de textes assez courts, dont le petit format devrait faciliter la diffusion.
Le travail ménager
Le féminisme italien a une longue histoire. Louise Toupin, professeure et chercheuse montréalaise spécialisée en études féministes, avait déjà publié des entretiens avec deux de ses figures marquantes en 2014 dans son livre Le salaire au travail ménager. Chronique d’une lutte féministe internationale (1972-1977).
Toupin s’entretient d’abord avec Mariarosa Dalla Costa. Cette dernière est l’auteure de Potere femminile et sovversione sociale (Le pouvoir des femmes et la subversion sociale), qui a eu un grand impact dès sa parution en 1972. Elle y défendait la thèse que le travail ménager non payé des femmes sert en fait d’exploitation capitaliste. Ce travail est nécessaire pour la reproduction sociale, qu’elle s’incarne dans le soin apporté au travailleur salarié, le plus souvent le mari, ou dans le soin apporté à de futurs travailleurs, les enfants. « On peut donc dire que le capital, dans la famille, à travers le salaire du mari, commande le travail de l’épouse à la maison. »
Le deuxième entretien a lieu avec Sylvia Federici. Née à Parme, elle est devenue professeure en sciences sociales à l’Université Hofstra (Hempstead, New York). Elle a milité, au sein du Collectif féministe international, pour le salaire au travail ménager. Cette expérience lui a permis d’élargir cette lutte aux revendications de réappropriation de la terre, de l’eau, des forêts, de l’agriculture, bref, tout ce qui touche la production de nourriture. « Il ne s’agit pas de demander seulement que le travail ménager soit payé, mais aussi de réclamer que d’autres moyens de reproduction soient moins sujets aux manipulations monétaires ; des maisons, des services de santé, des espaces communautaires […] »
Suicide et assassinat
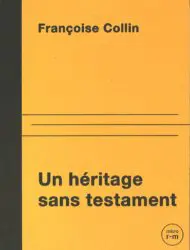 Dans Un héritage sans testament, la romancière et philosophe Françoise Collin nous fait part de la difficulté d’écrire sur l’histoire des femmes. En fait, ce qui l’intéresse, ce n’est pas tant l’histoire comme telle, qui pourrait se contenter de répertorier les femmes célèbres et influentes, mais l’affiliation, ce qui est transmis d’une génération de féministes à l’autre. « Les jeunes femmes d’aujourd’hui sont en mesure d’accueillir un héritage qui ne soit plus une fatalité, mais un donné à interpréter. »
Dans Un héritage sans testament, la romancière et philosophe Françoise Collin nous fait part de la difficulté d’écrire sur l’histoire des femmes. En fait, ce qui l’intéresse, ce n’est pas tant l’histoire comme telle, qui pourrait se contenter de répertorier les femmes célèbres et influentes, mais l’affiliation, ce qui est transmis d’une génération de féministes à l’autre. « Les jeunes femmes d’aujourd’hui sont en mesure d’accueillir un héritage qui ne soit plus une fatalité, mais un donné à interpréter. »
Les femmes, bien qu’elles aient été historiquement dominées par les hommes, ont agi. C’est cet agir que Collin veut mettre en lumière : « [A]gir et pouvoir ne s’identifient pas l’un à l’autre ». Par-delà des figures majeures comme de Beauvoir ou Veil, il importe d’inscrire les femmes comme co-actrices dans la grande Histoire. L’histoire des femmes est donc à distinguer de l’histoire des féministes. Si on se contentait de mettre en relief uniquement ces dernières, on répéterait les structures de domination pourtant décriées.
Promenade sur Marx. Du côté des héroïnes, de Valérie Lefebvre-Faucher, nous entraîne dans la famille du fondateur du communisme et rappelle ce que Marx doit à toutes les femmes qui l’ont entouré de près. Lefebvre-Faucher remarque d’abord que, non seulement on parle trop peu du rôle des femmes évoluant dans l’entourage des écrivains et penseurs, rôle allant bien au-delà de simples femmes à tout faire, mais que les épouses écrivaines elles-mêmes passent le plus souvent à la trappe de l’oubli. Ainsi en est-il de Suzanne Césaire, épouse d’Aimé, ou encore de Mireille Neptune Anglade, épouse de Georges Anglade. Et qu’en est-il du côté de Karl Marx ? Le communisme promulguant la lutte des classes se montre-t-il exemplaire pour la lutte des femmes ?
 Commençons avec Jenny, l’épouse de Karl. Elle est éditrice, et participe aux discussions avec tous les intellectuels et militants de passage chez les Marx. Pourtant, le livre Lettres d’amour et de combat,la correspondance entre les époux, subit un traitement sexiste. Ces lettres ne seraient pas exigeantes, aux dires d’un éditeur qui ne prend même pas la peine de traduire les citations latines employées par Jenny. Celle-ci est une grande lectrice. Elle a collaboré comme recherchiste, transcriptrice et correctrice à l’œuvre immense de Karl Marx. Elle a même enseigné quelque temps à l’université.
Commençons avec Jenny, l’épouse de Karl. Elle est éditrice, et participe aux discussions avec tous les intellectuels et militants de passage chez les Marx. Pourtant, le livre Lettres d’amour et de combat,la correspondance entre les époux, subit un traitement sexiste. Ces lettres ne seraient pas exigeantes, aux dires d’un éditeur qui ne prend même pas la peine de traduire les citations latines employées par Jenny. Celle-ci est une grande lectrice. Elle a collaboré comme recherchiste, transcriptrice et correctrice à l’œuvre immense de Karl Marx. Elle a même enseigné quelque temps à l’université.
Les filles de Marx ont elles aussi collaboré à l’œuvre du père. Laura a traduit en français le célèbre Manifeste du Parti communiste. Elle était mariée à Paul Lafargue, connu entre autres pour son Droit à la paresse. Le couple se suicidera, mais « en laissant aux historien(ne)s un doute gênant sur ses intentions à elle ». Plusieurs pages seront consacrées à Eleanor, la cadette, une brillante intellectuelle, féministe, militante socialiste et légataire littéraire de Marx mais également de Engels. Elle se suicide à 43 ans et, pour elle aussi, des questionnements sont soulevés. Le fait que son conjoint était un homme violent n’a-t-il pas joué un rôle dans cet acte ultime ?
Enfin, dans Althusser assassin. La banalité du mâle, Francis Dupuis-Déri, professeur en science politique à l’UQAM, souligne la responsabilité du philosophe marxiste français Louis Althusser dans la mort de son épouse, la sociologue Hélène Rytmann (ou Legotien, d’après son nom de résistante). Sauf que Louis Althusser, aidé en cela par de nombreux soutiens venant de l’intelligentsia, a pu bénéficier d’une grande clémence. Dans la foulée de cet acte répugnant, c’était à qui ne fournirait pas « l’explication la plus sophistiquée, jargonneuse et abstraite ».
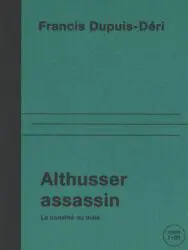 Althusser aurait été atteint d’une forme de folie passagère et, de ce fait, ne pouvait être emprisonné à titre d’assassin. C’est tout juste s’il fut interné quelque temps dans un hôpital psychiatrique. Dupuis-Déri s’inscrit en faux contre le traitement de faveur accordé à cette figure intellectuelle. On a fait jouer les explications psychologiques pour le déculpabiliser. Selon la psychologue Patrizia Romito : « La psychologisation est […] en substance, une tactique de dépolitisation, chargée de maintenir le statu quo et de renforcer le pouvoir dominant. […] Psychologiser peut servir aussi à décriminaliser telle action ». Ainsi s’opère un renversement sournois : Althusser devient une victime et la vraie victime devient responsable puisqu’elle a provoqué l’ire de l’assassin. Il l’aurait même « suicidée par générosité », puisque Hélène Rytmann n’aurait pas tant tenu à la vie. Contre ces égarements, Dupuis-Déri rappelle que la France connaît un taux élevé de féminicides, que la sociologue avait clairement signifié à Althusser son intention de le quitter et qu’Althusser lui-même, dans son autobiographie L’avenir dure longtemps, avoue user de violence et se considère comme un « propriétaire de femmes » dont il voulait même se constituer une « réserve ».
Althusser aurait été atteint d’une forme de folie passagère et, de ce fait, ne pouvait être emprisonné à titre d’assassin. C’est tout juste s’il fut interné quelque temps dans un hôpital psychiatrique. Dupuis-Déri s’inscrit en faux contre le traitement de faveur accordé à cette figure intellectuelle. On a fait jouer les explications psychologiques pour le déculpabiliser. Selon la psychologue Patrizia Romito : « La psychologisation est […] en substance, une tactique de dépolitisation, chargée de maintenir le statu quo et de renforcer le pouvoir dominant. […] Psychologiser peut servir aussi à décriminaliser telle action ». Ainsi s’opère un renversement sournois : Althusser devient une victime et la vraie victime devient responsable puisqu’elle a provoqué l’ire de l’assassin. Il l’aurait même « suicidée par générosité », puisque Hélène Rytmann n’aurait pas tant tenu à la vie. Contre ces égarements, Dupuis-Déri rappelle que la France connaît un taux élevé de féminicides, que la sociologue avait clairement signifié à Althusser son intention de le quitter et qu’Althusser lui-même, dans son autobiographie L’avenir dure longtemps, avoue user de violence et se considère comme un « propriétaire de femmes » dont il voulait même se constituer une « réserve ».
À la fin d’Althusser assassin, Francis Dupuis-Déri s’étonne qu’on s’intéresse encore à la philosophie de l’assassin. « Peut-on séparer l’auteur de son œuvre ? » se demande-t-il avec raison. De toute évidence, Dupuis-Déri pense que non. Sa démonstration ne va cependant pas très loin. Il est d’avis que fréquenter ce genre d’œuvre s’avère utile pour débusquer les racines du mal et que, de toute façon, il y a bien d’autres choses à lire aussi.
Titres parus dans la collection « micro r-m » de la maison d’édition montréalaise Le remue-ménage :
Silvia Federici, Mariarosa Dalla Costa, La crise de la reproduction sociale. Entretiens avec Louise Toupin, 2020, 88 p.
Françoise Collin, Un héritage sans testament, 2020, 64 p.
Valérie Lefebvre-Faucher, Promenade sur Marx. Du côté des héroïnes, 2020, 80 p.
Francis Dupuis-Déri, Althusser assassin. La banalité du mâle, 2023, 96 p.
EXTRAITS
Ou les femmes vont travailler à l’extérieur en renonçant à avoir des enfants […] Ou les femmes qui ont des enfants vont travailler à l’extérieur en s’appuyant soit sur l’aide gratuite d’autres femmes, proches généralement, soit en payant d’autres femmes pour exécuter une partie du travail ménager.
Mariarosa Dalla Costa
Il est vrai que la structure de domination d’un sexe sur l’autre à travers les âges et les cultures a freiné l’agir des femmes. Mais il est vrai aussi que leur agir, même quand il était réel, a été sous-évalué dans la mesure où il se traduit peu en termes de pouvoirs.
Françoise Collin
Si Jenny a participé à la réflexion féministe dans le groupe des Marx, ses textes laissent penser que c’était avec amertume. C’est une femme rompue par les drames, notamment trois morts d’enfant, qui en vient à souhaiter que ses filles restantes échappent au mariage.
Valérie Lefebvre-Faucher
Devant pareil charabia frivole et pompeux, on se perd en conjectures quant aux qualifications des responsables du travail éditorial chez Gallimard.
Francis Dupuis-Déri