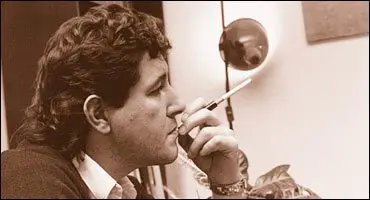C’est à Paris, à quelques pâtés de maisons du périférique, que j’ai rencontré l’auteur de Néons, de Suzanne et de Képas, trois romans qui sont malheureusement passés inaperçus au Québec.
Pourtant l’écriture de Denis Belloc ne peut laisser personne indifférent. Elle choque. Elle brise le confort bourgeois dans lequel la littérature française se complaît depuis plusieurs années. Ici, pas de guimauve, pas de fleurs bleues. Ici, la littérature se poudre les sinus, et fait la rue.
Avant de parler livres, j’ai voulu parler peinture avec Denis Belloc. Dans ses romans – qui sont à haute teneur autobiographique – il explique que son premier geste de création a été non pas l’écriture mais le dessin, puis la peinture. « C’est comme je l’ai décrit dans mes livres. C’est un don. Ma mère aussi avait ce don. Elle n’a jamais appris à dessiner et pourtant elle dessine très, très bien. Moi aussi j’ai toujours su dessiner ; je n’ai aucun mérite. Pour la peinture, c’est différent, c’est plus compliqué que le dessin ; on doit l’apprendre. » On n’exprime pas la même chose en peignant qu’en écrivant un roman « même s’il y a forcément un lien entre ces deux formes d’expression. Malgré tout, je peux dire que j’ai réussi à m’exprimer par la peinture. Je n’ai jamais reproduit de paysages, et les petites fleurs ou les natures mortes ne m’intéressent pas. Lorsque je peins, j’exprime ma réalité, ma réalité à moi. Mais je me suis rapidement rendu compte que je ne pouvais pas tout exprimer par la peinture. On ne peut pas raconter une histoire en peinture car elle n’autorise que des fragments. On ne peut que raconter un moment d’une histoire, pas une histoire complète. »
Cette frustration a-t-elle conduit Belloc à l’écriture ? « Ce n’est pas la peinture qui m’a amené à écrire. Ça n’a rien à voir. Mon besoin d’écrire est venu subitement. Je n’avais jamais écrit et je n’avais jamais pensé écrire avant de subir un choc affectif. Il a fallu que j’expulse ce que je vivais et ça je ne pouvais le faire que par l’écriture. J’ai cependant hérité de la peinture ma manière d’écrire par flashes. »
Dessin, graffitis, littérature
À lire les romans de Belloc on se demande si son art n’a pas à voir avec le graffiti, ce cri de la plume. « Pour mon premier bouquin, Néons, je pourrais peut-être parler de graffitis. C’est vrai que j’y ai lâché l’écriture comme on lâche un graffiti sur un mur. »
« On peut aussi parler de cri pour Suzanne, mon deuxième roman. En fait, après Néons, j’ai découvert que ce cri que je venais de lâcher était aussi un mode d’expression extraordinaire. On peut tout dire, on peut tout faire dans un roman. On peut se faire très mal aussi en écrivant, beaucoup plus qu’en peignant. En peinture, la souffrance ne dure pas très longtemps ; elle dure le temps d’une toile, alors que l’écriture ça habite, ça fait mal et surtout, c’est plus long. »
Écrire pour s’en sortir
« Je ne me suis jamais demandé si j’étais un écrivain. Je n’ai pas l’impression de vivre l’écriture, je vis plutôt un mode d’expression ; mais de là à me dire écrivain ! D’abord, ça veut dire quoi être écrivain ? Ça veut dire prendre un crayon et écrire. Mais derrière le mot écrivain je ne vois pas grand-chose sinon la volonté de s’exprimer. L’écriture a d’abord été pour moi une sorte d’analyse, de thérapie. Ç’a été ça et plus. Si ça n’avait été qu’une thérapie, mon manuscrit serait resté dans le fond d’un tiroir. Mais j’ai voulu aller plus loin et publier. D’abord pour le mode d’expression que je trouve extraordinaire et puis je ne sais pas, pourquoi ne pas continuer ? Je voulais écrire ma réalité. Néons est un roman autobiographique. Suzanne aussi en quelque sorte c’est autobiographique. C’est l’histoire de ma mère, de mes parents et c’est quand même un peu mon histoire. Pour le troisième, Képas, c’est un peu particulier. Je dirais qu’il a plutôt valeur de document du moins je le crois. J’ai voulu l’écrire pour expulser une histoire d’amour – car Képas c’est d’abord une histoire d’amour. Je l’ai également écrit pour me libérer de la drogue. C’était ridicule, car ce n’est pas en écrivant un bouquin qu’on s’en sort. Finalement, c’est aussi la continuité de mon histoire.
« J’ai aussi voulu y expliquer ce qu’est le monde de la drogue, car je me suis rendu compte que les gens n’ont aucune idée de ce que c’est. Des lecteurs me disent parfois que ce n’est pas vrai, que j’invente ou que j’exagère dans Képas, alors que je n’ai pas dépeint la réalité dans toute son horreur parce que ça aurait été trop, ça aurait été impossible à croire ; c’est difficile d’expliquer la vie, l’univers d’un toxicomane si on ne l’a pas été soi-même ou si ceux qui nous lisent ne l’ont pas vécu eux-mêmes.
« J’ai donné Képas à des toxicomanes dans les endroits que je fréquentais quand je me fournissais. Il y a une toxicomane qui m’a remercié d’avoir écrit ce bouquin et qui m’a dit : ‘Personne ne nous avait racontés et c’est bien de l’avoir fait ; il faut que les gens sachent dans quelle galère, dans quel enfer on est’. Mais ils en parlent peu ; entre toxicomanes on ne parle jamais de ça. »
De la publicité à l’amitié
Dès ses débuts, Denis Belloc a été parrainé par Marguerite Duras. « Les grands éditeurs parisiens n’ont pas voulu de mes manuscrits. Les membres de leurs comités de lecture ont été épouvantés par mes propos. D’ailleurs il y a un grave malaise dans l’édition : les auteurs qui bousculent les idées reçues ont du mal à se faire éditer. C’est finalement une petite maison qui a accepté de publier Néons. Alors, comme le sujet semblait difficile à faire accepter tant par les médias que par le public, mon éditeur a pensé envoyer le livre à Marguerite Duras pour qu’elle le cautionne, pour qu’elle en parle dans un journal. Ce n’est pas par snobisme qu’on voulait la caution de Duras, c’était seulement pour faire passer le livre. Donc le bouquin s’est retrouvé sur son bureau. Après trois semaines, un mois, elle a téléphoné à la maison d’édition, on a pris rendez-vous, je suis allé chez elle et l’amitié a commencé là.
« On a quelque chose en commun Marguerite et moi. On a vécu beaucoup de choses similaires. Elle l’alcool, moi autre chose et l’alcool aussi. C’est également une grande solitaire Duras. Il y a une grande solitude intérieure chez elle. Puis c’est une passionnée extraordinaire. Une amante, une amoureuse. On a tout ça en commun, je crois. C’est une grande déchirée Marguerite. Ce n’est pas du tout le personnage que l’on connaît. On la connaît mal Duras. » En parlant de Marguerite Duras, Belloc vient de décrire l’essentiel de son œuvre. Ce grand déchirement, cette grande solitude intérieure, cette passion débordante, on les retrouve à chaque page de ses trois romans.
Le tour des autres
Jusqu’à maintenant Denis Belloc a donc cédé à la tentation autobiographique. Qu’en sera-t-il du prochain livre ? « Tout d’abord, je passe à une nouvelle maison d’édition, chez Julliard, une filiale des Presses de la Cité. C’est Élisabeth Gilles qui s’occupe de Julliard et c’est une femme extraordinaire. Et puis, aux Presses de la Cité ils ont quand même des moyens. Je me rends compte que les petits éditeurs c’est bien, mais comme ils n’ont pas de moyens financiers importants, ils n’ont pas toujours le punch suffisant pour imposer les bouquins qu’ils publient.
« Alors dans ce prochain roman, d’abord j’arrête de parler de moi ; ce sera une histoire de femme – mais attention, ce ne sera pas le genre – prince charmant –. Non, j’ai des choses à dire et je continue à les dire ; en fait, le regard que j’ai porté sur moi pendant trois romans, je vais maintenant le porter sur les autres. » Ça va être aussi décapant ? « J’espère que oui. »
Denis Belloc a publié :
Néons, Lieu Commun, 1987 et Balland, 1996 ; Suzanne, Lieu Commun, 1988, « Folio », Gallimard, 1990 ; Képas, Lieu Commun, 1989, Presses-Pocket, 1990 ; Les aiguilles à tricoter, Julliard, 1990 ; Les ailes de Julien, M. de Maule, 1994 ; L’ancien, Flammarion, 1994 ; Le petit Parmentier, Balland, 1995 ; Un collier de chien, Balland, 1996.