Dans L’avenir, l’autrice nous transporte à Fort Détroit, une version imaginaire de Détroit où la population aurait conservé l’usage du français. Cet entretien1 a été réalisé dans le cadre de l’édition 2021 du Festival Frye de Moncton.
Patrick Bergeron : En plus de vos activités d’écrivaine, vous êtes traductrice chez Alto. Jusqu’à quel point votre travail de traductrice est-il facilité par celui de romancière ?
Catherine Leroux : Je sais qu’il y a des traducteurs auteurs, comme Dominique Fortier, capables de faire les deux dans une journée. Elle me fascine : elle écrit le matin et traduit l’après-midi. Je n’ai pas cette énergie mentale. Je ne sais pas comment elle fait. Quand j’écris, je ne suis pas capable de traduire ; quand je traduis, je ne suis pas capable d’écrire, ce qui fait que l’un ne facilite pas nécessairement l’autre dans le partage de mon temps. En termes d’écriture, c’est sûr que l’un et l’autre s’alimentent. J’en ai déjà discuté avec mon traducteur2, et il dit que j’ai un regard particulier sur la traduction parce que je suis moi-même autrice. J’ai une empathie particulière pour les auteurs que je traduis.
P. B.: Il y a un curieux débat en ce moment autour de la traduction des poèmes d’Amanda Gorman en néerlandais. L’éditeur Meulenhoff avait confié la traduction à l’auteure non binaire Marieke Lucas Rijneveld, lauréate du prix Booker, qui a par la suite renoncé à ce travail parce que certains lui reprochaient de ne pas être noire. Quelles sont vos réflexions là-dessus ?
C. L.: Chez Alto, quand on choisit un texte à traduire, on se pose la question : « Qui serait la meilleure personne pour ça ? » Est-ce que l’éditeur se l’est posée comme il se doit ? Je ne sais pas. Si j’avais été à la place du traducteur, j’aurais probablement fait la même chose. Je sais que ce n’est pas l’opinion la plus populaire. J’ai traduit Madeleine Thien, qui est d’origine asiatique. Son livre est très ancré dans l’Asie, c’est un livre sur l’histoire de la Chine, la révolution culturelle, etc. Madeleine m’a fait confiance instantanément et je n’ai jamais eu de conversation avec elle autour de cette question : « Qu’est-ce que tu penses du fait que moi, qui suis une Québécoise blanche n’ayant jamais mis les pieds en Chine, je vais traduire ça ? » Je ne pense pas que je me désisterais de tout projet de traduction d’une œuvre écrite par une personne qui n’est pas exactement de la même origine que moi ; ça n’a pas de sens. Dans le cas d’Amanda Gorman, la nature de son travail est liée à l’oppression des personnes noires aux États-Unis, ça fait partie de l’ADN de sa poésie. Alors peut-être que c’est un facteur à considérer. On a un problème de diversité en littérature et en traduction.
P. B.: L’avenir raconte l’installation de Gloria, une sexagénaire, dans la maison de sa fille assassinée, Judith, à Fort Détroit. Gloria cherche à retrouver ses deux petites-filles, Mathilda et Cassandra, qui se sont enfuies le jour du crime. Vous dépeignez les relations intergénérationnelles de façon conflictuelle. Vous décrivez, par exemple, une bande d’enfants vivant à l’écart des adultes qu’ils craignent et haïssent à la fois. Vous montrez aussi des relations familiales tendues. Gloria a toujours eu du mal à communiquer avec Judith et celle-ci, devenue mère à son tour, n’est pas très aimante envers ses filles. Est-il difficile de dresser des ponts entre les générations ?
C. L.: Ce n’est pas ce que j’observe autour de moi. C’est sûr qu’au jour le jour, la plupart des gens s’occupent bien de leurs enfants, la plupart des enfants aiment leurs parents, il y a des conflits comme n’importe où, mais en dehors de ça, ce qu’il y a, ce sont des générations plus âgées qui perpétuent un saccage du monde qu’ils vont laisser en héritage aux jeunes. Il y a une grande violence là-dedans, une violence parfaitement quotidienne, parfaitement normalisée. Tous nos choix de société (les personnes qu’on élit, les décisions auxquelles on donne notre aval) participent à un système qui arrache le monde aux générations futures, qui les laisse avec beaucoup de problèmes à l’horizon. C’est plus là-dessus que j’ai voulu jouer en mettant les générations en opposition.
P. B.: L’avenir est une uchronie, c’est-à-dire un récit où le passé est revisité, où l’histoire diverge à partir d’un point donné. À quel moment se trouve le point de divergence ?
C. L.: C’est dans le traité par lequel Détroit a été cédé aux Américains3. Tout est dans le roman. J’ai créé une histoire alternative. C’est presque une note en bas de page dans un traité, un point marginal dans des négociations beaucoup plus larges qui incluaient le commerce dans les Antilles, d’autres territoires, etc. C’est quand même facile à imaginer, pour ceux qui connaissent la géographie de la région, que Détroit reste aux mains des Britanniques, et éventuellement des Canadiens, parce que de la façon dont les choses sont faites, c’est la rivière qui sépare les deux pays, mais à cause d’un méandre, Détroit se trouve au nord du comté d’Essex et donc de la ville de Windsor. Si on traçait une ligne droite pour séparer les deux pays, Détroit se situerait du côté canadien.
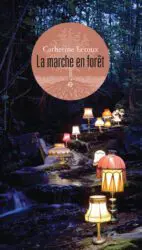 P. B.: Vous avez conçu un dialecte « détroitfortin » qui fait penser au français parlé en Acadie ou dans certaines régions de l’Ontario. Avez-vous constitué un glossaire ?
P. B.: Vous avez conçu un dialecte « détroitfortin » qui fait penser au français parlé en Acadie ou dans certaines régions de l’Ontario. Avez-vous constitué un glossaire ?
C. L.: Oui. Ça a été vraiment long, arriver à cette langue. J’ai commencé en m’inspirant de l’acadien, des formules que j’entends dans les Maritimes et d’autres avec lesquelles je me suis familiarisée quand je vivais en Ontario et que je fréquentais des Franco-Ontariens. Ce qui m’a particulièrement plu (je sais qu’en tant que francophones, on n’est pas supposés aimer ça, mais moi, j’adore ça), ce sont les calques de l’anglais, les anglicismes, les réappropriations de structures de phrases ou d’expressions anglophones transposées en français. Il y en a dans toutes les formes de français canadien, mais ce ne sont pas les mêmes à travers les régions. Ce sont souvent des expressions qui viennent du monde agricole ou forestier ou d’un mode de vie qui n’est plus du tout le nôtre, mais on continue à les appliquer. Je me suis fait un glossaire, mais je n’y serais pas arrivée si je n’avais pas découvert les travaux de Marcel Bénéteau, un ethnologue franco-ontarien qui a répertorié beaucoup de l’histoire, des traditions, des contes traditionnels et du vocabulaire des communautés francophones du sud de l’Ontario. Il a également beaucoup écrit sur les Muskrats, les francophones du Michigan. Il a, entre autres, publié ce qui a été ma bible pendant des mois, un glossaire de mots de cette région. Ça fait 500 pages. Je l’ai lu d’une couverture à l’autre plusieurs fois.
P. B.: Vous semblez avoir choisi Détroit en partie à cause de son caractère sauvage et déserté. Quand on y entre, on a l’impression d’être dans une ville du Far West ; vous dites que Fort Détroit est devenu un lieu « sans foi ni loi ». Mais ensuite, c’est surtout son côté apocalyptique qui frappe : édifices abandonnés, maisons pillées ou dynamitées, voitures défoncées, structures rouillées, rues fissurées envahies par le lierre… On se croirait dans une ville en guerre et en même temps, la nature reprend ses droits. Certains citadins ont redécouvert les joies de l’agriculture. Pourriez-vous nous parler de votre rapport aux espaces urbains, à la verdure, à la dévastation ?
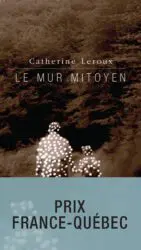 C. L.: Au moment où j’ai commencé à réfléchir à ce roman, il y a peut-être huit ans, il y avait une mode qu’on appelait « la porn des ruines ». Plusieurs photoreportages circulaient sur Internet, des reportages montrant toutes sortes de lieux à travers le monde (Tchernobyl est un bon exemple) qui ont été construits, investis par la civilisation, par les êtres humains, par l’industrialisation, par le tourisme, et qui ont ensuite été complètement désertés pour toutes sortes de raisons (accidents nucléaires, crises économiques, etc.) et repris par la nature. Ces lieux sont lugubres, mais en même temps, je les trouvais très beaux et je pense que c’est ce qui a attiré les gens vers ces reportages et pourquoi c’est devenu une mode : parce que c’est fascinant. Collectivement, on devient de plus en plus conscients qu’il va peut-être y avoir un après l’être humain ou en tout cas que nos modes de vie vont être remis en question, voire abolis par les problèmes qu’on a causés dans l’environnement. Dans toutes nos villes, on a des coins qui ressemblent à ça : sur le bord des voies ferrées, dans les zones industrielles qui ont été délaissées par les investisseurs, des endroits où, pour reprendre la métaphore la plus évidente, des fleurs poussent dans les craques de trottoirs. Détroit, c’est ça mur à mur. Au départ, je n’avais jamais mis les pieds à Détroit et comme tout le monde, j’avais entendu des histoires d’horreur comme quoi si tu vas à Détroit et que tu marches trois coins de rue après 19 h, tu vas te faire trancher la gorge. Ce n’est pas vrai et selon les gens que j’ai rencontrés là-bas, ça ne l’a jamais été. Il y a eu beaucoup de violence à Détroit, mais elle a été plus tournée vers des personnes innocentes, un peu comme ce qu’on a pu voir dans les événements qui ont mené au mouvement Black Lives Matter. C’est un proto-Black Lives Matter qui s’est passé à Détroit. La communauté noire était sous une immense pression, forcée de vivre dans des quadrilatères très restreints, très délimités. On ne leur permettait pas de s’installer à l’extérieur de certains quartiers, ils étaient harcelés par la police. À un moment donné, il y a eu un soulèvement et après, la ville s’est vidée complètement. Ça a été une façon de punir les résidents qui s’étaient révoltés. Pendant plus d’une décennie, il n’y a pas eu une seule épicerie à l’intérieur des murs de Détroit, qui est une ville immense. Donc, avoir des aliments frais si tu n’as pas de voiture pour aller faire l’épicerie en banlieue, c’était impossible. Des gens se sont mis à pratiquer l’agriculture, à construire des serres. J’en ai visité quelques-unes. C’est magnifique. C’est un symbole très fort de comment on peut retrouver son autonomie, se réapproprier les lieux, faire du beau avec quelque chose qui était en ruine.
C. L.: Au moment où j’ai commencé à réfléchir à ce roman, il y a peut-être huit ans, il y avait une mode qu’on appelait « la porn des ruines ». Plusieurs photoreportages circulaient sur Internet, des reportages montrant toutes sortes de lieux à travers le monde (Tchernobyl est un bon exemple) qui ont été construits, investis par la civilisation, par les êtres humains, par l’industrialisation, par le tourisme, et qui ont ensuite été complètement désertés pour toutes sortes de raisons (accidents nucléaires, crises économiques, etc.) et repris par la nature. Ces lieux sont lugubres, mais en même temps, je les trouvais très beaux et je pense que c’est ce qui a attiré les gens vers ces reportages et pourquoi c’est devenu une mode : parce que c’est fascinant. Collectivement, on devient de plus en plus conscients qu’il va peut-être y avoir un après l’être humain ou en tout cas que nos modes de vie vont être remis en question, voire abolis par les problèmes qu’on a causés dans l’environnement. Dans toutes nos villes, on a des coins qui ressemblent à ça : sur le bord des voies ferrées, dans les zones industrielles qui ont été délaissées par les investisseurs, des endroits où, pour reprendre la métaphore la plus évidente, des fleurs poussent dans les craques de trottoirs. Détroit, c’est ça mur à mur. Au départ, je n’avais jamais mis les pieds à Détroit et comme tout le monde, j’avais entendu des histoires d’horreur comme quoi si tu vas à Détroit et que tu marches trois coins de rue après 19 h, tu vas te faire trancher la gorge. Ce n’est pas vrai et selon les gens que j’ai rencontrés là-bas, ça ne l’a jamais été. Il y a eu beaucoup de violence à Détroit, mais elle a été plus tournée vers des personnes innocentes, un peu comme ce qu’on a pu voir dans les événements qui ont mené au mouvement Black Lives Matter. C’est un proto-Black Lives Matter qui s’est passé à Détroit. La communauté noire était sous une immense pression, forcée de vivre dans des quadrilatères très restreints, très délimités. On ne leur permettait pas de s’installer à l’extérieur de certains quartiers, ils étaient harcelés par la police. À un moment donné, il y a eu un soulèvement et après, la ville s’est vidée complètement. Ça a été une façon de punir les résidents qui s’étaient révoltés. Pendant plus d’une décennie, il n’y a pas eu une seule épicerie à l’intérieur des murs de Détroit, qui est une ville immense. Donc, avoir des aliments frais si tu n’as pas de voiture pour aller faire l’épicerie en banlieue, c’était impossible. Des gens se sont mis à pratiquer l’agriculture, à construire des serres. J’en ai visité quelques-unes. C’est magnifique. C’est un symbole très fort de comment on peut retrouver son autonomie, se réapproprier les lieux, faire du beau avec quelque chose qui était en ruine.
P. B.: On trouve quelques personnages de fermiers urbains dans votre roman, entre autres celui de Salomon, un passionné d’histoire qui a été pianiste dans une autre vie. Qu’est-ce qu’il représente pour vous ?
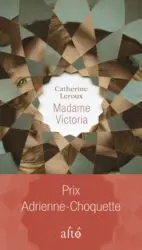 C. L.: Salomon, c’est l’historien, c’est la mémoire de la ville. Il est attaché à une certaine version de la ville qui est assez traditionnelle, assez conservatrice, bien que ce ne soit absolument pas un conservateur. C’est un grand défenseur du fait français. Il idéalise le legs des Français parfois au détriment des minorités, parfois en ignorant le mal qui a été fait aux Premières Nations par les colons. Il y a toujours quelqu’un pour lui donner la réplique quand il parle d’histoire. Au début, c’est une autre résidente de son âge qui est tout le temps en train de l’obstiner sur tout. Après, il y a un changement dans l’histoire, et les enfants, qui normalement restent cachés dans la forêt, s’ouvrent un peu plus aux adultes qui leur tendent la main. Salomon décide d’intervenir en leur transmettant des savoirs agricoles, pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins, et des savoirs historiques. Il veut qu’ils connaissent leur histoire, leur passé, qu’ils comprennent d’où ils viennent. Mais les enfants ont tellement une façon de penser qui leur appartient, qui est complètement indépendante du monde des adultes, qu’eux aussi l’obstinent, mais pas sur des points de politique ou d’interprétation de l’histoire. Eux, ils ont en tête une histoire fictive et magique. Il y a des interventions surnaturelles dans leur version de l’histoire de la ville et c’est avec ça qu’ils le contredis.
C. L.: Salomon, c’est l’historien, c’est la mémoire de la ville. Il est attaché à une certaine version de la ville qui est assez traditionnelle, assez conservatrice, bien que ce ne soit absolument pas un conservateur. C’est un grand défenseur du fait français. Il idéalise le legs des Français parfois au détriment des minorités, parfois en ignorant le mal qui a été fait aux Premières Nations par les colons. Il y a toujours quelqu’un pour lui donner la réplique quand il parle d’histoire. Au début, c’est une autre résidente de son âge qui est tout le temps en train de l’obstiner sur tout. Après, il y a un changement dans l’histoire, et les enfants, qui normalement restent cachés dans la forêt, s’ouvrent un peu plus aux adultes qui leur tendent la main. Salomon décide d’intervenir en leur transmettant des savoirs agricoles, pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins, et des savoirs historiques. Il veut qu’ils connaissent leur histoire, leur passé, qu’ils comprennent d’où ils viennent. Mais les enfants ont tellement une façon de penser qui leur appartient, qui est complètement indépendante du monde des adultes, qu’eux aussi l’obstinent, mais pas sur des points de politique ou d’interprétation de l’histoire. Eux, ils ont en tête une histoire fictive et magique. Il y a des interventions surnaturelles dans leur version de l’histoire de la ville et c’est avec ça qu’ils le contredis.
P. B.: Vos personnages d’enfants vivent en autarcie dans le boisé du parc de la Rouge, près d’un ravin. Ils sont capables de violence sans être foncièrement méchants. Vous n’avez pas opté pour un scénario pessimiste à la William Golding comme dans Sa Majesté des mouches, roman auquel un tel clan d’enfants sauvages fait inévitablement penser. Comment s’est faite l’association dans votre esprit entre Détroit et ces enfants ?
C. L.: Ça va peut-être avoir l’air cruel, mais l’idée m’est venue parce que dans un des reportages que j’ai vus sur Détroit, on parlait de meutes de chiens abandonnés qui étaient retournés à l’état sauvage. C’était beaucoup des chiens de combat, des pitbulls, des rottweilers…
P. B.: Il y a d’ailleurs un pitbull dans votre roman.
C. L.: Il y a un pitbull pour faire honneur à ça. Détroit a un peu l’âme d’un pitbull, d’un ancien combattant fatigué. J’aime les pitbulls au cœur d’or. C’est un chien qui est haï, qui est craint, alors qu’il n’est pas foncièrement dangereux. J’avais du mal au départ, à l’étape de la conception, à imaginer quelle pourrait être la place des enfants là-dedans, mais je savais que je voulais des enfants parce qu’ils sont l’avenir dans tous les sens du terme. J’ai imaginé des enfants laissés-pour-compte, abandonnés par leurs familles, par le système, qui n’avaient aucun filet de sécurité pour les rattraper ; pour qui vivre dans le bois, à la merci des intempéries, des maladies, de la faim, de l’inconfort, c’était déjà moins pire que de vivre auprès des adultes. Je voulais qu’ils soient complètement opposés à l’idée de se soumettre à nouveau aux règles des adultes parce que ce sont les adultes qui ont brisé leur monde. Je n’ai jamais pensé que si des enfants se retrouvaient comme ça, laissés à eux-mêmes, ils sombreraient automatiquement dans la cruauté. Je sais que la cruauté fait partie des traits des enfants, parce qu’ils n’ont pas été socialisés complètement, mais je pense que c’est aussi inné et naturel que peuvent l’être l’empathie et la solidarité.
P. B.: Contrairement à ce que suggère le titre, L’avenir n’est pas un roman d’anticipation. Il est situé dans l’époque contemporaine. En même temps, on sent une ouverture aux littératures de l’imaginaire. Vous ouvrez la porte au merveilleux et au réalisme magique avec certains de vos personnages d’enfants, en particulier avec Bleach qui est une sorte de fée albinos, avec Baleine qui vit dans les arbres, Méthode qui parle aux animaux, etc. Quel rapport entretenez-vous avec les littératures de l’imaginaire ?
C. L.: Je ne suis pas une grande lectrice de fantasy ni de science-fiction. J’en lis à l’occasion, mais je ne suis pas quelqu’un qui s’est plongé dans un genre, par exemple à l’adolescence. Par contre, les romans que je préfère sont toujours ceux qui ont une patte dans un de ces domaines. J’aime bien qu’on mélange les genres. Pour moi, ce qu’il y a de plus beau dans la littérature, et ce qu’il y a de plus formidable dans le fait de pouvoir en écrire, c’est qu’on peut faire ce qu’on veut. On peut inventer ce qu’on veut.
P. B.: Le temps est peut-être le véritable sujet de votre roman. Les adultes et les enfants de Fort Détroit forment une chaîne organique entre le passé, le présent et l’avenir. À quoi ressemble votre propre rapport au temps ?
C. L.: Il était très compliqué au moment où j’ai commencé à écrire L’avenir. Je ne pense pas que je m’étais préoccupée du temps auparavant. Forcément, je vieillis, j’ai eu 40 ans récemment, j’ai des enfants qui, comme tous les enfants, grandissent trop vite. J’ai eu une période où j’ai ressenti un sentiment de révolte par rapport à ça, que j’ai essayé de prêter à Gloria dans le roman. Révolte face au fait que c’est irréversible, qu’on ne peut pas revenir en arrière, revisiter des époques. C’est dur d’accepter que les choses soient irréversibles. Le temps est le thème qui m’a portée à travers l’écriture. Je ne pense pas qu’il est si flagrant que ça quand on lit le roman, mais il a structuré ma pensée. Une grand-mère qui décide de prendre soin de ses petites-filles comme elle n’a pas pu prendre soin de sa fille, est-ce qu’elle remonte le temps, est-ce qu’elle réussit à revenir en arrière et à refaire les choses autrement ? Je pense que ça se peut. On ne peut pas répéter, revenir, revivre les mêmes événements, mais on peut essayer de faire mieux ou d’en profiter différemment, d’être conscients d’une nouvelle façon. Écrire aussi, c’est une façon de lancer des bouteilles à la mer. C’est une façon de pérenniser certaines choses ou d’entrer en communication avec des gens qui vont naître bien après ma mort si jamais mes livres survivent jusque-là. Lire, c’est la même chose. C’est une façon de remonter le temps en entrant en relation avec des auteurs qui n’existent plus, avec des époques qui sont révolues.
1.Cet article reproduit des extraits d’un entretien diffusé le 25 avril 2021 dans le cadre du festival littéraire international Frye. Transcription : Caroline Hogue. Pour visionner l’entretien dans son intégralité : https://www.youtube.com/watch?v=uMeaEPSpmcU.
2. Lazer Lederhendler.
3. Le Traité de Paris en 1783.











