Tu sais déjà beaucoup de choses par toi-même,
et tu en apprendras d’autres lentement.
Pablo Neruda, Ode à Federico García Lorca
Romancière et traductrice, Dominique Fortier a publié cinq romans en à peine dix ans1. Maintes fois en lice pour le Prix littéraire du Gouverneur général, soit pour une fiction ou une traduction, elle en est la lauréate en 2016 avec Au péril de la mer.
En 2014, l’écrivaine a de plus cosigné Révolutions avec le romancier Nicolas Dickner, un ovni s’inspirant du calendrier républicain2 et fort bien reçu par la critique. Érudits et souvent facétieux, les deux auteurs se sont amusés pendant 365 jours à façonner cet objet qui tient à la fois d’un échange épistolaire, d’un journal de bord et d’une encyclopédie, recettes et commentaires sur divers films, livres et bandes dessinées inclus.

 Titulaire d’un doctorat en littérature française de l’Université McGill,Dominique Fortier est née à Québec en 1972. Elle a publié son premier roman Du bon usage des étoiles en 2008, alors qu’elle voyait poindre la quarantaine. Pour un coup d’essai, ce fut vraiment un coup de maître. Le livre a reçu le prix Gens de mer du festival Étonnants Voyageurs et a été finaliste à plusieurs autres prix3. Dès sa sortie, le roman a été remarqué par le réalisateur Jean-Marc Vallée, qui en a d’ailleurs acheté les droits d’auteur. Un début sur les chapeaux de roues, vraiment.
Titulaire d’un doctorat en littérature française de l’Université McGill,Dominique Fortier est née à Québec en 1972. Elle a publié son premier roman Du bon usage des étoiles en 2008, alors qu’elle voyait poindre la quarantaine. Pour un coup d’essai, ce fut vraiment un coup de maître. Le livre a reçu le prix Gens de mer du festival Étonnants Voyageurs et a été finaliste à plusieurs autres prix3. Dès sa sortie, le roman a été remarqué par le réalisateur Jean-Marc Vallée, qui en a d’ailleurs acheté les droits d’auteur. Un début sur les chapeaux de roues, vraiment.
Fascinant XIXe siècle
L’auteure et sa famille partagent leur temps entre la maison de Montréal, sise à Outremont, et celle située au bord de la mer, à Scarborough, dans le Maine. Ce sera au pied des boisés du mont Royal, dans la cuisine familiale, que je rencontrerai Dominique Fortier, au milieu des jouets et des livres d’enfants.
Accrochés au mur, des plans d’élégantes maisons du XIXe siècle ne sauraient étonner, l’omniprésence de l’époque dans l’œuvre de l’écrivaine étant connue. Seule une amoureuse de ces temps lointains pouvait décrire avec un tel réalisme l’expédition en Arctique de Sir John Franklin (1786-1847), dont l’équipage était voué aux glaces éternelles (Du bon usage des étoiles), ou trouver les mots justes pour que le lecteur puisse pénétrer en douceur dans l’intimité de la poétesse Emily Dickinson (1830-1886) (Les villes de papier).
« Je suis fascinée par cette époque charnière qui marque les débuts de la modernité, alors qu’avaient lieu d’importantes découvertes scientifiques, mais où l’on avait encore paradoxalement un pied dans la légende. Les objets de tous les jours étaient faits par des artistes et des artisans qui avaient encore le souci des choses faites avec soin. Et puis, il me semble que le rapport au temps et à l’espace devait être différent », explique-t-elle, avec une pointe de nostalgie pour ce temps enfui.
Que Dominique Fortier place Victor Hugo au premier rang des écrivains qu’elle admire prend tout son sens.
Rigoureuse, elle compose avec minutie des romans exigeants. On aborde ses livres comme on se faufile dans un cabinet de curiosités dont l’inventaire serait sans cesse renouvelé, comme il en existait justement au XIXe siècle. L’information abonde dans ses livres et révèle une érudition qu’elle utilise avec maestria. Son intérêt pour la recherche semble infini. Elle se définit ainsi : « Je suis du style rat de bibliothèque, mais pas vraiment une collectionneuse car je fais rarement des recherches systématiques. Je suis davantage une butineuse, je me laisse souvent porter par l’intuition et le hasard des découvertes. C’est ainsi que je trouve des trésors » et les lecteurs aussi, pour leur plus grand plaisir.
Destins croisés et éclairage indirect
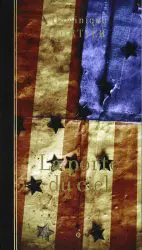
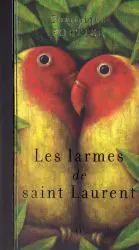 Les écrits de Dominique Fortier, tout en délicatesse et très peaufinés, s’apparentent à de la fine dentelle. Ils se situent entre le roman et l’essai, entre le récit historique et le carnet d’écriture. On suit deux ou trois protagonistes aux vies parallèles, mais eux ne se rencontreront jamais. Dans La porte du ciel s’entrecroisent des sudistes américains au moment de la guerre de Sécession, au milieu des champs de coton et des bayous de la Louisiane, ou dans les humbles cuisines de l’Alabama où naissaient et naissent encore d’historiques courtepointes. Le passé et le présent se répondent dans Les larmes de saint Laurent, de l’éruption de la montagne Pelée aux flancs du Vésuve, jusqu’aux sentiers du mont Royal.
Les écrits de Dominique Fortier, tout en délicatesse et très peaufinés, s’apparentent à de la fine dentelle. Ils se situent entre le roman et l’essai, entre le récit historique et le carnet d’écriture. On suit deux ou trois protagonistes aux vies parallèles, mais eux ne se rencontreront jamais. Dans La porte du ciel s’entrecroisent des sudistes américains au moment de la guerre de Sécession, au milieu des champs de coton et des bayous de la Louisiane, ou dans les humbles cuisines de l’Alabama où naissaient et naissent encore d’historiques courtepointes. Le passé et le présent se répondent dans Les larmes de saint Laurent, de l’éruption de la montagne Pelée aux flancs du Vésuve, jusqu’aux sentiers du mont Royal.
Les derniers romans de l’écrivaine se font plus personnels, à mi-chemin entre fiction et autobiographie. Dominique Fortier se met en scène et décide d’écrire au « je ». « Il y a souvent des destins croisés dans mes livres, oui, mais rarement de récits en miroir ou symétriques dont les échos ou les correspondances sont très évidents ; ce que je cherche à faire, c’est éclairer d’une lumière oblique le sujet dont je parle plutôt que de l’aborder d’un angle unique. » Elle insiste : « les différentes parties de mes récits se répondent par nécessité, non pas par hasard ». Elle a fait siens les conseils d’un de ses anciens professeurs de création littéraire qui rappelait aux étudiants ce que disait Yvon Deschamps avec humour : « On ne veut pas le savoir, on veut le voir4 ». Elle croit par ailleurs à l’importance de permettre au lecteur de forger son idée propre : « Un texte littéraire, c’est un ensemble de points dans un ciel noir. Les étoiles sont les mêmes pour tout le monde, mais il appartient à chaque lecteur de tracer des lignes pour former ses propres constellations ».
Étapiste de haut vol, l’auteure noircit d’abord à la main les pages de ses petits cahiers et les copie ensuite à l’ordinateur. Après les avoir imprimées, elle les découpe, en étale les pièces sur le plancher et commence à assembler son histoire. Un peu comme pourrait le faire un monteur de film. « Je ne sais pas s’il y a beaucoup de romanciers qui travaillent comme ça », se demande-t-elle. Dans Les villes de papier, elle prête son processus créatif à Emily Dickinson. « Elle pose [ses poèmes] par terre, côte à côte, sans qu’ils se touchent, comme les morceaux d’un gigantesque casse-tête. »
La mer, ma maison
Thème récurrent, la mer et les grandes eaux animent chacun des romans de Dominique Fortier, d’abord l’Arctique et la mer chaude des Caraïbes dans les premiers livres ; ce seront ensuite les méandres du Mississippi, la baie mythique du Mont-Saint-Michel et, enfin, les plages de la Nouvelle-Angleterre dans les romans suivants. Ses histoires se déclinent avec la puissance des eaux en arrière-scène. Elle reconnaît être une « grande amoureuse de la mer » : « Ma vraie maison, c’est la mer ». On comprend pourquoi le prix Gens de mer l’a autant touchée, ce prix « dont le jury est composé d’explorateurs, de capitaines de bateau et de navigateurs au long cours ».

Elle avoue cette passion et s’y adonne avec plaisir quand la famille s’installe dans son refuge d’Higgins Beach, là où depuis 1897 se désagrège lentement un navire échoué sur la plage, aujourd’hui envahie par d’habiles surfeurs. Elle écrira à Nicolas Dickner dans Révolutions : « Une petite maison grise se dresse, droite et haute, bordée de blanc, toute seule devant un marais. Les cormorans font sécher leurs ailes noires au soleil d’octobre ».
L’enfant timide et solitaire qu’elle était, celle qui lisait « de manière boulimique, quasi pathologique », passait ses étés sur les plages du Maine et est restée imprégnée du vent du large. Sa petite enfance s’était pourtant déroulée à Cap-Rouge, sans vue sur le fleuve, mais ce sont les espaces infinis qui l’attirent. « J’ai un grand besoin de liberté », confie-t-elle. « Je n’ai jamais pu demeurer enfermée dans un bureau, faire ‘du 9 à 5’ ».
Avant de plonger dans l’écriture d’un premier roman, Dominique Fortier a longtemps été pigiste et a occupé des emplois appartenant « aux métiers du livre » : libraire, éditrice, traductrice ou commis de bibliothèque. Elle est demeurée fidèle à ce qu’elle a toujours vu et fréquenté dans une maison familiale pleine de livres, en compagnie d’un père bibliothécaire et d’une mère enseignante.
Les livres sont toute sa vie. « J’avais pourtant peur de l’écriture, comme je craignais la maternité ; le seul fait d’écrire me terrorisait, il existe déjà tant de chefs-d’œuvre, comment oser ajouter quoi que soit à cela ? D’autre part, je n’étais pas certaine d’être capable de me mettre entièrement au service de quelqu’un, même s’il s’agissait de mon propre enfant », raconte-t-elle. « Devenir mère a pourtant été la plus belle chose qui me soit arrivée, et j’y ai trouvé un nouveau centre de gravité. Quand on a un enfant, il y a un renversement complet qui s’effectue. Tout à coup, on n’est plus au centre de son univers ; c’est de l’ordre de ce qui s’est produit, au Moyen Âge, quand on a cessé de croire que la Terre était au centre du monde et qu’on a commencé à concevoir qu’elle tournait plutôt autour du Soleil – l’un des bouleversements fondamentaux qui guettent les personnages d’Au péril de la mer », confie-t-elle en souriant.
 Comme une bouteille à la mer
Comme une bouteille à la mer
Dominique Fortier vogue présentement en eaux calmes. Elle est encore étonnée d’avoir été préférée à des finalistes qu’elle admire5 pour le Prix littéraire du Gouverneur général 2016. Au Québec, en France ou traduits au Canada anglais, ses livres se vendent bien. Petit plaisir et non le moindre, elle goûte sa récente victoire auprès de Grasset qui publiera Les villes de papier en 2020. « J’ai réalisé un rêve de petite fille, celui d’être publiée par une des grandes maisons françaises. Comme une bouteille à la mer, j’ai envoyé moi-même le manuscrit sous pseudonyme à Gallimard et à Grasset. Ce dernier l’a accepté sans intermédiaire, sans agent, sans être influencé par ce que j’avais ou n’avais pas fait. » Seule la qualité de son texte a parlé et là réside tout le mérite de Dominique Fortier.
1. Tous publiés chez Alto : Du bon usage des étoiles (2008) ; Les larmes de saint Laurent (2010) ; La porte du ciel (2011) ; Au péril de la mer (2015) ; Les villes de papier (2018).
2. Créé pendant la Révolution française, le calendrier républicain ou calendrier révolutionnaire français a été utilisé de 1792 à 1806.
3. Prix littéraire du Gouverneur général, Prix des libraires du Québec, Grand prix littéraire Archambault et prix Senghor du premier roman francophone.
4. Yvon Deschamps, monologue Cable TV(1970).
5. Martine Delvaux, Anaïs Barbeau-Lavalette, Daniel Grenier et Hugues Corriveau.
EXTRAITS
Il y aura demain trois ans que nous avons quitté Greenhithe. Nous aurons fait trois fois le tour du soleil, et serons en même temps restés cruellement immobiles.
Nous avons monté une tente où nous laisserons ceux qui ne peuvent plus avancer. Nous y avons passé une dernière nuit avec eux avant de nous remettre en route, avec l’impression – juste, trop juste – de veiller un agonisant qu’on abandonnera le matin à la mort qui le guette.
Du bon usage des étoiles, p. 330.
« Très chère, comment vous portez-vous ? Ah, mais vous avez une mine superbe ! » [… ] « Quelles sont les nouvelles ? » Lady Jane répondait sans s’émouvoir que les navires devaient avoir cartographié depuis longtemps le détroit de Lancaster, ou même découvert l’entrée du Passage, qu’ils avaient sans doute fait halte pour l’hiver dans une baie protégée pour compléter leur mission l’été venu. On s’éloignait en murmurant : « Quelle femme. »
Du bon usage des étoiles, p. 104.
Isolées, elles n’étaient que lambeaux de mouchoir ou de chemise, morceaux de drap, bouts de tenture, guenilles et haillons. Ensemble, elles formaient des cabanes et des paysages, des champs sous le soleil, des nuits étoilées, des arbres lourds de fruits, des rivières sinueuses. […] Après des jours, voire des semaines passées à découper, à assembler puis à piquer, elle avait en regardant la courtepointe l’impression étrange qu’elle avait toujours existé, ou du moins qu’elle était depuis la nuit des temps destinée à apparaître sous cette forme exactement.
La porte du ciel, p. 71.
La Pelée depuis peu s’était mise à grommeler, d’abord presque imperceptiblement, puis de plus en plus fort, jusqu’à ce que personne ne puisse plus l’ignorer, mais sans que quiconque sût dire exactement quand cela avait commencé. Dans les rues, dans les chaumières comme dans les maisons élégantes, dans les clubs privés et jusque dans les salles dorées de la résidence du gouverneur, aux étals du port, sur les navires qui gagnaient ou quittaient l’île, on commentait avec intérêt mais sans grande crainte les manifestations de la montagne comme on l’aurait fait d’un quelconque phénomène météorologique […] rare mais non pas exceptionnel.
Les larmes de saint Laurent, p. 30.
Peut-être suis-je puni pour avoir voulu représenter la vie – péché d’idolâtrie doublé de celui d’orgueil. Tels les Hébreux pétris d’arrogance se prosternant devant le veau d’or qu’ils avaient façonné. Cela m’est apparu ce matin comme une évidence. Seul un fou peut vouloir regarder le Soleil dans les yeux. J’étais pis que fou : j’étais amoureux et j’étais jaloux.
Au péril de la mer, p. 133.
Dans la bibliothèque d’Emily, les livres s’alignent comme des soldats à l’attention. L’un renferme des oiseaux, un autre des coquillages. En ouvrant un troisième, on découvre le système solaire entier : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. Il y a les œuvres complètes de Shakespeare. La Bible, qui contient toute la Vérité.
Sa chambre abrite tout cela et bien plus, car rien n’a été dit des cahiers aux pages blanches qui attendent tout ce qui n’existe pas encore – les oiseaux, les arbres et les planètes qui peuplent son crâne, cette autre chambre secrète.
Les villes de papier, p. 30.
Quand ses tiroirs se mettent à déborder de poèmes épars […], Emily entreprend de les rassembler en petits volumes. Pour ce faire, elle commence par les étendre sur son bureau de façon à les voir tous à la fois. La surface de bois est bientôt recouverte. Elle se lève, en dispose quelques-uns sur sa chaise, puis sur le manteau de la cheminée, avant de se résoudre à les poser par terre, côte à côte, sans qu’ils se touchent, comme les morceaux d’un gigantesque casse-tête. Les poèmes envahissent la chambre.
Les villes de papier, p. 176.
Dernière journée à la mer peut-être avant la neige. Quand nous arrivons dans le Maine il flotte sur les champs une lumière dorée, aussi épaisse que le miel, de ces atmosphères ambrées qui font le sfumato du lointain des tableaux de la Renaissance.
Sur la plage, deux trois promeneurs et leurs chiens, des cailloux semés sur le sable et partout des rubans, des frises, des dentelles d’algues noires, rousses et vert bouteille. De longs rouleaux fauves se dévident, humides et caoutchouteux, près de touffes pâles qui ressemblent à de minuscules anémones. Des cloques pleines d’eau accrochent la lumière et flamboient un instant dans le soleil, translucides, comme la chair farcie de pépins de quelque fruit des tropiques.
Révolutions, p. 67.











