Curieuse, passionnée, assoiffée de découvrir, de comprendre, de connaître, de partager et de transmettre, Aline Apostolska est aussi une grande voyageuse. Polyglotte – elle parle français, anglais, espagnol, croate et macédonien–, elle a publié une quarantaine de livres en trente ans, en France puis au Québec, dont certains sont traduits. L’auteure d’Ailleurs si j’y suis fait aussi voyager ses lecteurs du Vietnam en Inde en passant par Londres, La Havane, Paris ou Oulan-Bator, et les entraîne au cœur des multiples univers qui la font vibrer. Rencontre avec une écrivaine engagée, prolifique et éclectique.
Nuit blanche : En quoi vos premiers titres parus au Québec marquent-ils une rupture ou une continuité dans votre parcours ?
Aline Apostolska : Je suis née à Skopje, dans cette partie de l’ex-Yougoslavie qui est aujourd’hui la Macédoine du Nord, où j’ai été élevée par mes grands-parents paternels jusqu’à mes trois ans avant de rejoindre mes parents à Paris. J’y ai obtenu une maîtrise en histoire des femmes et histoire des religions à l’Université Paris 7 – Denis Diderot. Mes deux enfants, Raphael et Louis Weyland, sont nés en France. J’y ai fait carrière en journalisme culturel à la radio et dans la presse écrite, puis comme directrice littéraire et directrice de collections. Mes premiers titres y ont été publiés dès 1986. Après mon émigration au Québec avec mes fils en 1998 – véritable coup de foudre pour Montréal lors de mon premier séjour en 1994 –, j’ai poursuivi ici un parcours axé sur une préoccupation fondamentale : me comprendre au travers et avec les autres. Cela m’a conduite à m’intéresser autant aux mythes universels qu’à la psychanalyse, à l’astrologie ou à la sémiologie, et à l’art visuel jusqu’à devenir peintre. J’ai aussi conceptualisé, produit et interprété plusieurs spectacles de danse-littérature. J’ai été chroniqueuse et animatrice à la radio de Radio-Canada durant dix ans, critique à La Presse pendant quatorze ans, et j’ai œuvré au sein du Centre québécois de P.E.N. international et de l’UNEQ plusieurs années.
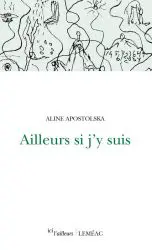
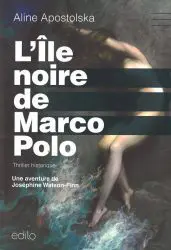 Lettre à mes fils qui ne verront jamais la Yougoslavie a d’abord été publié en France chez Isoète en 1997. Il a été repris en 2000 par Leméac avec un ajout, une postface intitulée « Vu d’Amérique trois ans après ». Ce livre est en fait issu d’une chronique que je tenais dans Libération lorsque la guerre a éclaté dans l’ex-Yougoslavie. Je me suis violemment souvenue que je venais de là ; qu’est-ce que j’allais bien pouvoir faire ? Mon second fils venait de naître et j’ai eu le désir de réfléchir aux valeurs que j’avais reçues et que je souhaitais transmettre. Des valeurs humanistes non seulement de respect mais bien d’amour de la différence d’autrui. Toute mon histoire ancestrale repose là-dessus. Celle de ma famille byzantine, grecque, orthodoxe et juive, dont je possède les archives depuis la fin du XVIIIe siècle. Je viens d’une lignée où tous les hommes étaient au pouvoir (politique, financier, religieux) et toutes les femmes des artistes, dont aucune n’est morte là où elle est née, et ce sera évidemment mon cas. Jamais je n’y avais pensé auparavant. Je suis née pour ne pas être ce que j’étais à la naissance. De cela vient le fait qu’il y a une phrase dans chacun de mes livres sans exception : devenir plutôt que demeurer.
Lettre à mes fils qui ne verront jamais la Yougoslavie a d’abord été publié en France chez Isoète en 1997. Il a été repris en 2000 par Leméac avec un ajout, une postface intitulée « Vu d’Amérique trois ans après ». Ce livre est en fait issu d’une chronique que je tenais dans Libération lorsque la guerre a éclaté dans l’ex-Yougoslavie. Je me suis violemment souvenue que je venais de là ; qu’est-ce que j’allais bien pouvoir faire ? Mon second fils venait de naître et j’ai eu le désir de réfléchir aux valeurs que j’avais reçues et que je souhaitais transmettre. Des valeurs humanistes non seulement de respect mais bien d’amour de la différence d’autrui. Toute mon histoire ancestrale repose là-dessus. Celle de ma famille byzantine, grecque, orthodoxe et juive, dont je possède les archives depuis la fin du XVIIIe siècle. Je viens d’une lignée où tous les hommes étaient au pouvoir (politique, financier, religieux) et toutes les femmes des artistes, dont aucune n’est morte là où elle est née, et ce sera évidemment mon cas. Jamais je n’y avais pensé auparavant. Je suis née pour ne pas être ce que j’étais à la naissance. De cela vient le fait qu’il y a une phrase dans chacun de mes livres sans exception : devenir plutôt que demeurer.
Pourquoi Montréal ? Outre le coup de foudre dont j’ai parlé plus haut,je ne sais pas. Il fallait que ce soit la francophonie évidemment, il fallait que ce soit le journalisme et la littérature, bien sûr, mais autrement. Montréal pour moi sera pour toujours le lieu du déploiement. Personnel et professionnel. Ça va avec le lieu, avec les gens que j’ai tout de suite adorés, mais aussi avec la période de vie à laquelle j’étais arrivée, 37 ans, l’aube de la quarantaine, la maturité propice à déployer ses ailes et à appliquer ce que l’on a appris avant. Radio-Canada a été mon parrain d’immigration. Je travaillais pour cette société à partir de ses studios de Paris depuis avril 1994. J’ai commencé à la Première chaîne de Radio-Canada Montréal tous les dimanches à 20 heures avec la série Les grandes aventurières dans laquelle je racontais la vie d’une figure historique féminine, de Hatchepsout à Eleanor Roosevelt sans oublier toutes les aventurières de la Nouvelle-France. Alain Stanké a souhaité reprendre ces chroniques dans un livre éponyme coédité avec Radio-Canada. C’est le premier livre que j’ai publié au Québec, en janvier 2000. Ont suivi chez Leméac l’édition québécoise de Lettre à mes fils…puis surtout Tourmente (2000), le roman qui traduit le coup de foudre qui m’a poussée jusqu’ici, délibérément écrit comme un hommage au Saint-Laurent et aux femmes d’ici.

N. B.: En 2005 paraît Neretva. Qu’est-ce qui vous a incité à écrire ce roman historique retraçant les aléas de la vie d’une famille durant le XXe siècle ?
A. A. : Ce roman marque une nouveauté par sa longueur, 700 pages. Sur le plan de la structure littéraire, c’était complexe de raconter une histoire sur cinq générations et sur plus d’un siècle. J’avais essayé de l’écrire pendant dix ans, sans y arriver. J’ai finalement été mûre pour le faire entre 2003 et 2004, et le livre est paru chez Québec-Amérique le 5 février 2005, exactement vingt ans après le décès de ma grand-mère paternelle. Or Neretva, du nom de ce fleuve qui traverse l’Herzégovine natale de ma grand-mère pour se jeter dans l’Adriatique, est précisément mon roman familial, écrit en son hommage. On l’y retrouve, elle, Bernarda, ainsi que son père qui avait servi dans les Dragons autrichiens, son mari macédonien, mon grand-père, leur fils, c’est-à-dire mon père, ses frères aînés et leur descendance, donc moi, ou plutôt le personnage qui m’incarne. En m’inspirant de La maison aux esprits d’Isabel Allende, j’ai inventé une arrière-petite-fille qui retrouve des carnets familiaux et récrit le roman familial. Neretva, qui commence en 1929, remonte jusqu’à la fin du XIXe siècle puis coule jusqu’au début du XXIe, m’a demandé une totale réinvention en plus de mois de recherches minutieuses pour bien repérer les lieux, les dates, les événements. En 1929, à dix-sept ans, ma grand-mère a sauté par la fenêtre pour suivre un homme qui chantait sous ses fenêtres et qui est devenu son mari. Lui était orthodoxe, elle catholique. Elle est partie vivre en Macédoine, en étrangère, parlant toujours sa propre langue, ne revoyant jamais sa mère. La chanson de la Neretva, une chanson populaire de là-bas, tourne dans le roman comme une ritournelle, d’abord une incantation, un enchantement au sens littéral du terme, puis un total désespoir, car évidemment elle a vite déchanté et est morte en peine d’amour en vérité, loin de sa Neretva chérie. Mais dans sa cuisine, elle donnait des cours de féminisme et disait des choses totalement progressistes pour son époque. J’ai fait d’elle un symbole de son siècle, le XXe, qui a commencé dans l’enchantement de croire qu’on laissait les vieux empires et les vieilles valeurs derrière, mais qui a connu les pires atrocités de l’humanité et a fini dans la totale désespérance.
N. B. : Dix ans plus tard, vous revenez avec des romans d’aventures entremêlant cette fois l’Histoire à l’univers de la mythologie, des légendes, des sectes. En lisant L’île noire de Marco Polo et Les steppes de Gengis Khan, on a le sentiment que vous avez eu beaucoup de plaisir à les écrire. Mais ont-ils néanmoins exigé beaucoup de recherches ?
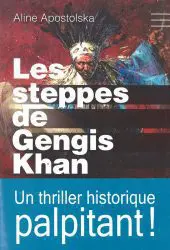 A. A. : Je connais très bien la côte dalmate, car ma mère y vit depuis quarante ans, et en particulier les îles de Hvar et de Korčula, où se passe le premier tome de cette trilogie qui débute dans la maison natale de Marco Polo à Korčula, l’île noire. L’éditeur d’Édito m’a invitée à écrire des thrillers historiques qui se suivraient autour du monde. Avec mon fils aîné, qui en est le conseiller historique, nous avons décidé de suivre la marche civilisationnelle de l’Occident. Marco Polo part de Korčula, qui appartenait au XIIIe siècle à la république de Venise, pour aller en Mongolie, où se déroule le deuxième tome. Puis les Mongols ont envahi la Perse. Donc le troisième tome se passera en Iran. J’ai eu envie de mettre en scène le détournement et l’instrumentalisation des religions, d’une brûlante actualité, n’est-ce pas ? On pense aujourd’hui à l’islamisme, mais ce procédé existe depuis toujours ; il est à l’origine des Croisades, notamment. Mon héroïne, Joséphine Watson-Finn, une Franco-Britannique professeure d’archéologie à l’Université McGill, retrouve un jour par hasard son ancien professeur de Harvard, qui a monté une secte hideuse aux activités sordides mais lucratives. Elle transmet son savoir pour éveiller ses élèves, tandis que lui le détourne pour détruire l’humanité. Elle répète souvent dans le roman que les humains préfèrent croire que savoir, et je le pense aussi. L’histoire du monde le rappelle inlassablement, et ça me terrifie. Le ressort est classique : l’éternelle lutte entre une force noire et une force blanche, comme dans Indiana Jonesou Star Wars. Quand on me l’a proposé, j’étais sceptique, mais finalement j’ai adoré ça. J’ai voulu créer une aventure à la fois géographique, historique, mythologique, psychologique, amoureuse, avec une héroïne forte et pas jeune, en pied de nez à celles de ce type de livres qui sont toujours des genres de Lara Croft.
A. A. : Je connais très bien la côte dalmate, car ma mère y vit depuis quarante ans, et en particulier les îles de Hvar et de Korčula, où se passe le premier tome de cette trilogie qui débute dans la maison natale de Marco Polo à Korčula, l’île noire. L’éditeur d’Édito m’a invitée à écrire des thrillers historiques qui se suivraient autour du monde. Avec mon fils aîné, qui en est le conseiller historique, nous avons décidé de suivre la marche civilisationnelle de l’Occident. Marco Polo part de Korčula, qui appartenait au XIIIe siècle à la république de Venise, pour aller en Mongolie, où se déroule le deuxième tome. Puis les Mongols ont envahi la Perse. Donc le troisième tome se passera en Iran. J’ai eu envie de mettre en scène le détournement et l’instrumentalisation des religions, d’une brûlante actualité, n’est-ce pas ? On pense aujourd’hui à l’islamisme, mais ce procédé existe depuis toujours ; il est à l’origine des Croisades, notamment. Mon héroïne, Joséphine Watson-Finn, une Franco-Britannique professeure d’archéologie à l’Université McGill, retrouve un jour par hasard son ancien professeur de Harvard, qui a monté une secte hideuse aux activités sordides mais lucratives. Elle transmet son savoir pour éveiller ses élèves, tandis que lui le détourne pour détruire l’humanité. Elle répète souvent dans le roman que les humains préfèrent croire que savoir, et je le pense aussi. L’histoire du monde le rappelle inlassablement, et ça me terrifie. Le ressort est classique : l’éternelle lutte entre une force noire et une force blanche, comme dans Indiana Jonesou Star Wars. Quand on me l’a proposé, j’étais sceptique, mais finalement j’ai adoré ça. J’ai voulu créer une aventure à la fois géographique, historique, mythologique, psychologique, amoureuse, avec une héroïne forte et pas jeune, en pied de nez à celles de ce type de livres qui sont toujours des genres de Lara Croft.
N. B. : Votre nouveau diptyque, Une ville qui danse, suit les destins de divers personnages dans un milieu que vous connaissez bien, n’est-ce pas ?
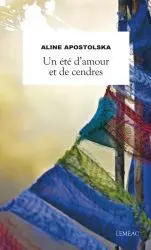
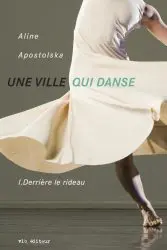 A. A. : Ah ça, c’est un vrai cadeau ! J’ai la chance que les éditeurs pensent à des projets pour moi et ce sont presque toujours des propositions intéressantes et pertinentes qui me font beaucoup avancer dans mon écriture. Après la parution de Fleur de cerisier en 2014, VLB m’a proposé de joindre deux aspects récurrents de mon parcours personnel et professionnel : la transmission transgénérationnelle et la danse. Une ville qui danse parle du processus de création en danse contemporaine mais aussi en littérature, en peinture et en musique. Je l’ai mis en scène tout en montrant les coulisses de la construction de l’Espace danse de Montréal au sein du Quartier des spectacles en m’appuyant sur de longues conversations avec mon amie Francine Bernier, directrice générale et artistique de l’Agora de la danse. Je suis journaliste de danse depuis 35 ans, je connais tout le monde ou presque dans ce milieu, ici comme ailleurs ; j’ai vu des centaines de shows et j’en vois encore, j’en ai moi-même conçu et interprété mais ce que je souhaite avant tout, à travers trois générations de danseuses et de chorégraphes, c’est montrer les mécanismes intérieurs et les effets réciproques sur la vie « réelle » et la création artistique. Cela dit, c’est grand public, car je voulais qu’à travers une histoire enlevée avec beaucoup de rebondissements, le lecteur pénètre dans l’univers des créateurs et dans leur cœur.
A. A. : Ah ça, c’est un vrai cadeau ! J’ai la chance que les éditeurs pensent à des projets pour moi et ce sont presque toujours des propositions intéressantes et pertinentes qui me font beaucoup avancer dans mon écriture. Après la parution de Fleur de cerisier en 2014, VLB m’a proposé de joindre deux aspects récurrents de mon parcours personnel et professionnel : la transmission transgénérationnelle et la danse. Une ville qui danse parle du processus de création en danse contemporaine mais aussi en littérature, en peinture et en musique. Je l’ai mis en scène tout en montrant les coulisses de la construction de l’Espace danse de Montréal au sein du Quartier des spectacles en m’appuyant sur de longues conversations avec mon amie Francine Bernier, directrice générale et artistique de l’Agora de la danse. Je suis journaliste de danse depuis 35 ans, je connais tout le monde ou presque dans ce milieu, ici comme ailleurs ; j’ai vu des centaines de shows et j’en vois encore, j’en ai moi-même conçu et interprété mais ce que je souhaite avant tout, à travers trois générations de danseuses et de chorégraphes, c’est montrer les mécanismes intérieurs et les effets réciproques sur la vie « réelle » et la création artistique. Cela dit, c’est grand public, car je voulais qu’à travers une histoire enlevée avec beaucoup de rebondissements, le lecteur pénètre dans l’univers des créateurs et dans leur cœur.
N. B. : Outre votre production en littérature générale,vous avez signé neuf titres pour la jeunesse. En quoi l’une et l’autre se distinguent-elles ? Les abordez-vous de la même façon ?

A. A. : Je ne pensais pas écrire pour le jeune public. Ça a débuté en France en 1996 avec La treizième Lune (éditions du Bastberg), un album écrit pour les huit à dix ans à partir d’une histoire de bataille entre les lutins bénéfiques et maléfiques par une nuit de pleine lune que mon fils aîné m’a racontée et qui a été magnifiquement illustrée par un dessinateur français. J’ai réitéré avec les Contes de la ruelle (Québec Amérique) dont les personnages, inventés cette fois par mon fils cadet, sont en fait nos vrais voisins. Lorsqu’on m’a proposé de penser à des romans pour grands ados, je me suis interrogée. Que leur dire ? L’adolescence est un passage obligé mais difficile, périlleux même. Moi, j’en garde un souvenir atroce. De facto, j’aborde des sujets clash en essayant d’apporter des réponses. Sur le désir de mourir à quatorze ans (Maître du jeu, Québec Amérique, 2003), ou le désespoir de ne pouvoir choisir son avenir (Un été d’amour et de cendres, Leméac, 2012, Prix du Gouverneur général), ou les enjeux épineux de l’adolescence (les six tomes de la collection « C’est quoi l’rapport ? », éditions de L’Homme) pour lesquels j’ai souhaité écrire avec une psychologue spécialisée dans l’adolescence, Marie-Josée Mercier. Je ne baisse jamais le niveau de vocabulaire ni la complexité, mais je fais attention à tout exprimer de façon plus immédiate, plus accessible et délibérément plus didactique que je ne le fais dans un roman pour adultes. Ça me tient à cœur, au sens propre du terme. Je veux toucher à la fois leur cœur et leur intellect, alors que ce n’est pas un objectif en littérature générale. Pour les adultes, je cherche d’abord à raconter une bonne histoire, à eux de comprendre. Je trouve très souvent plus difficile d’écrire des romans jeunesse, car l’enjeu et la responsabilité me semblent beaucoup plus importants.
N. B. : Après votre actuel diptyque dans le monde de la danse, savez-vous déjà dans quel univers vous entraînerez ensuite vos lecteurs ?
A. A. : On m’a commandé des biographies ces dernières années, notamment celle de Jacques Languirand, et une autre est en cours. Je viens aussi de finir mes recherches pour un roman que j’écrirai en 2019 : le pèlerinage de trois femmes – une chrétienne, une juive, une musulmane – à cheval vers Jérusalem en 1880, en plein Empire ottoman. Voyez, j’écris toujours la même chose…
www.alineapostolska.com
* Aline Apostolska signant L’île noire de Marco Polo à Korčula (Croatie) en août 2018.
** Séminaire d’écriture avec Aline Apostolska au Guatemala en novembre 2018.











