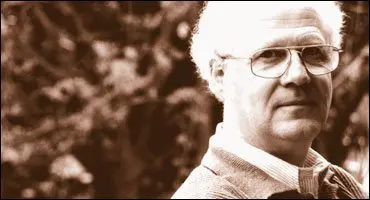En novembre 1987, Fernand Ouellette recevait le prestigieux Prix Athanase David, hommage mérité pour cet écrivain simple, chaleureux et discret, et qui est l’un des auteurs les plus prolifiques de sa génération.
Nuit blanche : L’implication est-elle semblable pour la poésie, le roman et l’essai ?
Fernand Ouellette : Cela peut sembler paradoxal qu’un poète écrive un roman. Le poème et le roman sont des mondes si différents, en apparence. Mais plusieurs poètes ont écrit des romans : je pense à Louis Aragon, Pierre Jean Jouve, Anne Hébert. La poésie se tient vraiment dans l’ordre de l’intemporel, ou ce que j’appelle le « cercle de l’augure » ; tandis que le roman se bat avec le temps, souvent dans le quotidien. Le poème propose une intensité telle qu’on a l’impression d’aller à l’essence des choses. Sans ce travail poétique, il me semble que je ne pourrais pas faire de découvertes sur les réalités qui m’échappent ou échappent aux sens. Le roman est lié à la nature des problèmes qu’il aborde. Chaque solution, chaque histoire appelle une forme nouvelle. Quand j’ai écrit mon premier roman, Tu regardais intensément Geneviève, la crise du couple d’aujourd’hui me préoccupait beaucoup. C’était pour moi une réalité vécue. Tandis que la poésie s’intéresse davantage à l’amour en soi, à la vie et à la mort, aux grands thèmes, aux symboles.
Mon deuxième roman, La mort vive, sorte de quête dans un absolu de la peinture, est un texte plus difficile. Je ne suis pas certain de l’avoir vraiment maîtrisé. Le troisième, Lucie ou un midi en novembre, montre une jeune femme qui cherche son identité et la présence de Dieu.
Je pense que l’écriture de l’essai n’a pas de rapport avec celle de la fiction narrative. Chez un poète-essayiste, il y a souvent, dans son écriture, une grande densité de langage, une ouverture lumineuse qui ne sont pas si différentes de celles de son écriture poétique. Voilà ce que j’aime chez Baudelaire, Jouve ou Bonnefoy. Dans la fiction, l’écrivain doit souvent faire plus de concessions à la narration, à la vraisemblance. C’est sur quoi portait la fameuse remarque de Valéry.
Dans votre œuvre, quels livres vous ont été donnés ?
F. O. : Je crois que les bons livres nous sont tous donnés, mais que certains, à cause de la soudaineté, de l’urgence, de la précipitation de l’écriture, nous frappent davantage. Je pense à mon livre de poèmes Dans le sombre que j’ai presque écrit en trois mois. J’ai aussi écrit en un mois le gros du Journal dénoué que j’ai laissé décanter de 1965 à 1973. Mes deux premiers romans, dans leurs premières formes, furent écrits en un mois et même moins, en quinze jours. Bref, il s’agit toujours pour moi d’une sorte d’intensité où j’ai nettement le sentiment de recevoir le texte. Par la suite, il me faut d’autant plus travailler avec attention que le premier travail a été fait rapidement, et qu’il faut se préserver de cette rapidité.
Sur le plan de l’inspiration, le souvenir le plus marquant qui me reste est celui des Heures. Comment peut-on écrire un pareil livre ? Tout a commencé un 23 janvier au matin. Mais mon plan de travail, la veille au soir, était plutôt de mettre la main à un livre d’essais sur la poésie. Il en fut tout autrement. Quatre-vingt-deux poèmes ont été écrits en un mois. Immédiatement j’ai su qu’il s’agissait de textes très différents des poèmes que j’avais écrits huit ou neuf mois auparavant. À vrai dire Les heures est une sorte de long poème constitué de 81 séquences qu’on peut aussi appeler des poèmes. Il y a là, me semble-t-il, une écriture plus narrative, avec une véritable économie de métaphores, si je la compare à mon écriture précédente. D’où l’impact plus aigu de métaphores plus rares.
À la lecture de Lucie ou un midi en novembre, j’avais l’impression que les personnages étaient dépassés par leur vie. À quoi correspond cette fatalité ?
F. O. : Qui n’est souvent dépassé par des forces, des contraintes de l’extérieur ? La vie consiste à s’adapter et à retrouver son équilibre profond. Le problème essentiel de Lucie en est un du don de sa vie et de sa relation avec Dieu. Et, bien entendu, les antécédents tragiques de sa vie donnent une coloration particulière à son choix. Au moment où elle meurt, on peut dire qu’elle est prête pour la mort. Elle a atteint sa maturité. Meurt-elle par distraction ? Pour faire le don réel de sa vie dans le secret de sa conscience ? Le lecteur trouve ce qu’il porte en lui. S’il n’a aucune idée de ce que peut être une relation avec le sacré, il ne verra qu’un accident ou un suicide, ou un échec.
Par le passé, est-ce que des gens vous ont vu à travers vos personnages ?
F. O. : L’écriture romanesque se fonde souvent sur la vie de l’écrivain. Prenons le cas de Geneviève. J’avais d’abord imprudemment publié une autobiographie. On s’en est sans doute servi comme tremplin pour attaquer mon roman. Certains critiques ont été plus obsédés par quelques traits autobiographiques, par quelques problèmes moraux, que par mon travail sur la forme. Je ne dis pas qu’il n’y a pas des écrivains qui ont un pouvoir de transposition plus puissant que le mien, mais j’avais tout de même pensé et proposé une forme. La forme semble la dernière chose qui intéresse certains critiques.
Est-ce que vous vous percevez comme privilégié ?
F. O. : Bien entendu. On dit que quelqu’un est né sous une bonne étoile. Mais recevoir implique qu’on doive donner. Sinon le don ne peut que nous brûler. J’ai produit un peu plus d’œuvres que la plupart des écrivains de ma génération. Je me suis toujours senti dans l’obligation de travailler pour répondre au don que j’avais reçu. Je ne parviendrai jamais à dissocier l’éthique de mes actions ou des autres aspects de mon être. Mais l’écrivain véritable est celui qui se remet en question, qui joue sa vie à chaque livre. C’est une forme d’engagement total dans chaque texte. Une de mes œuvres peut être un échec, mais il vaut mieux cet échec que la réussite à partir de la facilité ou de la médiocrité. Beaucoup d’écrivains ne semblent pas avoir conscience qu’ils doivent proposer une œuvre d’art.
Est-ce important le silence ?
F. O. : Il faut du silence, puisque sans lui on ne peut se retrouver, on ne peut entendre la voix de Celui qui nous assiège. Mais j’aime aussi le son. On dit même dans certaines cultures : au commencement était le Son. Dans les cultures africaines, en particulier. Je dirais que la Lumière est le commencement de tout, mais sans doute que cette Lumière est une forme d’irradiation du Verbe. Il me semble parfois que le soleil qui se lève sur la mer est tellement puissant de beauté qu’on a presque la sensation de l’entendre. C’est une forme de silence qui se transmute en verbe et en lumière.
À travers Les heures, on croit percevoir ce monsieur qu’était votre père.
F. O. : Sans doute à cause du caractère narratif assez accentué de ce livre de poèmes. Mais ce « monsieur » c’est vous, c’est moi. J’ai utilisé le « nous » et le « il », c’est-à-dire que ce mourant c’est aussi moi, comme je suis celui qui l’observe dédoublé. Comme si j’anticipais ma propre mort, que je tentais de l’apprivoiser, d’en faire une sorte d’expérience. Comme si je tentais d’aller au bout du chemin unique en ne cessant jamais de la regarder en face, pour ne rien perdre d’une expérience que je ne pourrai transcrire lorsqu’il s’agira de ma propre mort.
Et si c’était à recommencer ?
F. O. : Je suis peu doué pour autre chose que l’écriture. Mon père était un artisan, un ébéniste. J’ai su immédiatement que je ne pourrais l’égaler, que je n’avais pas les mains assez agiles. J’ai donc appris à me méfier de mon manque d’adresse. Si j’avais une deuxième vie, j’aimerais bien jouer du piano, pour Mozart, Beethoven et Schubert. Mais enfin, c’est tellement extraordinaire d’écrire. La vie s’occupe de nos choix. Elle nous indique assez tôt nos limites.
Fernand Ouellette a publié, entre autres :
Edgar Varèse, Seghers, 1966 et Christian Bourgois, 1989 ; Dans le sombre / Le poème et le poétique, l’Hexagone, 1967 ; Les actes retrouvés, HMH, 1970 et Bibliothèque québécoise, 1996 ; Poésie (1953-1971), l’Hexagone, 1972 ; Depuis Novalis, HMH, 1973 ; Journal dénoué, PUM, 1974 et « Typo », l’Hexagone, 1988 ; Ici, ailleurs, la lumière, l’Hexagone, 1977 ; Tu regardais intensément Geneviève, Quinze, 1978 et « Typo », l’Hexagone , 1990 ; À découvert, Parallèles, 1979 ; La mort vive, Quinze, 1980 et « Typo », l’Hexagone, 1992 ; En la nuit, la mer (1972-1980), l’Hexagone, 1981 ; Lucie ou un midi en novembre, Boréal, 1985 ; Les heures, l’Hexagone / Champ Vallon, 1987 et « Typo », l’Hexagone, 1988 ; Ouvertures, l’Hexagone, 1988 ; Commencements, l’Hexagone, 1992 ; En forme de trajet, Noroît, 1996 ; Je serai l’Amour, Trajets avec Thérèse de Lisieux, Fides, 1996 ; Au delà du passage / En lisant l’automne, l’Hexagone, 1997 ; Figures intérieures, Leméac, 1997.