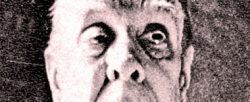Une tonne de naïveté ou une prétention puérile, tels sont les défauts requis de quiconque entreprend de présenter Jorge Luis Borges. Qui, en effet, peut le pister sur ses innombrables terrains de chasse ?
Roman policier, nouvelle, traduction, conte, biographie, préface, canular, linguistique, philosophie, fantastique, Borges explore tout, exerçant ce qu’il estime son droit, peut-être même son devoir, de vivifier le passé et d’envahir le virtuel. Inquisiteur sans bourreau, il réécrit ses écrits personnels autant que les textes d’autrui, que ceux-ci soient signés ou fantomatiques. Borges déconcerte d’autant plus que ses audaces quadrillent une large géographie linguistique et culturelle : Grande-Bretagne, France, Espagne, Italie, Allemagne, Rome et Grèce antiques, Islande et monde celtique… Comme, de surcroît, Borges interdit aux genres littéraires de clôturer l’écriture en prés distincts, son œuvre échappe aux rassurantes et osseuses classifications qui guident les acheteurs et dont vivent les universitaires. Heureusement, la séduction du style apaise la crainte révérentielle due à l’homme et l’œuvre.
Livre et mémoire
Borges est d’emblée citoyen du livre et de la mémoire. Il se dit cosmopolite, en rappelant les racines du terme (cosmos et cité), mais peut-être son pluralisme favorise-t-il les cultures décantées et quadrillées et néglige-t-il les créativités peu goûtées des cénacles universitaires. Qu’il traite de batailles plutôt que de scrutins et qu’il préfère les pamphlets aux pétitions, lui-même le reconnaît : « […] peut-être me sera-t-il permis d’ajouter que je n’accorde aucun crédit à la démocratie, ce curieux abus de la statistique ». Confession que n’atténue aucune contrition. En revanche, nul interdit ne limite son culte de l’écrit. Borges doit tout au livre et à la mémoire et la réciproque est presque vraie.
Borges est citoyen du livre parce que écrivain, mais plus encore parce que lecteur. Lui-même se dit plus fier des livres qu’il a lus que de ceux qu’il a signés. Encore faut-il comprendre que Borges transforme – enrichit, dit-il avec sérénité – tout ce qu’il lit. Homère n’est plus le même après sa rencontre avec Borges : il ne se souvient pas d’avoir écrit l’Odyssée et ne parle plus grec. Lus par Borges, Cervantès cafouille dans ses souvenirs et Dante courtise Béatrice autrement. Borges lui-même se plie aux caprices de Borges.0Ainsi, dans « L’autre », le Borges de 1969 converse, depuis un banc de parc de Boston, avec un jeune Borges qui, à Genève, hume le Rhône et rêve les projets que son aîné a oubliés… Ainsi sollicité, le miroir si cher à Borges invente et répercute des visions parentes et contrastées. Plus liés par le sang que Faust et Méphisto, Borges et Borges dialoguent au creux d’une conscience qui ne sait plus si elle est double ou simplement pareille au fleuve d’Héraclite.
Borges est aussi citoyen de la mémoire. Ce que Borges a lu, sa mémoire le garde vivant. Mais, tout comme la lecture à la Borges transforme les textes, la mémoire dépasse chez lui la simple rétention. Dès l’adolescence, Borges sait, puisque la cécité a frappé les trois générations qui le précèdent, que ses jours de lecteur sont comptés. En 1955, ce sera chose faite. L’œil de Borges, encore sensible au jaune, regrette le noir. C’est alors que la prévoyante mémoire, qui a ensilé des milliers d’anecdotes et de citations, ouvre à Borges de nouvelles avenues. Ne pouvant ni lire ni écrire, il devra ruminer ses poèmes, les mémoriser et les dicter. Alors que son ultraïsme juvénile dédaignait la versification standard, sa mémoire exigera de Borges vieillissant des poèmes aux pieds dénombrés et aux rimes dociles. Jusqu’en 1955, elle soutenait toutes les audaces ; par la suite, elle défendra la poésie contre la cécité.
Parcours sous tous les cieux
Les déplacements familiaux servent d’incubateur à Borges. Il découvre l’école à neuf ans, mais l’entourage l’a déjà initié à l’anglais et à l’espagnol. À l’adolescence, avec la famille, il découvre l’Europe, ses langues et ses littératures, mais sans quitter d’esprit la bibliothèque de son père. Quelques leçons lui valent tel baccalauréat, mais c’est du livre qu’il reçoit les stimulations significatives. Tout y passe, depuis Rimbaud (dont Une saison en enfer l’ennuie) jusqu’à Crime et châtiment (grand roman, dira-t-il). La chronologie témoigne de sa précocité : « 1917. Il se met à lire Schopenhauer qu’il a depuis lors toujours tenu pour le premier des philosophes », lit-on à la page XLV du premier tome de ses œuvres complètes éditées en 2010 dans la Pléiade1. Sa correspondance, particulièrement détendue sur son versant Abramowicz, le montre à l’aise en anglais, en français, assez conquérant pour lire Heine ou Kafka en s’aidant d’un dictionnaire.
On mesure l’ampleur du bagage quand, de retour à Buenos Aires après un deuxième périple familial en Europe, il rédige à 27 ans une conférence sur « la langue des Argentins ». Rédige est le terme juste : Borges, qui prendra goût aux conférences, invoque la gêne pour ne pas lire son texte lui-même ! Dressant son bilan personnel, il écrit : « Cette période de 1921 à 1930 fut pour moi une époque d’intense activité, peut-être en grande partie vaine et irréfléchie. J’écrivis et publiai pas moins de sept ouvrages – quatre volumes d’essais et trois de vers –, je fondai pas moins de trois revues et j’apportai une collaboration assez importante à plus d’une douzaine d’autres périodiques parmi lesquels La Prensa, Nosotros, Inicial, Criterio et Sinesis ».
La décennie suivante accentue encore sa polyvalence. Aucun chantier ne le rebute. Il a la dent dure et la polémique jouissive, mais il est renseigné, concret, bardé de références et de maillages inattendus. Les romans policiers de Chesterton et d’Ellery Queen lui plaisent, mais seules les ambiances de Simenon trouvent grâce à ses yeux ; « tout le reste relève de l’incompétence, de la fraude ou de la naïveté ». D’un film, il dira qu’il est « si mauvais qu’il mériterait d’être signé par René Clair ». À propos de Chaplin et d’Eisenstein, ses réserves feutrent les éloges. À la même cadence infernale, il multiplie les « biographies synthétiques » : Virginia Woolf, André Breton, Eugene O’Neill, Paul Valéry, T. S. Eliott, James Joyce, Somerset Maugham, Benedetto Croce… Il déguste la poésie, mais le roman lui paraît une perte de temps : pourquoi consacrer cinq cents pages à ce qui se raconte en quelques minutes ? « En 1904, écrit-il, paraît le premier volume de Jean-Christophe. Le roman en compte dix ; le héros est un mélange de Beethoven et de Romain Rolland lui-même ».
Cette production le sustente, mais il acceptera, en 1937, une sinécure dans une bibliothèque de quartier à Buenos Aires. Il y lira neuf ans durant, jusqu’à ce que Perón, dont l’épiderme est sensible et l’index rancunier, le mute à l’inspection des volailles et des lapins ! Démissionnaire, Borges est rescapé comme professeur de littérature anglaise et étatsunienne. À 47 ans, jamais Borges n’a vécu sans lien avec l’écrit.
Si Borges varie ses explorations, ses textes préfèrent le petit gabarit. Ses livres, d’une stricte logique interne, constituent des archipels littéraires et procèdent par touches plutôt que par développements. D’où des titres englobants : Le livre de sable, Le rapport de Brodie, La rose profonde, L’or des tigres, Les conjurés… Leur unité tient à un thème, non à un cheminement entêté et univoque.
Et la philosophie ?
La philosophie a très tôt intéressé Borges. Il boit de toutes les eaux, mais il adule Héraclite, Berkeley et, toujours, Schopenhauer. Son Héraclite livre le message prévu et son fleuve demeure amnésique, mais peut-être y a-t-il malentendu quant au lien entre Borges et Schopenhauer. Souvent perçu comme chantre du pessimisme, l’auteur du Monde comme volonté et comme représentation semble éveiller chez Borges un autre écho. Certes, le monde de Schopenhauer est « une gigantesque illusion produite par un Vouloir aveugle et absurde », ce qu’endosserait Borges, mais cela le contraint-il au pessimisme ? Face à un autre univers absurde, Camus ne conclut-il pas qu’« il faut imaginer Sisyphe heureux » ? Chose certaine, Borges se comporte comme si son philosophe préféré l’incitait à la libre recréation de ce monde égaré.
L’enracinement philosophique peut n’engendrer que des thèses maquillées en contes. Risque nul chez Borges : jamais sa conception du monde ne désincarne la vie. Il y a concordance entre sa philosophie et ses nouvelles, mais jamais la fiction ne joue le faire-valoir d’un système. Une entrevue accordée par Borges en 1976 à la revue Philosophy and Literature dissipe tout malentendu : « Mais je voudrais bien établir que si l’on trouve des idées dans mes textes, les idées ont surgi après la rédaction. Je veux dire, j’ai commencé par la rédaction, j’ai commencé par le récit, j’ai commencé par le rêve, appelez cela comme vous voulez. Puis, après coup, peut-être, une idée s’est présentée. Mais je n’ai pas commencé, je le redis, par la morale et je n’ai pas écrit une fable pour la justifier ». Cohérence n’est pas abstraction.
Les entêtements de Borges sont au diapason de sa culture. Par exemple, il creuse la notion d’infini non en vue d’une victoire philosophique, mais parce que l’infini ouvre à la relecture du réel. Si l’infini existe, un singe peut, à force de jongler avec l’alphabet, produire l’Odyssée. Oui, il lui faudra du temps (!), mais l’infini possède une infinie patience. Au nouvelliste d’en profiter. Borges fréquentera donc Zénon d’Élée selon qui Achille-aux-pieds-légers ne rattrapera jamais la tortue partie une seconde avant lui. Tant pis pour Aristote, Bergson et Bertrand Russell si Zénon inspire un conte.
Un peu de gris
Malgré l’avalanche de thèses consacrées à Borges, bien des gris persistent. Telle conviction, abrupte à Madrid, perd de son absolu à Buenos Aires. L’obsession de la métaphore vierge s’estompe. Rien là qui scandalise, Borges ayant, comme chacun, le droit d’évoluer. Ce qui étonne, c’est que Borges puisse plaider simultanément le oui et le non. À titre d’exemple, Borges traite le roman en exercice fastidieux, mais range Cervantès ou Dante parmi ses idoles et écrit avec Bioy Casares des ouvrages d’assez longue haleine.
Les attitudes politiques de Borges ne sont pas non plus d’une seule venue. Il fut, face à Perón, suffisamment goguenard pour indisposer le dictateur, mais Mario Vargas Llosa a raison de sursauter quand Borges rompt sa cohérence « en soutenant ouvertement deux dictatures militaires en Argentine : celle qui renversa Perón (d’Aramburu et de Rojas), et celle qui mit fin au gouvernement d’Isabelita Perón (de Videla) ». Car il n’est guère possible « d’expliquer par un simple mirage la sympathie de Borges pour le régime militaire, dont il a accepté, de surcroît et sans la moindre réticence, nominations et distinctions3 ».
Il est plus délicat encore de chercher l’amour dans l’œuvre de Borges. Marguerite Yourcenar aura raison de signaler que l’amour n’a guère retenu l’attention de ce magnifique touche-à-tout4. Même sa poésie n’évoque l’amour que par des allusions d’écorché vif. Le fait que l’équipe qui a produit avec l’auteur les deux volumes de la Pléiade fasse silence sur ce silence laisse entendre que l’invité préférait la pénombre. Les seules certitudes se situent aux extrémités du parcours. Premier fait : à 23 ans, Borges vibrait d’amour. « Elle a seize ans, elle se nomme Conception Guerrero, elle souffre dans une extrême banlieue… […] Elle est très belle, argentine, de parents andalous. » Deuxième fait, Borges ne contractera un premier mariage qu’à 67 ans. Entre ces pôles, à peine quelques vers diront la douleur qu’éprouve Borges à ne pas avoir eu de fils. C’est à la littérature que le citoyen du livre et de la mémoire a laissé son immense legs.
1. Jorge Luis Borges, Œuvres complètes, T. I, traduction collective de l’espagnol, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, Paris, 2010, 1856 p. ; 130 $.
2. Robert Laffont et Valentino Bompiani, Dictionnaire des auteurs, T. 2, Robert Laffont, 1958, p. 548.
3. Mario Vargas Llosa, Un demi-siècle avec Borges, L’Herne, 2004, p. 82-83.
4. Sous la dir. de Pierre Brunel, Borges, Souvenirs d’avenir, Gallimard, 2006, p. 422.