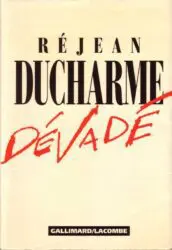Puisqu’ils demandent peu à la vie, les personnages de Dévadé ne lui gardent pas rancune de ses parcimonies. Ils sautillent d’expédients en dépannages, rescapent qui les a rescapés, ajustent leurs verdicts sur autrui au gré des attraits sexuels et des services rendus ou attendus, mais on les trouvera plus souvent déterminés et debout qu’à genoux et larmoyants. Seraient-ils donc aveugles au point de ne pas identifier la mouise même quand ils la subissent jour après jour ? Certainement pas. Ils perçoivent leur situation nettement et ne manquent pas de références culturelles pour la décrire. Celle qui détecte une ressemblance entre Bottom – un Lafond de souche rebaptisé à l’américaine – et le Meursault de L’étranger est comprise quand elle ose le parallèle. Leur choix de films leur fait honneur : Straw Dogs de Sam Peckinpah, Midnight Cowboy avec Dustin Hoffman, Dishonored avec Marlene Dietrich… Leur quotidien est aéré par les allusions à Goya, à Baudelaire, au Bauhaus, à Mahler, à Benjamin Constant, à Nietzsche, à Leconte de Lisle, à Rubens… Qu’ils croupissent dans d’infects habitats ne leur interdit pas d’ouvrir largement les fenêtres et de trouver partout de quoi tromper leur vide.
À défaut d’être incultes et myopes, seraient-ils abattus, à plat ventre dans la résignation ? Pas davantage. La Patronne ? Elle vit un drame depuis que « son mari, grand chef de cabinet stressé par la crise d’Octobre, s’est mis en marche arrière pour avancer, lui broyant les genoux entre le pare-chocs et le fond du garage alors qu’elle pressait le battant mal verrouillé de la malle », mais elle a juré de traverser sa cuisine debout et sans aide d’ici peu. Bottom, que la Patronne utilise à toutes les sauces et qui tient entre autres le rôle de lady Chatterley’s Laveur, brandit quand même en gloires personnelles ses soifs de femmes et de bière. Quand Lucie, lumière et amour de son enfance, a accepté d’épouser un autre homme, sa réaction a été brutale : « J’ai pris le cric dans notre bagnole et j’ai été massacrer la limousine enrubannée ». À 30 ans, le volcan Bottom n’a pas encore dompté ses éruptions. Quant à Juba, Bottom l’aime au point d’attendre dans la fièvre l’appel téléphonique qu’elle lui consent chaque soir, souvent pour lui parler d’un autre homme. C’est « le tchou tchou donzeur ». « Elle est tombée bas, mais elle descend de la Cahina d’Ouarzazate, qui s’est unie aux Berbères du pacha El Glaoui pour lutter de ses propres mains contre l’invasion musulmane. » Et d’autres, auprès de ces pivots, ragent, combattent, rebondissent. Non, pas plus démissionnaires qu’aveugles.
Ce ne sont pas non plus, surtout pas, des romantiques éthérés. Quand la Patronne entreprend l’héroïque traversée de sa cuisine qui se terminera par une culbute après quatre pas, Bottom sait le bonheur peu durable : « Elle se met à rire. Ça me fait plaisir mais ça me fait peur. C’est trop beau pour que ça dure. Même si ça ne dure que depuis cinq minutes et qu’elle vient de bouder toute une journée sans que je m’inquiète. Comme si on ne pouvait pas se bidonner sans danger mais grincer des dents en toute sécurité. Comme s’il n’y avait de confort que dans le malheur ». Leur destin, ils le savent, est de survivre sans illusion dans leur impasse, d’imiter Sisyphe même s’ils ne roulent qu’un tout petit rocher. Ils admettraient que Camus a raison d’« imaginer Sisyphe heureux », mais ils insisteraient encore plus que lui pour que le bonheur doive tout à la lucidité et rien à l’espoir. « […] elle veut absolument savoir en quoi j’aimerais me réincarner… En vieux dégoûtant. Comme tout le monde. Pour bien expier. Mais je garde ça pour moi. » Bottom est paumé, mais il ne croit pas qu’il puisse en être autrement : « […] la beauté du devoir de n’appartenir qu’à ce qui me grandit me retient moins que le danger de me faire piéger, de m’offrir un luxe dont je ne pourrai plus me passer et que je ne pourrai plus me payer. Je tiens à l’habitude que j’ai de ma pauvreté… » Telle autre, que croise Bottom, attend si peu de l’existence qu’elle ressent le besoin non pas d’amis, « mais de personnages dans son théâtre d’échec ». Bottom convient tout au plus que la chance peut parfois remplacer l’inexistante justice : « Ce qui nous tient c’est l’espoir de nous sauver, nous évader, profiter du désordre, de la confusion, de la catastrophe pour échapper à la justice justement… » La seule consolation, si c’en est une, c’est que les paumés, peut-être tous les humains, se sentent et se savent « du même bord ».
L’inimitable écriture de Ducharme insère constamment l’humour dans la faillite. L’autodérision, à ne pas confondre avec le misérabilisme larmoyant, exorcise le tragique tout en le gardant présent. Prendre du recul grâce à l’humour, c’est défier et peut-être assourdir la douleur. Le banal, dans son humilité, s’emplit alors d’une tendresse que l’écriture répercute : « Il n’y avait que ses pieds dans les bottes fourrées. Tout engourdis par le sommeil des trop petits, tout sagement rangés par ordre de grandeur, et comme blessés par leurs masques limés, vernis, plantés dans la peau, ses orteils m’ont sauté aux yeux. J’ai vu rose. Elle m’a pris sur le fait. Elle m’a laissé faire ». Puis la pensée profonde jaillit au détour d’un paragraphe et se permet de fulgurants raccourcis. « J’ai vieilli vingt ans plus vite que moi », reconnaît Bottom ; « On a hâte de recommencer à vivre comme si c’était à notre portée » ; « Ma propre vie, que je ne lui conte pas, parce que ce qu’on dit on le dépense, a duré six mois… » Pourtant, aucune distance ne se creuse entre le quotidien qui bat dans la simplicité des détails et ces sentences verticales et concluantes. Ce qui tient lieu de vie se déroule jour après jour dans l’ignorance de ce que préféreraient les humains, puis, le verdict tombe, désenchanté et pourtant lourd de tout ce qui vient d’être vécu et narré.
Telle est la fraternité des paumés.
EXTRAIT
J’ai mal tourné. À dix-huit ans, je rêvais d’être un poids mort, un fardeau, petit peut-être mais qui y tient, de tous ses dérisoires moyens, sans jamais les perdre, comme il y en tant, amers et timorés, rongés jusqu’au trognon.
p. 153