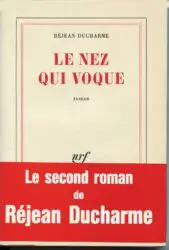J’étais encore une enfant quand j’ai lu pour la première fois Le nez qui voque de Réjean Ducharme. Je fréquentais l’université, mais je pouvais encore me croire contre la bande des adultes. Je ne possédais à peu près rien et ne travaillais pas, dilapidant prêts et bourses en toute insouciance. C’est en lisant le roman vingt ans plus tard que je me suis souvenue de moi à cette époque. C’est en me revoyant lire Le nez qui voque que j’ai compris que l’enfance, chez moi, s’était cramponnée.
On voudrait parler d’un livre avec une totale distanciation. Comme lorsqu’on parle de Mérimée ou de Balzac. On sort ces outils qui ne servent presque à rien depuis l’université : psychanalyse, sémiotique, narratologie, tautologie… ou on fait son Ducharme, une autre façon de s’en sortir. Ou bien on le cite à tour de bras : « Il y a des coups de pieds (sic) qui se perdent, écrit Ducharme. Il y en a qui ont le culte de la niaiserie grave. Il y en a qui passent leur vie à rester gravement penchés sur les problèmes de logistique que soulève la lecture des cris et des grimaces de Rimbaud. Il y en a qui cherchent à comprendre ! » Qu’importe, ajoute l’auteur, si ce que l’on cherche est complètement insignifiant. Pourvu que ça maintienne un semblant de sens dans nos vies. Maintenant, il y en a qui sont des spécialistes de Ducharme, et qui trouvent encore dans ses livres, à force de dissections, des choses nouvelles et très sérieuses. Quand on le lit lorsqu’on est enfant, même sur le tard, on ne cherche pas à comprendre, c’est comme si son monde allait de soi, qu’il était calqué sur notre vie.
Quand on a viré son capot de bord, qu’on s’est fait avoir, en somme, les choses vont moins de soi. L’on se demande comment on a pu, par exemple, s’identifier à Chateaugué, l’héroïne du Nez qui voque, jeune fille de quatorze ans, pure, grave, extrême, et ne pas entendre toute la haine contre les femmes qui déferle dans ce livre. Vingt ans plus tard, on est assurément une femme, plus d’échappatoire. On fait partie de celles par qui le malheur arrive pour l’autre personnage, Mille Milles, adolescent de seize ans, qui s’en va, malgré lui et inexorablement, vers le monde des adultes. La femme désenracine le garçon de la terre de son enfance, elle le pousse à partir et pour cela il la hait profondément. Quand on a encore un pied dans cette terre de l’enfance, et qu’on lit ce roman, on hait Mille Milles lorsqu’il cesse de haïr les femmes parce qu’il abandonne du même coup Chateaugué, qui sera jusqu’à la fin le château fort de l’enfance. De la même manière que l’on hait l’automobile, le travail – « Travailler ? Pourquoi ? Pour gagner notre vie ? La vie est gratuite, voyons ! » – ; ce monde qui promet de l’avenir par l’absence de présent, le mensonge, la guerre, la mort lente. Comme l’explique Mille Milles à Chateaugué qui ne veut pas comprendre, « [c]’est ça être adulte. Tout ce qui était plat se met à creuser des abîmes sous tes pas. Tout ce qui était léger se met à t’écraser. De l’ère des rires et des chagrins, tu passes à l’ère des délires et des désespoirs. Ta vie devient vaste comme toute la vie ». Néanmoins, quand on est ce qu’on appelle un adulte, on développe une forme neuve d’inconscience, de platitude. On ne se souvient plus de la révolte lucide et de l’indépendance de jadis. On plie, nous montre Mille Milles, on s’étend. Alors que Chateaugué est seule à s’enfoncer à force de porter le poids de l’enfance sur son dos. À force d’être la seule à vouloir tenir la promesse qu’ils se sont faite, elle et Mille Milles : celle de se « branle-basser » – pour ne pas dire de se suicider. Car vieillir, évidemment, serait la pire des défaites. « Je ne veux pas continuer car je ne veux pas finir fini. »
Quand on lit Ducharme enfant, si l’on n’est pas désespéré au point de vouloir mourir, on croit tout de même que la lucidité réside dans le fait de ne rien posséder et de n’être possédé par rien ni par personne. Est-ce une si grande trahison que de se réveiller un bon matin entouré de choses et d’êtres ? Qu’est-ce que cela peut bien changer au bout du compte ? À vingt ans, je vendais à L’échange Le nez qui voque pour un café. Mais j’étais déjà comme Mille Milles, corrompue par les rêves d’avenir, des semblants d’idéaux, même si je voulais ressembler à Chateaugué.
EXTRAIT
Chaque fois que nous entendons ce qu’infatigablement l’âme répète, tout en nous se masse, se serre, s’arc-boute et cherche avec fièvre, avec fureur, avec folie et avec désespoir à se catapulter hors de nos corps pareils à des sous-marins pleins d’eau. Quelque chose en nous est prisonnier et étouffe. Seul le branle-bas peut délivrer ce quelque chose d’attaché en nous qui souffre comme un aigle fixé par une patte dans le ciment d’un trottoir.
Le nez qui voque, Gallimard, 1967, p. 164.