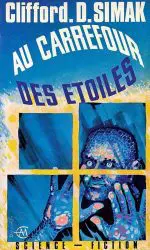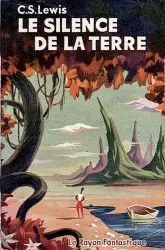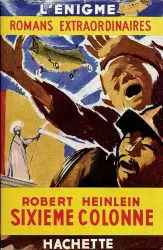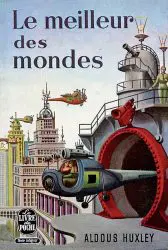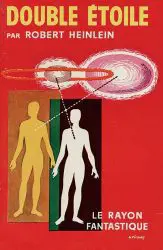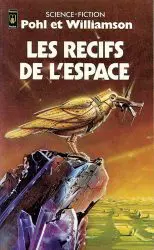 Décrire le monde où nous habitons, reconstituer celui de nos ancêtres, imaginer celui que connaîtront nos descendants : triple entreprise de la littérature et singulièrement, du roman.
Décrire le monde où nous habitons, reconstituer celui de nos ancêtres, imaginer celui que connaîtront nos descendants : triple entreprise de la littérature et singulièrement, du roman.
Mais alors que le roman est avant tout sollicité par le présent et le passé, le futur y occupe une place marginale, les récits qu’il inspire étant, comme les polars ou les thrillers, relégués dans une catégorie distincte, qui a ses enthousiastes et ses détracteurs, alimentée par des professionnels de la plume, consacrée au divertissement. Littérature d’assouvissement, dirait Malraux – ce qu’elle est souvent au premier chef. Cependant il est facile d’y lire des questions sur notre condition humaine, des désirs, des peurs, des espoirs et des hypothèses qui font éclater le cadre dans lequel on veut l’enfermer. Et chaque œuvre doit faire face à la gageure de faire entrer la science dans la littérature…
Si la science-fiction a des précurseurs depuis au moins le XVIIe siècle par les envolées vers la Lune et le Soleil de Cyrano de Bergerac puis Les voyages de Gulliver, c’est bien entendu avec les inventions ingénieuses et parfois bien naïves de Jules Verne que naît véritablement le genre. Au XXe siècle se produit son expansion, voire son explosion, qui coïncide sans surprise avec celle des découvertes scientifiques et de leurs applications techniques. Quand Asimov commence à publier ses histoires vers la fin des années 1930, il a des devanciers qui l’inspirent et envers qui il reconnaît sa dette : Frederik Pohl, Clifford D. Simak, Theodore Sturgeon et bien d’autres. « En 1949, on a indubitablement reconnu en moi un auteur de science-fiction de premier plan… On commençait à parler du trio Heinlein, Clarke, Asimov comme des ‘Trois Grands’ », écrit-il sans excès de modestie dans son autobiographie Moi, Asimov. Fort heureusement, il ne manque pas d’humour et malgré son fabuleux succès il n’oublie pas ses débuts difficiles et ses échecs.
Un phénomène littéraire
L’œuvre, avant même qu’on l’ouvre, stupéfie par son volume. L’auteur se dit « prolifique », pour le moins : il recense plus de 450 titres qui témoignent d’une fécondité imaginative hors norme et d’une capacité de travail qui ne l’est pas moins. En fait, sa vie est consacrée exclusivement à l’écriture. L’œuvre où les chroniques de vulgarisation scientifique tiennent une place à part mais complémentaire est d’abord et avant tout une suite d’histoires. Ou plutôt une seule histoire sans cesse reprise, enrichie, augmentée, celle d’une conquête et de ses avatars par laquelle l’homme, grâce aux perfectionnements de sa technique et de ses propres pouvoirs, s’est établi en d’innombrables planètes de notre galaxie, et dans son rêve d’hégémonie universelle, ambitionne d’en franchir les limites. Le ciel n’en est plus une pour lui.
Quand Asimov parle de science et à la différence d’autres auteurs de science-fiction, il le fait en  connaissance de cause. Il a étudié les mathématiques, la chimie, la physique, obtenu un doctorat en biochimie, ce qui donne une relative crédibilité à ses anticipations. Parfois il nous inflige, comme Jules Verne en son temps, des explications et des théories qui laissent perplexe le lecteur, si elles ne l’incitent pas à sauter des pages… On voit ici à l’œuvre un procédé bien connu du genre qui consiste à extrapoler le futur à partir de l’état actuel de nos connaissances et à les pousser à des extrémités où toutes les prouesses humaines virtuelles se réalisent. Le reste est fiction… Mais celle-ci n’est pas gratuite puisque tout ce qui touche l’humanité y a droit de cité : son histoire, sa nature, son organisation, ses institutions, son environnement, sa culture, ses capacités mentales. Tout ou presque tout.
connaissance de cause. Il a étudié les mathématiques, la chimie, la physique, obtenu un doctorat en biochimie, ce qui donne une relative crédibilité à ses anticipations. Parfois il nous inflige, comme Jules Verne en son temps, des explications et des théories qui laissent perplexe le lecteur, si elles ne l’incitent pas à sauter des pages… On voit ici à l’œuvre un procédé bien connu du genre qui consiste à extrapoler le futur à partir de l’état actuel de nos connaissances et à les pousser à des extrémités où toutes les prouesses humaines virtuelles se réalisent. Le reste est fiction… Mais celle-ci n’est pas gratuite puisque tout ce qui touche l’humanité y a droit de cité : son histoire, sa nature, son organisation, ses institutions, son environnement, sa culture, ses capacités mentales. Tout ou presque tout.
Pas d’éniggmes sans solutions
Alors que dans cette littérature d’anticipation, que ce soit chez H. G. Wells, George Orwell ou Aldous Huxley, le futur est souvent vu gros de menaces – principalement le péril nucléaire, les manipulations génétiques ou les totalitarismes –, donc lourd d’angoisse, Asimov se classe résolument et de son propre aveu du côté de ceux qui ont confiance en l’avenir. Et pourtant nombre de ses récits semblent démentir cette attitude : que de luttes intestines et meurtrières dans l’empire de Fondation, de guerres et de destructions ! La science du futur ne semble guère avoir amélioré l’homme.
Asimov fait profession d’un rationalisme radical : « À aucun moment, je dis bien aucun, je n’ai ressenti la moindre attirance pour les religions, quelles qu’elles soient. La vérité est que je ne ressens pas ce fameux vide. J’ai une vision de la vie qui m’est propre et où le surnaturel n’a pas sa place, sous quelque forme que ce soit ; et cette vision me satisfait pleinement. En bref, je suis rationaliste et je ne crois qu’en ce que la raison me présente comme rationnel » (Moi, Asimov). Malgré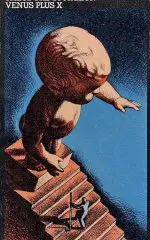 , semble-t-il, quelques percées de l’irrationnel, comme dans Le seigneur des mouches, qui n’est peut-être qu’un jeu parodique, tout est donc susceptible d’explication. Le mystère correspond à une ignorance temporaire des personnages et à une abstention délibérée du narrateur : quand le suspense s’achève, le mystère disparaît, à l’instar du roman policier dont Asimov emprunte abondamment les ressorts, et à l’inverse du récit fantastique comme chez Lovecraft.
, semble-t-il, quelques percées de l’irrationnel, comme dans Le seigneur des mouches, qui n’est peut-être qu’un jeu parodique, tout est donc susceptible d’explication. Le mystère correspond à une ignorance temporaire des personnages et à une abstention délibérée du narrateur : quand le suspense s’achève, le mystère disparaît, à l’instar du roman policier dont Asimov emprunte abondamment les ressorts, et à l’inverse du récit fantastique comme chez Lovecraft.
Le positif, rien que le positif
Le récit s’installe d’emblée dans le factuel, le concret, voire le prosaïque. Le style ne doit pas faire écran, il est net, sans enflure ni fioriture.
Après Cailloux dans le ciel, Asimov a voulu renoncer à « faire littéraire ». Il n’est pas sûr que le récit y  gagne toujours et l’efficacité recherchée ne lui fait pas éviter une sécheresse qui semble souvent inhérente au genre de la science-fiction. Les personnages, seulement des humains assistés de leurs robots, sommairement caractérisés malgré un effort visible pour leur donner une certaine complexité, sont des techniciens et des technocrates, des organisateurs, des voyageurs et des bâtisseurs ou des marchands. On n’en voit guère rêver sur l’étrange beauté des astres ni sur le destin de l’homme. Ils n’ont pas le temps, requis par leurs travaux et leurs trafics avec un constant souci d’efficacité. Ils sont toujours dans l’action et dans le moment. Un érudit qui a étudié les mythes anciens y fait figure de professeur Tournesol. Et cependant Asimov avoue que lui-même aurait aimé être historien…
gagne toujours et l’efficacité recherchée ne lui fait pas éviter une sécheresse qui semble souvent inhérente au genre de la science-fiction. Les personnages, seulement des humains assistés de leurs robots, sommairement caractérisés malgré un effort visible pour leur donner une certaine complexité, sont des techniciens et des technocrates, des organisateurs, des voyageurs et des bâtisseurs ou des marchands. On n’en voit guère rêver sur l’étrange beauté des astres ni sur le destin de l’homme. Ils n’ont pas le temps, requis par leurs travaux et leurs trafics avec un constant souci d’efficacité. Ils sont toujours dans l’action et dans le moment. Un érudit qui a étudié les mythes anciens y fait figure de professeur Tournesol. Et cependant Asimov avoue que lui-même aurait aimé être historien…
Totalitarisme pas mort !

Ce monde fonctionnel organisé rationnellement a encore une religion. Elle est étrange : un culte de la science qui a conservé les caractères – et les tares – des anciennes religions, leurs dogmes, leurs rituels et interdits. Elle suscite le fanatisme entretenu par une classe cléricale assoiffée de domination. Asimov insiste : elle est une imposture. Il s’attache avec délectation à ces mécanismes et à ceux qui tirent les ficelles dans les hautes sphères du pouvoir, en particulier dans le cycle de Fondation. La politique y tient autant de place que la technologie, l’une servant l’autre. Quand il décrit le règne impitoyable de l’Empire sur les nations qui coexistent dans la galaxie, libre au lecteur de le mettre en parallèle avec celui d’une superpuissance de notre siècle.
Dans un lointain futur des hommes ont quitté la Terre, se sont installés sur des planètes de notre galaxie, y ont créé des civilisations nouvelles. Le thème de la migration cosmique est peut-être chez Asimov, lecteur de la Bible, l’écho plus ou moins inconscient de l’histoire du peuple juif. Les migrants de l’espace, cependant, ont oublié la Terre première à un point tel qu’ils doutent de sa réalité et qu’elle est devenue objet de légende. Dans Terre et Fondation, un cosmonaute habité par une nostalgie insolite essaye de la retrouver dans la galaxie et de comprendre pourquoi son souvenir a été occulté : belle et féconde trouvaille d’intrigue.
Mais les robots ? Mais les hommes ?
En regard du repère central qu’est Fondation s’édifie celui des robots qu’Asimov a voulu opposé et 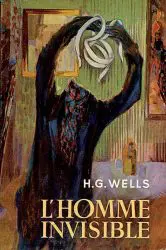 complémentaire. Lieu commun de la science-fiction, il est aussi un point nodal de réflexion et d’ambivalence puisque s’y ouvre la problématique du rapport de l’homme avec la technique. Qui dicte sa loi à l’autre ? L’homme ne risque-t-il pas d’être évincé par sa création, du moins de se confondre avec elle ? La question est alors moins de savoir en quoi les robots sont différents de nous que de comprendre en quoi nous sommes différents d’eux… En d’autres termes : qu’est-ce qui fait la spécificité de l’être humain? Certes ces humanoïdes n’ont d’autre destin que celui des machines, ils se dégradent et « meurent », mais leur psychisme est parvenu à un tel degré de perfectionnement qu’il les rend capables de sentiments et leur intelligence peut devancer celle des hommes.
complémentaire. Lieu commun de la science-fiction, il est aussi un point nodal de réflexion et d’ambivalence puisque s’y ouvre la problématique du rapport de l’homme avec la technique. Qui dicte sa loi à l’autre ? L’homme ne risque-t-il pas d’être évincé par sa création, du moins de se confondre avec elle ? La question est alors moins de savoir en quoi les robots sont différents de nous que de comprendre en quoi nous sommes différents d’eux… En d’autres termes : qu’est-ce qui fait la spécificité de l’être humain? Certes ces humanoïdes n’ont d’autre destin que celui des machines, ils se dégradent et « meurent », mais leur psychisme est parvenu à un tel degré de perfectionnement qu’il les rend capables de sentiments et leur intelligence peut devancer celle des hommes.
Leur manque-t-il une âme, ce qui supposerait une transcendance qu’Asimov refuse ? Quand il emploie (rarement) ce mot, il lui donne plutôt le sens d’activité mentale qu’il croit possible d’accroître bien au-delà de ce qu’elle est aujourd’hui. Y compris avec la capacité d’agir sur les autres, de les manipuler à des fins négatives, ce qui donne dans les récits l’occasion d’effleurer par la bande le problème de la responsabilité morale et celui du mal.
Où est le progrès ?
Dans l’esprit d’Asimov cette humanité future capable de tous les exploits et de tous les raffinements dans son habitat, son outillage, ses moyens de transport, son environnement quotidien, ses connaissances scientifiques, n’est pas foncièrement différente de ce qu’elle est aujourd’hui : menée par les mêmes impulsions, la cupidité et le cynisme, la soif de conquête et de pouvoir, le même égoïsme personnel et collectif. Il n’y a pas plus d’amour dans cet univers cosmique guetté par la solitude et l’ennui.
Le futur très lointain n’annonce ici ni utopie – dans le sens d’une possibilité plus grande de bonheur pour tous – ni catastrophe où l’univers s’effondrerait dans le chaos et le néant définitif. Plutôt la prolongation de ce que nous vivons par cycles de paix et de conflits. Et son extension à peine imaginable puisque l’humanité s’est multipliée dans d’innombrables mondes.
Un ingénieur qui voit grand
Ne demandons pas à l’œuvre ce qu’elle ne peut offrir dans les limites de son rationalisme. À coup sûr pas une vision eschatologique de l’humanité : il n’y a pas de projet divin. L’existence de l’univers est un fait à prendre comme tel. Inutile de s’interroger sur ses fins dernières, ni sur ses origines. Ce questionnement est à chercher chez d’autres écrivains qui ont pratiqué le roman d’anticipation – domaine qui englobe la science-fiction, par exemple chez Werfel (L’étoile de ceux qui ne sont pas nés) ou Döblin (Montagnes, mers et géants). Faut-il voir en Asimov un novateur ? Il ne l’est pas dans la forme de ses récits qui reprennent des procédés éprouvés sans se démarquer vraiment de ceux de Theodore Sturgeon ou de Philip K. Dick, mais il leur donne une ampleur exceptionnelle, une organisation et une structuration solides. Dans les divers cycles il pratique d’abondance le dialogue serré, l’appareillage ingénieux de l’intrigue avec ses relances et, comme dans le roman policier, l’art du suspense à travers des confrontations en forme de parties d’échecs dont l’issue est décisive. On ne peut guère parler non plus d’innovation dans le choix des thèmes, qui, en gros, sont traditionnels dans le genre, traités notamment par Sturgeon ou Arthur C. Clarke, que ce soit le voyage spatial, les robots ou les capacités supramentales.
Asimov prophète et visionnaire ? Sans doute l’œuvre est-elle plus le produit d’une construction que d’une vision spontanée. Asimov est dans son genre un étonnant bâtisseur, aux larges vues à la fois dans le monde qu’il imagine et dans sa mise en œuvre littéraire. Elle s’ouvre cependant sur des perspectives possibles, voire vraisemblables, non seulement dans l’exploration de l’espace à partir de nos sauts de puce et dans le développement de pouvoirs psychiques reconnus aujourd’hui encore avec réticence, mais dans une projection de la connaissance. À preuve cette science nouvelle sur laquelle est bâti le cycle de Fondation : la « psychohistoire », qui emprunte aux mathématiques et à la psychologie des masses pour interroger, voire déterminer le futur.
L’œuvre dans son ensemble constitue un vaste roman d’aventures qui bourgeonne en épisodes et personnages multiples. Parlons (en forçant un peu…) d’épopée cosmique avec ses inspirateurs, ses héros et ses félons, ses luttes, ses chocs de civilisations. Mais une épopée que n’emporte pas le lyrisme : son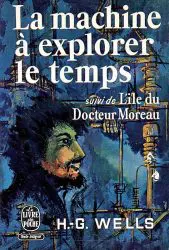 mouvement est d’un autre ordre. Pour trouver aux aventures spatiales du futur une « aura » poétique, un sentiment d’inquiétante étrangeté, il faut regarder du côté de Bradbury, de C. S. Lewis, de Stanislas Lem. L’œuvre d’Asimov étonne et tient en haleine plus qu’elle n’émeut ou fait rêver, et elle alerte. Face aux abîmes de l’espace et du temps, elle s’interroge sur la maîtrise à laquelle peut parvenir l’homme, sur sa propre évolution, les formes que prendra l’humanité, ses progrès et l’éthique qui en est inséparable, sur son aptitude à résister, à innover et à se rajeunir.
mouvement est d’un autre ordre. Pour trouver aux aventures spatiales du futur une « aura » poétique, un sentiment d’inquiétante étrangeté, il faut regarder du côté de Bradbury, de C. S. Lewis, de Stanislas Lem. L’œuvre d’Asimov étonne et tient en haleine plus qu’elle n’émeut ou fait rêver, et elle alerte. Face aux abîmes de l’espace et du temps, elle s’interroge sur la maîtrise à laquelle peut parvenir l’homme, sur sa propre évolution, les formes que prendra l’humanité, ses progrès et l’éthique qui en est inséparable, sur son aptitude à résister, à innover et à se rajeunir.