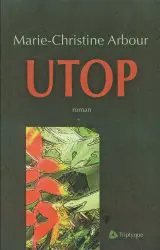Le quatrième roman de Marie-Christine Arbour joue avec la notion d’exotisme, à travers le regard d’un narrateur, Leucid Roy, incapable de saisir ce qui l’entoure autrement que par fragments ou vérités assénées, renvoyant au corps, aux pulsions, au besoin de renouvellement d’un monde terne, évidé. Leucid visite, dans un voyage semi-organisé, la jungle équatorienne, au moment où les contacts se normalisent entre les communautés amérindiennes et l’État. Jamais le récit ne s’attache à l’existence de ces « Indiens » ni ne met en perspective leurs manières de vivre ; le filtre posé sur ce voyage est celui de la dynamique du groupe, des impressions physiques et sensorielles d’un narrateur se cherchant dans une jungle opaque.
Cette quête identitaire passe par l’étranger absolu, qu’on utilise pour fuir ses démons, tout en les justifiant par l’incapacité de vivre si différemment. Elle est aussi le fait d’une identité sexuelle ambiguë, liée au mode de vie montréalais de Leucid. Ce roman, qui capte l’ambiance de la fin des années 1970, entre la fête et le désenchantement, entre le corps communautaire et la fragmentation des apparences, oppose la nature inviolée où les « Indiens » sont en adéquation avec leur territoire à la « culture de club » d’une jeunesse complexée, hésitante, comme des David Bowie perdus, entre la beauté de l’instant et le désir de perpétuité. Il en résulte un roman de l’introspection, de la fissure à exposer et à cacher, d’une soif de beauté à trouver hors soi. Si les clichés fécondent le travail de représentation de la sauvagerie continentale, ils relèvent surtout d’un besoin de métamorphose, d’élévation, recherche au final déçue. Le titre du roman, Utop, décrit une utopie qui n’existe que comme palimpseste effacé, celui d’une vie autre, incarnée par le chef du village amérindien, Bolivar, capable d’une danse gracieuse sur une pirogue, qui reprend pour Leucid le motif utérin. Il marque aussi cette incapacité à trouver le lieu d’une élévation (une absence de hauteur, u-top) à laquelle se raccrocher pour lutter contre la circularité de la nuit ludique.
Grâce à des phrases brèves, à portée totalisante, échappant aux objets décrits, aux personnes présentées (ce qui lasse à la longue), Arbour éclaire les périphéries des choses, de même que leur intériorité présumée. Avec moult adages, aphorismes décalés, mots d’esprits oscillant entre le chagrin et la lucidité autopunitive, Utop est moins un récit de voyage à la rencontre de l’altérité insaisissable qu’une traversée des faux-semblants qui modèlent l’existence de personnages en fuite du réel. À trop chercher ces phrases conclusives, ces sentences coups de poing, le récit en perd sa fluidité, bien qu’il réussisse à capter l’incompréhension, dans un huis clos d’un type nouveau : dans la jungle ne demeure que l’espace aménagé d’une prison touristique où les menaces sont la noyade, la fièvre, le menu quotidien.