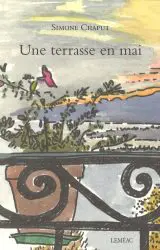Simone Chaput récidive avec un roman qui aborde ses thèmes de prédilection – les rapports familiaux, l’amour, le voyage, l’écriture et le temps – mais cette fois dans une forme plus polyphonique.
On sent là une écrivaine qui maîtrise pleinement son art. L’histoire est simple, mais se complexifie du fait de sa structure, les récits en parallèle se répondant comme les instruments de musique dans une symphonie. Chaque année, l’écrivaine Marijke Leidecker convoque son éditeur Marc-Olivier Thibeault sur une terrasse du pays où elle a passé l’année à écrire une nouvelle « biofiction », dans laquelle elle imagine la vie d’un artiste peintre. Elle est obsédée par son père mort tragiquement, lui-même peintre de grande renommée, et son écriture est mue, semble-t-il, par le désir de le ressusciter. Sa mère, moins présente dans ses pensées, est aussi une figure marquante. Pianiste étoile, elle sombre dans la folie à la suite du décès de son mari.
Le roman raconte donc, dans dix chapitres qui correspondent à autant d’années, de rencontres et de biofictions, cinq histoires, en parallèle. Il y a d’abord les séquences qui relatent les rencontres sur les diverses terrasses, mais elles ne sont qu’un prétexte car elles servent surtout de cadre au récit que Marijke fait à Thibeault de l’histoire d’une « petite ». Dans ces deuxièmes séquences, les seules racontées à la première personne, les voix de Marijke et de Thibeault alternent. Il s’agit en fait de l’histoire de sa vie qu’elle raconte, à la manière de Schéhérazade, dans de courts récits annuels, plutôt que quotidiens, qui gardent son interlocuteur en suspens. Petit à petit, fasciné par ce récit qu’il devine être celui de sa vie, Thibeault tombe amoureux de Marijke. Pour une raison qu’il ignore, elle ne peut pas lui dévoiler toute l’histoire. Ce n’est qu’à la fin du livre que le secret, qui les concerne tous les deux, sera dévoilé.
L’histoire de la « petite » est, à mon avis, la trame principale du roman sur laquelle se greffent les histoires des autres personnages. S’ajoutent donc à ces scènes les séquences qui racontent la rencontre, l’amour et la vie conjugale des parents de Marijke, Kes et Amélie ; celles qui portent sur l’amour de Thibeault pour son épouse Andréanne et la tension grandissante dans leur couple due aux voyages annuels de Thibeault et enfin celles qui racontent la vie de Marijke alors qu’elle découvre un nouvel artiste sur qui écrire et prend un nouvel amant dans des pays chaque fois différents. Chaque histoire provoque un léger tremblement qui, comme une onde sismique, pousse les personnages des autres trames narratives à ressentir un trouble, que ce soit la jalousie d’Andréanne, l’amour de Thibeault ou la détresse cachée de Marijke. Tout commence en fait lors de la rencontre de Kes et d’Amélie et à cause de la force de leur amour qui réorientera le cours de leur vie et transformera celle des personnes qu’ils côtoyaient auparavant. Cette réaction en chaîne est la structure du roman.
Simone Chaput a ce talent rare d’écrire des romans d’une simplicité apparente, mais qui sont en fait très complexes. Ainsi, dans Une terrasse en mai, au-delà de la structure narrative polyphonique, le cadre géographique du roman multiplie les lieux et les détails qui les rendent vrais. Que ce soit le Winnipeg natal d’Amélie, Amsterdam où vit Kes lorsqu’elle le rencontre, Liège où habite Thibeault, qui se rappelle toutefois les forêts de son Québec d’origine, ou encore les nombreux pays que visite Marijke, dont l’Écosse, l’Italie, la Grèce, la Croatie, l’Espagne, ces lieux, convoqués par quelques détails, une ambiance, des langues entendues dans la rue, sur les terrasses ou dans les autobus, connotent la quête de Marijke, son errance perpétuelle, bien qu’elle tente, comme Ulysse, de retrouver son port d’attache. De même, les références à la peinture, à la musique et à la littérature abondent, mais de façon discrète. Convoquéespar les métiers respectifs de Kes, d’Amélie et de Marijke, elles constituent néanmoins un cadre interprétatif à partir duquel le roman acquiert une profondeur. La langue de Chaput est un plaisir. Elle aime les mots, les manipule avec soin, les engrange, les sort au besoin pour leur pouvoir d’évocation et de précision. En cela, elle ressemble à Marijke,« friande de mots » qu’elle recueille « comme autant de perles glissées vers elle sur un fil de soie ». La précision du vocabulaire, la beauté de la langue, les jeux rares mais à point sur les niveaux de langue, de même que l’emploi répété du discours indirect libre qui donne à entendre chaque personnage font de ce roman un petit bijou langagier. Enfin, la structure temporelle serait à analyser en détail, car le temps est sans conteste le thème central du roman : comment remonter le temps, comment prendre le temps, comment se réconcilier avec le passé, comment se construire un futur ne sont que quelques-unes des questions qui hantent les personnages.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...