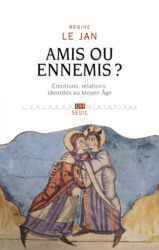« L’écriture n’a été que pour remplir le vide, permettre de dire et de supporter le souvenir de 58, de l’avortement, de l’amour des parents, de tout ce qui a été une histoire de chair et d’amour », écrit Annie Ernaux dans Se perdre, journal qu’elle consacrait exclusivement à la relation intime d’une passion avec un Russe, à la fin des années 1980. Les lectrices et les lecteurs auront peut-être lu Passion simple, récit qui faisait état de cette histoire amoureuse. Se perdre en est la chair vive, la forme brute. Quiconque a éprouvé (ou éprouve encore) une passion pour un être peu disponible y retrouvera le caractère sacré des retrouvailles sexuelles et l’instante remémoration des gestes et des paroles échangés pendant ces rencontres privilégiées, une fois l’autre parti. Ce qui domine l’ensemble: l’attente, inscrite partout dans le journal d’Annie Ernaux. Cette attente que remplit la peur de perdre l’autre et le besoin de se perdre, attentes que tente de contenir l’écriture.
Car s’il fait état d’une passion, c’est surtout l’écriture dans ce qu’elle a de vital qui traverse Se perdre. Ce journal, qui est comme un pré-texte, laisse libre cours aux obsessions inscrites dans l’œuvre. On y lit comment la vie et l’écriture sont indissociables chez celle qui refuse de s’identifier à un monde intellectuel dont elle fait pourtant partie. Elle révèle aussi la part d’inconscient, pulsions de vie de mort, d’où surgit l’écriture. Y sont inscrits de nombreux rêves, dont plusieurs évoquent une cave, lieu riche de sens, confirmé en dernière page dans son lien à l’écriture : « Ce besoin que j’ai d’écrire quelque chose de dangereux pour moi, comme une porte de cave qui s’ouvre, où il faut entrer coûte que coûte. » Se perdre rend compte d’une passion, certes, mais on se priverait en limitant notre lecture à son aspect anecdotique, ne serait-ce que parce que la passion nous sollicite tout entier dans notre rapport au monde.