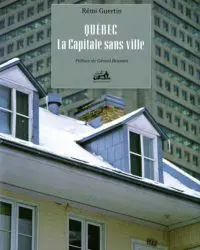Géographe documenté et photographe pénétrant, Rémi Guertin enrichit son ambitieux ouvrage de sérieux éléments d’histoire et de sociologie. À le lire, on constate que, depuis ses origines jusqu’à nos jours, Québec peine à faire coexister son statut de capitale et la densité d’une ville habitée. Citant Lucie K. Morisset, Guertin circonscrit la question : « On peut aujourd’hui se demander lequel, de l’identité nationale du Québec ou de son paysage touristique, a le premier forgé l’autre ». Le titre est à prendre au pied de la lettre : Québec, selon Guertin, aime son statut de capitale, mais elle n’en a jamais déduit qu’elle devait peupler son centre.
Dès le départ, l’équivoque règne. Champlain aurait préféré Trois-Rivières. Coincé entre les Basques qui contrôlent le golfe et les Amérindiens dont les parcours commerciaux sont établis, il se résigne à Québec. Son successeur, Montmagny, importe de France un plan que Québec intègre de son mieux. Le gouverneur, le séminaire, les Jésuites, les Ursulines se partagent le centre et gardent la roture à distance. Sous le Régime anglais, Lord Dufferin impose ses vues : « Modifier les murs pour favoriser le commerce et la circulation n’est pas en contradiction avec son idéalisation du passé. Au contraire, ce type d’adaptation devient l’occasion de plaquer sur Québec les éléments décoratifs de son choix ». Et voilà Québec cerné de vieux remparts presque neufs ! « En fabriquant de toutes pièces l’ancienneté du bourg fortifié, Lord Dufferin spatialise un nouveau couple signifiant : centre ancien/périphérie moderne. » Il « cuirasse Québec contre toute mutation » et maintient son statut de ville belle et… inhabitée. Les touristes admirent Québec et repartent, les citoyens du pourtour y sont marginalisés.
Guertin n’oublie pas les héritiers de Dufferin. Québec loge ses « complexes » en réduisant de quelques milliers la population qui s’était indûment rapprochée du périmètre sacré. Les communautés religieuses ne cèdent leurs possessions qu’au compte-gouttes. Faute d’espace dans l’enceinte réservée, des collectivités se créent qui craqueront sous les exigences de la modernité : Limoilou, Saint-Malo, Saint-Roch, Montcalm… Québec ne changera pas d’orientation pour si peu. Les rares places publiques qui servaient de marchés ou d’agoras sont isolées du courant et verrouillées : place Jacques-Cartier loge la bibliothèque, place d’Youville évacue sa faune juvénile manu militari et se maquille au goût des touristes.
Comme pour endosser Guertin, Le Soleil du 28 mars 2012 soulignait que le Vieux-Québec n’a jamais logé aussi peu de résidents.