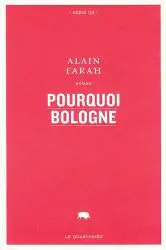Dans Matamore no 29, Alain Farah révélait son agilité à se jouer du lecteur, en le confrontant à un objet narratif qui brillait dans mille directions ; spirale de références, de jeux, de réflexions splendides lancées en deux lignes, comme une répartie aussi jouissive que légère. Le jeu créait des bulles, qui montaient à la tête. Dans Pourquoi Bologne, la démarche est assez similaire, avec ce goût et ce besoin de saboter la linéarité du récit, avec ce cumul de temporalités qui se croisent entre 1962 et 2012, avec ce mélange improbable des genres, entre l’autofiction, la science-fiction, l’histoire et les théories du complot. Mais le tout est beaucoup plus incarné. À notre plus grande joie.
La jonction entre théories du complot et métafiction pourrait nous faire penser à un Don DeLillo québécois, mais la cadence et l’humour du roman nous mènent dans des territoires plus bigarrés, où se rejoignent la Nouvelle Vague, les théoriciens de la décolonisation, la sémiologie d’Umberto Eco, parmi autant de références qui deviennent souvent des personnages à l’œuvre, agissant et donnant son envol au récit. Celui-ci tourne autour de l’Université McGill, une institution familière et étrangère dont la vaste et souterraine histoire, qui lie le pouvoir à la sécurité, l’expérimentation et l’art à l’urbanité, est racontée de l’intérieur par un Alain Farah en avatar de lui-même, qui craint de se dédoubler et qui est hanté par le poids de l’histoire (familiale et collective).
L’écriture devient un jeu masqué, ni mise à nu ni désir d’authenticité pour contrer l’attrait du pouvoir par un repli dans une quête d’origine qui ordonne, mais bien par le débordement qu’est l’accumulation, la palette colorée de ceux qui, comme les sapeurs évoqués dans le roman, saisissent la nécessité de se trouver partout, tout le temps, masqués, médicamentés, non catégorisables. Ces masques nombreux, ces personnalités multiples, ces incapacités à cerner l’identité et l’autorité de celui qui écrit, participent d’une réflexion sur l’écriture comme amalgame du littéraire et du populaire, sur le rôle et la force de la littérature comme espace de construction de possibles.
Dans ce texte marqué par la ferveur, la figure d’Hubert Aquin, épris de vitesse, de médicaments, d’action, de politique, d’amour, surgit, qui fait de Prochain épisode l’un des palimpsestes qui donne ses assises à Pourquoi Bologne. Comme chez Aquin, on retrouve ici la composition en deux temps qui se recouvrent et se complètent, la trame politique, l’écriture de soi comme personnage, l’érudition ludique et foncièrement sérieuse. De même, le recours à l’espionnage comme structure de base d’une histoire formatée à transformer, permet à Farah, comme à Aquin, de défaire les logiques contraignantes des causalités et des atavismes, grâce aux multiples incohérences volontaires du récit et aux apartés nombreux qui insistent sur la nullité narrative d’Alain Farah auteur alors même que ces notations adressées au lecteur assurent la maestria du propos et de la cadence époustouflante des révélations (intimes et politiques) qui jonchent ce grand texte.