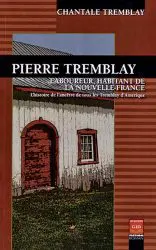D’après Louis-Guy Lemieux (Grandes familles du Québec, Septentrion, 2006), « on évalue à environ 150 000 le nombre de descendants vivants qui portent le nom de Tremblay en Amérique ». Ce qui corse cette statistique, c’est le fait que, contrairement à d’autres descendances populeuses, celle-ci procède d’un seul et unique ancêtre. En faut-il davantage pour justifier l’hommage de Chantale Tremblay à son ancêtre ?
L’hommage est chaleureux et digne d’éloges. Sans verser dans la complaisance, Chantale Tremblay démontre sa connaissance des coutumes de l’époque, sa maîtrise des décisions arrêtées par le premier Tremblay et, chose plus rare, sa familiarité avec le pur et savoureux langage de ce temps. Elle rappelle le tremblement de terre qui a secoué Charlevoix et qui a valu à une municipalité de s’appeler à jamais Les Éboulements. Elle assiste aux accouchements dont les hommes étaient rigoureusement chassés. Elle relate la ruée de toute la population pour assister à l’exécution capitale d’un violeur d’enfant. Elle suit dans sa visite au marché l’épouse de Pierre Tremblay et la montre en train de troquer les productions de la ferme « contre d’autres denrées ou ouvrages dont sa famille avait besoin, notamment du pain frais que les boulangers étaient tenus d’offrir au public en tout temps, par ordre de la police ». Coutume peu connue de notre époque ! Quand approche l’heure du vêlage et que la jeune Marie-Madeleine demande qu’on la laisse assister à la scène, elle plaide sa cause dans les termes suivants : « Je vous assure d’être prude, papa ». Au moment où l’on allait entendre là une promesse de prudence, l’auteure ouvre la porte à une autre interprétation : « En fait, l’Église interdisait aux parents de permettre aux enfants d’observer un quelconque accouchement, qu’il soit humain ou animal ». J’avoue en savoir moins long que Chantale Tremblay à ce propos.
Ce vocabulaire, l’auteure le ressuscite avec déférence et générosité. L’église est un temple. Commères et compères sont des termes d’amitié et ne véhiculent aucun aspect péjoratif. L’occasion propice est une commodité singulière. Talon ne gère pas la Nouvelle-France, il la conduit. Celui qu’on veut rencontrer, on l’envoie quérir. Devant un décès accidentel, Catherine se dit déconfortée. « Je dois m’en retourner, dit la nouvelle religieuse à son amie, mais proteste-moi de m’envoyer quérir si jamais ta santé à toi défaillait. » Langue inventive qui crée les mots qu’exigent les besoins sans les emprunter à une langue étrangère. Un livre qui donne de la chair à une époque et à un fondateur.