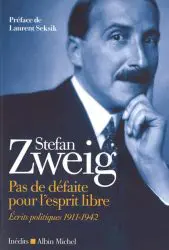La seule lecture de la table des matières montre le disparate de cet ensemble de textes, certains publiés en leur temps, d’autres inédits. Le présentateur, habile et informé, n’en fait pas mystère. Ils ont été rédigés sur une trentaine d’années en relation avec l’actualité, c’est-à-dire depuis les préparatifs et l’éclatement de la Première Guerre mondiale jusqu’au cœur de la Deuxième.
On célébrait l’auteur de nouvelles exemplaires, de romans, de pièces de théâtre célèbres dans toute l’aire germanophone, de passionnantes biographies d’Érasme ou de Dostoïevski, l’épistolier infatigable et perspicace. Voici un Zweig proche du journalisme.
Certains textes, datés, nous laissent indifférents. Qui se passionne aujourd’hui pour « le combat pour le canal de Suez », les pratiques des bibliophiles ou la phobie des bureaux de l’auteur ? Mais plusieurs de ces écrits de circonstance ou chroniques nous renseignent de première main sur la situation de la Suisse pendant la guerre, sur les relations entre l’Autriche et l’Allemagne, plus encore sur l’atmosphère en France après la victoire de 1918 ou le double visage de l’Allemagne en 1939. Zweig fait ici œuvre d’historien ou plutôt de mémorialiste comme dans son célèbre Monde d’hier : il n’est pas neutre mais pleinement engagé dans l’information qu’il fournit et dans les analyses auxquelles il se livre. C’est bien là le meilleur de ce livre qui permet de redécouvrir un esprit farouchement libre œuvrant pour que la paix se rétablisse entre les deux guerres. Zweig y aborde des questions encore brûlantes même si elles ont trouvé parfois des réponses : sa croisade pour l’abolition de la peine de mort et d’autres qui n’ont fait que devenir plus aiguës.
Il décrit parce qu’il ressent, ses analyses et ses choix sont empreints d’émotion et de passion. D’abord les transformations de la vieille Autriche qu’il évoque avec mélancolie, son charme suranné, la tradition artistique de Vienne qui se maintient d’abord dans les années trente alors que les nationalismes sont de plus en plus virulents, mais qui ne survivra pas à l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne hitlérienne en 1938 (l’Anschluss). Dès lors les Juifs vont lutter désespérément contre l’exclusion, prémisse de leur extermination. La stratégie nazie est déjà bien au point. Elle consiste à les isoler jusqu’à ce qu’ils constituent un immense ghetto, c’est-à-dire une prison qui se resserre, à les priver de toute relation avec le reste de la population, à interdire certaines activités ou l’accès à des professions, à instaurer des boycottages. Une issue est encore possible pour un temps : l’émigration vers la Palestine. Zweig s’emploie à l’organiser, à la favoriser, à lever des fonds car il faut beaucoup d’argent. Après s’être fait le porte-parole et le diffuseur de la culture autrichienne, il est passé à la survie des Juifs, de Londres à New York, projetant un « manifeste juif », action en faveur des femmes et enfants juifs allemands. Il veut aussi et surtout créer un esprit de résistance alors que l’élimination est déjà commencée. On sourit tristement devant ces efforts : quelle force aurait pu résister à tout l’appareil d’extermination nazi ?
Cette action suppose chez cet intellectuel, cet homme de culture, qui paraît fragile, une résistance et une énergie peu communes car il est sur tous les fronts. Jusque dans les années 1940, malgré des voyages incessants, des tournées de conférences, il ne cesse d’écrire. En fait, comme d’autres sont animés par une foi religieuse, Zweig est porté par la sienne qui est « la défense de l’esprit » – termes omniprésents dans ces écrits. Plus spécifiquement et concrètement, « l’idée européenne » qu’il partage avec Romain Rolland, Verhaeren, Hermann Hesse, Thomas Mann quand celui-ci est revenu de ses sympathies nationalistes. Un siècle plus tard, l’évidence est brutale : la constitution d’une Europe véritable n’a pas trouvé sa voie. Elle s’est établie sur une base économique, la création d’un vaste marché où chacun vient, sans états d’âme, trafiquer et spéculer, contrôlé par des technocrates de Bruxelles ou Francfort. Les pessimistes – ou les réalistes – diront : tout est à faire, ou à refaire. Cette supposée Union est incapable de résister aux ambitions économiques, politiques ou idéologiques des États-Unis et de la Chine. Incapable d’apporter une solution satisfaisante et humaine aux grands enjeux de notre temps : la crise financière grecque – qui en précède d’autres –, la sortie de la Grande-Bretagne dans le Brexit, l’afflux migratoire croissant et l’actuelle pandémie. Quand un danger se précise, la trentaine de pays qui sont ainsi rassemblés ferment leurs frontières et défendent leurs intérêts nationaux.
Zweig voulait que l’Europe se fasse par la volonté des nations sous la « guidance » de l’esprit. Les intellectuels humanistes en seraient un facteur essentiel pour maintenir la flamme et permettre un renouveau comme il s’en est produit en divers siècles après l’effondrement d’un empire (par exemple celui de Rome). Il aurait pu en être ainsi après 1918, mais les vainqueurs ont fait preuve d’arrogance et d’aveuglement. Puis, le nazisme a étranglé la liberté de penser. La notion de patrie s’est corrompue en nationalisme belliqueux et un silence glacial s’est répandu, le silence de la terreur.
En 1933, les livres de Zweig sont brûlés en Allemagne. Il est bien conscient de la vanité de ses efforts, lui qui écrivait en 1919 : « Pendant toutes les années de la guerre, je ne me suis jamais senti intérieurement aussi tranquille, aussi calme et plein de sérénité lucide qu’à présent, au milieu d’une débâcle historique absolument sans précédent ». Mais la débâcle nouvelle a changé de nature et de dimensions et rien ne semble pouvoir l’enrayer. Il se donne la mort au Brésil en 1942, geste réprouvé post mortem par certains de ses confrères, Thomas Mann ou Bernanos, et qui fait mentir amèrement le titre de ce recueil d’essais politiques, « Pas de défaite pour l’esprit libre »…