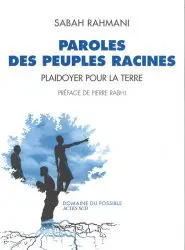« Amérindiens, Pygmées, Maoris, Samis, Kanaks… ils sont plus de 370 millions, sur tous les continents, parlent plus de 400 langues et vivent sur 20 % des terres de la planète où se trouve 80 % de la biodiversité mondiale », tel est aujourd’hui le portrait des descendants des premiers occupants de la planète, que brosse Sabah Rahmani. À première vue, on pourrait croire qu’avec une telle population leur survie est assurée. Bien sûr, il n’en est rien, si l’on considère leur dispersion, leur relatif isolement et, de ce fait, leur difficulté à faire respecter leurs droits.
« Depuis près de 30 ans des organisations indigènes fleurissent et luttent aux côtés d’associations de scientifiques, de citoyens, de personnalités et de quelques politiques pour faire reconnaître leurs droits » avec des succès mitigés jusqu’à maintenant, nous rappelle l’auteure. Seule la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, adoptée en 1989, constitue un outil juridique contraignant pour les États signataires. En principe, ceux-ci doivent garantir à leurs populations autochtones la protection de leur mode de vie et de leurs territoires ancestraux ainsi que les protéger de la discrimination. Pour certains, cette déclaration a valeur de symbole bien plus que d’engagement. Par exemple, Jair Bolsonaro, président du Brésil, pays qui a ratifié l’entente en 2002, déclarait il y a peu : « Les minorités devront s’adapter à la majorité ou simplement disparaître ».
Pas étonnant que dans ces conditions le chef kayapo Roani Metuktire lance un appel à tous les peuples racines pour former une alliance « politique » afin de défendre leurs droits, dans la foulée de la Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques. Deux ans plus tard, en 2017, se tenait à Brasilia la première grande assemblée de l’Alliance des gardiens de Mère Nature. Plus de 200 participants, venus de tous les continents, y ont échangé, débattu et proposé des solutions pour faire face aux enjeux environnementaux et culturels que pose le développement tous azimuts que promeuvent l’Occident et les sociétés qui ont adopté son modèle de développement.
À cette occasion, Sabah Rahmani a interrogé dix-neuf d’entre eux sur leur conception du monde, de la terre, de la nature, de la place de l’humain dans l’univers, etc. À chacun, elle a demandé comment sa communauté faisait face aux problèmes environnementaux, comment elle envisageait l’avenir, comment elle voyait la « modernité » et surtout quels messages elle voulait adresser à l’Occident. Les lecteurs le constateront, leurs réponses sont étonnamment similaires, quel que soit leur horizon culturel ou géographique.
Paroles des peuples racines vient nous rappeler que, si une multitude d’espèces animales et végétales est menacée d’extinction, des sociétés humaines plurimillénaires jouent actuellement leur survie elles aussi. Toutes les femmes et tous les hommes qui luttent pour empêcher cet appauvrissement et dont Sabah Rahmani relaie ici la parole nous montrent que le combat pour maintenir la plus grande biodiversité dans notre environnement doit d’abord commencer par la prise de conscience de la non-durabilité de nos modes de vie actuels.