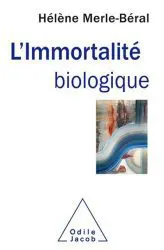Médecin spécialiste des leucémies, Hélène Merle-Béral se penche dans son dernier essai sur la notion d’immortalité du point de vue aussi bien historique ou biologique que technologique. En dépit des efforts qu’a fait l’humanité depuis la nuit des temps pour retarder la mort ou pour la déjouer en « inventant » une vie après elle, celle-ci a toujours fait partie du cycle du vivant. Du moins jusqu’à maintenant.
Toujours l’être humain a cherché le Saint Graal de la vie éternelle. Le premier endroit où chercher, nous dit l’auteure, c’est dans la nature. À titre d’exemples, elle énumère quelques variétés de végétaux dont la longévité peut parfois se chiffrer en siècles ou en millénaires, comme c’est le cas des colonies de posidonies, des plantes sous-marines qui poussent au large des Baléares et qui peuvent atteindre entre 80 000 et 200 000 ans. Elle donne également quelques exemples tirés du monde animal, comme les carpes koï, qui vivent jusqu’à 200 ans, ou la tortue géante des Galápagos, qui vit jusqu’à 170 ans, ou encore le tardigrade (ourson d’eau), qui résiste à des températures extrêmes (-272°C et +150°C) et qui peut être décongelé intact après 2 000 ans. C’est pourquoi, nous dit l’auteure, « [l]a connaissance des mécanismes moléculaires qui sous-tendent les extraordinaires propriétés de certains animaux [et de certains végétaux] nous ouvre des voies pour […] progresser dans la compréhension de ce qui nous fait vieillir, nous rend malades et nous fait mourir ».Pourtant, ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale, autour des années 1950, que le monde médical commencera à s’intéresser aux mécanismes du vieillissement et de la mort. Pour le vieillissement, la première question qui se pose, c’est celle de la part du patrimoine génétique dans la longévité d’un individu. La réponse fluctue énormément, variant entre 7 % et 30 % selon les publications. On sait également que notre comportement de même que nos modes de vie peuvent agir sur ce patrimoine génétique et de ce fait modifier l’espérance de vie. En ce qui concerne la mort, Hélène Merle-Béral nous rappelle que les parties du corps ne meurent pas toutes en même temps. Ce qui fait que la notion de mort diffère selon les pays et les époques. Il faut distinguer, nous dit l’auteure, la mort de l’individu et celle de ses cellules, de ses organes et de ses tissus. Ainsi, grâce au progrès de la technologie, on peut maintenir « vivants » des individus cérébralement morts.Mieux encore, avec l’essor du numérique et de l’intelligence artificielle, joint aux avancées de la génomique, est apparue une nouvelle conception de l’être humain, nous dit Hélène Merle-Béral : le transhumanisme. Selon ce courant de pensée, la mort n’est qu’un problème technique qu’on pourra résoudre quand l’homme saura se libérer de la servitude de son corps grâce à l’intelligence artificielle. On pourrait également numériser le cerveau et renoncer à l’immortalité biologique au profit d’une immortalité numérique. Comme le dit le grand patron de Tesla, l’excentrique Elon Musk, deux options s’offrent à l’humanité: « fusionner avec l’intelligence artificielle ou devenir obsolète ». Pareilles perspectives donnent le tournis.Parfois vertigineux quand il évoque ces avancées, L’immortalité biologique ébranle nos convictions les mieux ancrées concernant l’humanité. Même si certains passages sont d’une lecture exigeante – celui sur le vieillissement moléculaire par exemple –, le panorama de la longue quête de l’être humain pour vaincre la mort que brosse Hélène Merle-Béral ne pourra qu’intéresser toute personne le moindrement curieuse de la marche du monde en général et de la science médicale en particulier.