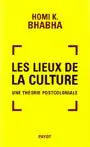Voici enfin traduit un important ouvrage du penseur indo-étatsunien Homi K. Bhabha, une des figures les plus importantes de la théorie du postcolonialisme avec Edward W. Saïd, Gayatri Chakravorty Spivak et Thierry Hentsch. À côté des trop nombreux ouvrages commis par des littéraires en mal d’exégèse n’intéressant qu’eux et leur lectorat universitaire captif, les livres polyphoniques de Bhabha sont réellement impliqués dans le champ social en faisant dialoguer la philosophie, la psychanalyse et la littérature. Les lieux de la culture est un ouvrage exigeant et dont l’argumentaire complexe dessine la topologie des nouages qui instruisent le procès de l’identité dans les processus de globalisation. La souplesse et l’érudition qui le soutiennent sont éblouissants, les analyses des œuvres (de Lord Jim à Peaux noires, masques blancs) s’avèrent aussi éblouissantes.
Des critiques comme Sylvere Lotringer ont montré qu’on ne peut se rabattre désormais sur le texte et que nous devons nous pencher sur la montée de ce que je qualifie d’intégrisme de l’image. Bhabha, lui, a introjecté la stratégie déconstructionniste et s’il en fait jouer les ressorts, cela ne l’empêche pas de souligner qu’elle a parfois quelque difficulté à détecter certains mécanismes du système discursif du pouvoir.
Avant de lire ce Bhabha, je connaissais l’« original » en anglais. Voici qu’en me plongeant dans la version française, je me suis trouvé, au moins jusqu’aux deux tiers, profondément agacé par ce que je considérais comme une traduction bâclée (les mots comme prédicament, enclosure, préempte s’amoncelaient comme ruines d’un autre âge). Puis, tout à coup, j’ai compris que j’étais resté sourd à l’étranger, à l’inquiétance de son idiome. Je n’avais pas entendu à quel point sa langue énonce de manière radicale la transnationalité au sein même des nations en mettant en lumière la marginalisation sous toutes ses formes. Bhabha déplie ici son histoire subjective pour la faire jouer dans les spirales du centre et de la périphérie, insistant sur l’impératif catégorique de la vigilance aux discours d’exclusion. Les discriminations qui affectent les populations minorisées, réfugiées, rejetées et déniées apparaissent sous le filtre de l’ambivalence du discours colonial. En somme, il s’agit d’entendre sous l’arrogance des colonisateurs l’angoisse qui ne cesse de les tenailler. Ils savent que quand l’autre dit « je », il se situe (se « localise ») du côté d’un archaïque dont ils n’ont pas la clé. Ils ont horreur de l’entre-deux, des récits de leurs subalternes dont ils ne connaissent pas la donne. C’est pourquoi ils abhorrent la citoyenneté cosmopolitique.