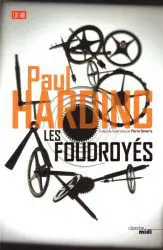S’il existe un équivalent littéraire à Cendrillon, c’est l’Américain Paul Harding qui en est l’incarnation. Cet ancien batteur du groupe rock Cold Water Flat, reconverti à l’écriture la quarantaine venue, a vu le manuscrit de ses Foudroyés refusé par toutes les maisons d’édition établies jusqu’à ce qu’un tout petit éditeur, le Bellevue Literary Press, accepte de le publier. Sans le soutien d’un grand éditeur, sans couverture médiatique ou presque et avec un tirage de 3500 exemplaires seulement, ce récit méditatif qui raconte l’agonie d’un octogénaire allait pourtant décrocher le prix Pulitzer en 2010. Un honneur largement mérité.
Couché dans son lit de mourant, George est la proie d’hallucinations. Cet ancien réparateur d’horloges est persuadé que la maison qu’il a bâtie de ses propres mains est en train de s’effondrer sur lui morceau après morceau et, à sa suite, tout l’Univers. Si sa conscience du présent se décompose petit à petit comme un mouvement d’horlogerie, sa mémoire du passé est restée intacte. Dans ses états de semi-conscience, il se rappelle son enfance rude dans un bled perdu du Maine. Surtout, il se souvient de son père, Howard, qui, avec sa carriole tirée par une mule, faisait la tournée de l’arrière-pays pour vendre « de la poudre de dentifrice et des bas de laine, du savon à raser et des rasoirs à manche » à aussi pauvres que lui.
L’esprit errant du mourant ramène également à la surface d’autres figures de son passé : sa mère d’abord, femme « stricte et austère », aigrie par son mariage, dont il dira que son sentiment vis-à-vis des siens « tenait plus du deuil et de l’amertume » que de l’affection ; un grand-père pasteur méthodiste toujours enfermé à rédiger des sermons dont personne ne saisissait le sens ; une fratrie aussi mal lotie que lui. Au final, toutes ces vies à demi ratées forment un clan de résignés.
Mais, plus que les contours de quelques destins particuliers, ce qu’on retient de la lecture des Foudroyés, c’est la somptuosité de la plume de Harding, en particulier quand il décrit les grands cycles de la nature. Évoquant des jeux de l’enfance, il écrit par exemple : « Et les bateaux miniatures construits avec l’écorce de bouleau et des feuilles mortes, lancés dans une eau froide aussi claire que l’air ? Combien de flottes furent-elles ainsi propulsées jusqu’au milieu des étangs ou au fil des ruisseaux d’automne, chargées d’un trésor de glands, de plumes noires, ou d’une mante déconcertée ? Célébrons ces embarcations d’herbe au même titre que les grandes coques de fer qui fendent la mer, car toutes sont des improvisations nées des rêveries de l’homme, et toutes périront, sous l’assaut de l’océan ou d’une brise d’octobre ». Peut-on évoquer avec plus de délicatesse la tragédie de la destinée de l’homme ?