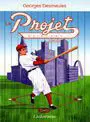Fête de l’imagination, de la culture et du ludisme, Le projet Syracuse, premier roman de Georges Desmeules, est l’un des récits québécois les plus réussis à s’inspirer de Jorge Luis Borges. Un exégète tapi dans l’ombre entreprend de narrer les tribulations d’un mathématicien nazi, Wolf Habermann, alias Thomas Lewis, devenu espion et conspirateur aux États-Unis afin de ralentir les recherches scientifiques des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Le projet fou que cet espion met en place prend appui sur la passion nationale pour le baseball, et le roman ne cesse alors de lier ce sport à la mythologie américaine (qui n’exclut pas le Québec) par une figure constante, celle de la régénération et du passage. C’est dire comment une histoire fictive parvient à amalgamer l’ensemble de la vie intellectuelle étatsunienne du XXe siècle.
L’intérêt du roman tient aux observations à l’emporte-pièce émises par Habermann dans ses archives personnelles mises au jour par le narrateur : toute la vie sociale, culturelle et scientifique des États-Unis est alors lue à la lumière du baseball, qui devient le véritable moyen de comprendre ce pays. Le roman se donne à lire comme une étude philologique du parcours de l’espion, avec une distance caustique à la fois captivante et moqueuse, et il en résulte une narration qui mêle de façon loufoque la petite histoire érudite, l’histoire officielle consacrée et des inventions toujours juste assez tordues pour faire douter à l’occasion le lecteur, aussi féru soit-il de sport, de politique, de complots et de littérature. Le lecteur est donc choyé de découvrir, de page en page, une imagination au service de l’intelligence, qui invente une histoire à partir de ses omissions et de ses trous, en juxtaposant ce qui ne l’a jamais été. Si Le projet Syracuse, dans un élan de liberté beau à observer, lie Adolf Hitler, un nain ayant réellement joué pour les Cards de Saint-Louis, Roland Barthes et de multiples autres figures du XXe siècle, si le roman devient une enquête presque policière, si chaque page est marquée du sceau de l’inventivité, c’est que le roman comprend que le langage crée des mondes et qu’un des plaisirs de l’écrivain est d’étirer à son point maximal l’horizon du possible, se jouant pour et contre le lecteur des limites du vraisemblable. Devant ce plaisir de la fiction, le public suit, ravi.