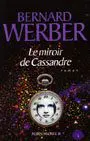Bernard Werber est un auteur français reconnu pour ses écrits à caractère scientifique, sa littérature presque mystique ou spirituelle. Dernièrement, il s’est intéressé davantage à la notion de futur dans ses recueils de nouvelles Paradis sur mesure et L’arbre des possibles, publiés respectivement en 2008 et en 2002. Avec le roman Le miroir de Cassandre de 2009, Werber reprend cette idée fixe en y joignant l’intuitionnisme, une doctrine véhiculée par les personnages de Cassandre et de son frère Daniel, tous deux atteints de sensibilité extrême autistique, victimes des expériences de leurs parents. Le tout tourne autour de Cassandre, jeune rebelle qui se réfugie en marge de la société pour savoir qui elle est et pour découvrir son passé oublié. Se joignent à elle des clochards qui l’aideront à contrôler ses visions de l’avenir et à tenter de sauver le monde, une entreprise pour le moins grandiose et disons-le, utopique.
L’auteur essaie d’expliquer, de réfléchir à l’avenir en bon penseur qu’il est, en jouant avec les probabilités mathématiques et le contexte socio-économique. Bien sûr, il ne manque pas de faire un peu, en passant, la morale au genre humain, puisque nous sommes tous concernés par l’avenir de notre planète, un sujet chaud et actuel. Grand mythologue, il intègre encore une fois dans le récit un bon nombre de mythes gréco-romains. Visionnaire, Werber touche par ce roman les lecteurs les plus sensibilisés, les plus impliqués et même ceux qui veulent seulement rêver ou s’imaginer le futur. L’écrivain est fidèle à lui-même lorsque, par le biais de la futurologie, il transforme des concepts abstraits en chiffres, en notions calculables et concrètes. Sauver le monde par les prévisions mathématiques ou par des visions : les plus sceptiques diront que c’est un projet tiré par les cheveux, d’autres, plus optimistes, y verront un exemple à suivre. Malgré tout, quelques pages en moins auraient fait en sorte que l’aventure de Cassandre soit décrite de manière plus concise puisque quelques redondances dans les idées et les constructions syntaxiques appauvrissent la narration. Bernard Werber, dans ce roman, ne se réinvente pas, mais, conséquent, il continue de marcher fidèlement dans ses traces.