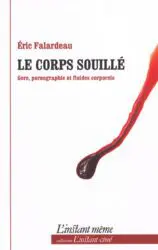Edgar Morin disait du cinéma que, sous sa volonté de faire vrai, celui-ci était invariablement connecté, sans égard au genre adopté, avec le monde du rêve, des fantasmes et d’une certaine animalité irrationnelle. L’hypothèse du sociologue se révèle d’autant plus vraie pour le gore et la pornographie.
Caractérisé par une abondance de sang et de démembrements, le gore serait né au tournant des années 1960. Linda Williams, mère des porn studies, définit pour sa part la pornographie comme un usage particulier de l’« on/scenity », à savoir la volonté de mettre en scène ce qui, par rapport à la sexualité, reste généralement contenu dans la sphère privée : corps nus, organes sexuels, orgasmes, etc.
En insistant sur la monstration des fluides corporels (sang et sperme), nous dit Éric Falardeau, ces deux genres exprimeraient un rapport trouble au corps. C’est la thèse que ce dernier soutient dans Le corps souillé, la version remaniée de son mémoire de maîtrise, un essai accessible qui allie élégance du style et concision. Dans les deux cas, s’il y a fixation sur le corps, il y a aussi focalisation sur le visage, miroir des émotions que l’on souhaite transmettre au spectateur. Pour ce faire, la scène de massacre du gore mise sur l’« effet-Méduse » (effet-peur), alors que le money shot (l’éjaculation finale) du porno met l’accent sur la « frénésie du visible » (effet-plaisir).
La signification profonde de ces deux genres n’en souligne pas moins l’incomplétude du corps. Son imperfection est d’ailleurs fétichisée : les chairs avachies et le sang font du corps gore une pure matérialité coupée de ses facultés intellectuelles ; le corps de la porno est au contraire exposé comme un corps-machine ultraperformant et infatigable, soumis à l’animalité de ses pulsions sexuelles. En une quinzaine de courts chapitres, le spécialiste de cinéma scrute ainsi méticuleusement ce qui rapproche la porno du gore, par un aller-retour instructif entre deux genres à première vue dissemblables.