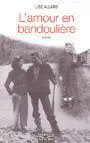L’amour en bandoulière est présenté comme un roman basé sur « une histoire vraie » illustrant « la victoire de l’amour sur la mort ». Lise Allard y raconte le « vécu » de son père Antonio, dit Fit, et expose le « courage » et la « détermination absolue pour le droit à la vie et à la liberté » (quatrième de couverture) dont il a fait preuve lorsqu’il choisit de déserter l’armée canadienne, en avril 1942.
Le parti pris narratif est donc clairement affiché : l’image négative du déserteur, qui pose en soi « un acte de lâcheté », est ici dégagée de l’aura d’infamie qu’elle connote naturellement et se présente au contraire comme « le fruit d’une décision courageuse, une question de respect de soi et des autres ». Le personnage d’Antonio fait ainsi figure de véritable héros, tout de qualités vêtu et digne en tout point de sa belle et vertueuse Jeanne.
L’amour en bandoulière n’est pas sans rappeler certains aspects du roman québécois du XIXe siècle : présence d’un couple de protagonistes monolithiques, atmosphère souvent manichéenne, happy end du mariage terminal ; dimension ethnologique également, car le narrateur fait à plus d’une occasion office d’informateur, en décrivant par exemple la vie dans les chantiers de Chandler en 1940, avec l’horaire de travail des bûcherons, le menu des repas, le « charroyage » du bois, le glaçage des chemins de halage, la drave, le Noël au camp… Cette information s’ajoute à l’abondance généralisée des détails et fait de L’amour en bandoulière une sorte de reportage, avec carte géographique des lieux mentionnés à l’appui : soutenu par la « mémoire phénoménale » d’Antonio, le narrateur raconte ses quatre ans de vie de déserteur, incluant des épisodes non essentiels au développement de la diégèse et faisant intervenir, en fréquentes cascades, des dizaines de personnages accessoires.
Sur le plan formel, L’amour en bandoulière offre une langue ordinairement correcte, quoique non suffisamment épouillée, notamment, de formules répétitives : Léopold « éclata de rire. Son rire devint contagieux et les deux hommes se laissèrent aller dans un fou rire incontrôlable » ; on a aussi droit à « des planchers auxquels il manquait plusieurs planches » et à une « chevelure bouclée qui tombait en immenses boucles sur ses épaules »… (Je souligne.)
L’apologie de la désertion peut certes se concevoir et se dire. Pareillement, la piété filiale est une vertu qui peut légitimement conduire à l’expression du « respect et [de] l’admiration » éprouvés pour un « homme de cœur ». L’une et l’autre ne sauraient toutefois, d’elles-mêmes, faire éclore une véritable œuvre romanesque.