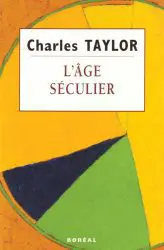Par l’ampleur de ses perspectives et la densité du propos, L’âge séculier1 de Charles Taylor mérite une humble, patiente et admirative fréquentation. Cinq siècles comparent valeurs et références, tandis qu’intervient une gamme de disciplines, de la philosophie à l’histoire, de la sociologie à la psychologie. Quant aux sources, elles appartiennent surtout aux cultures du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis, mais la patristique, la tradition judaïque, la pensée allemande et les classiques romains et grecs y vont aussi de leur écot. Profit assuré pour qui consent l’effort.
Taylor a tôt fait d’encadrer son chantier : il entend comparer l’Occident latin de 1500 et celui qui confronte les vivants d’aujourd’hui. Il s’agit aussi, dès l’instant où il saute aux yeux que notre société a quitté un monde habité par la foi pour glisser vers un âge séculier, d’analyser les vecteurs de la mutation et d’entrevoir ce que les humains y ont gagné ou perdu.
Le premier défi servi au lecteur sera d’apprivoiser le vocabulaire et les perspectives propres à Taylor. Non que le penseur appartienne à la secte des jargonneux patentés, mais parce qu’il déteste les malentendus et sait qu’il s’avance en terrain miné. Au départ, Taylor décrit ce qu’il dénomme un monde enchanté, réalité distincte de celle que Gabrielle Roy couvre de cette épithète : les humains de ce temps invoquent les saints, côtoient les esprits, saluent les fées, quêtent les miracles, s’ouvrent à mille influences venues d’en haut. Autant dire, conclut Taylor, que ces humains sont poreux et habitent un cosmos spirituel. Cinq siècles plus tard, le monde est désenchanté. La science a effectué des coupes à blanc dans les impondérables et les superstitions, l’ordre n’a que méfiance pour les fêtes, la raison préfère ne traiter qu’avec un univers logique et prévisible, l’horizontal importe plus que le ciel et ses mystères. « Nous sommes passés d’un monde où l’on concevait, sans que cela pose problème, que le lieu de la plénitude se situait en dehors ou ‘au-delà’ de la vie humaine à un monde plus problématique qui conteste ce schéma pour placer ce lieu (de manières multiples) ‘au sein de la vie humaine’. » « […] le moi poreux, continue l’auteur, est vulnérable face aux esprits, aux démons, aux forces cosmiques ; cela s’accompagne de certaines peurs qui peuvent s’emparer de nous en certaines occasions. Le moi isolé s’est arraché au monde renfermant ce genre de peur… » Ne concluons pourtant pas que tout se limite à comparer une ère de foi à un présent d’athéisme généralisé. « […] le changement que je veux définir et tracer, écrit Taylor, est celui qui nous mène d’une société dans laquelle il était virtuellement impossible de ne pas croire en Dieu, à une société où la foi, y compris pour le croyant le plus inébranlable, est une possibilité parmi d’autres. »
Pareille mutation requiert du temps et la convergence de plusieurs facteurs. Taylor agit en conséquence : il multiplie les témoignages et les angles d’observation, prodigue les nuances, consolide chaque tête de pont avant d’oser la suivante. Les accents, il les place, sans surprise, sur le « primat de l’individualité qui caractérise notre culture », sur « l’humanisme de la Renaissance, la révolution scientifique, l’essor de l’ ‘État policier’, la Réforme », mais il veille à toujours souligner l’importance des « imaginaires sociaux ». À compter du moment où peuple et élites estiment que telle conviction « va de soi », on ne la discute plus : « La souveraineté populaire pouvait être embrassée parce qu’elle avait une signification institutionnelle claire et incontestée. Elle était la base du nouvel ordre ». Puisque le nouvel imaginaire social décrète la mort de l’ordre vertical et autoritaire, des préoccupations comme la sécurité et la prospérité peuvent remplir l’horizon.
À lire la traduction de L’âge séculier et à s’y heurter à certaines nébulosités, on ne sait ce qui, du vocabulaire propre à Taylor ou de son versant français, est en cause. Le terme d’agence, bien que fréquent, est particulièrement ambigu. « Ces deux éléments – la sphère publique et la souveraineté du ‘peuple’ – supposent que nous sommes des agences collectives. » Le changement de contexte n’éclaire en rien le sens du mot : « Dans le même esprit, je voudrais ajouter quelques remarques concernant le second problème présenté plus haut, celui de l’agence morale ». Quand l’épilogue insiste sur « la force croissante de la nouvelle attitude instrumentale propre à l’agence humaine », notre intelligence du terme ne réussit aucun progrès. Même désarroi quand Taylor écrit, à propos de l’importance de l’Église dans la structure morale de la société, qu’« on retrouve cette idée chez un grand nombre de parents québécois au lendemain de la ‘Révolution silencieuse’ ». Comment expliquer que la Révolution tranquille, dont Taylor a souvent traité, soit dite silencieuse ?
De tels flottements étonnent d’autant plus que ce livre aussi riche qu’exigeant est un modèle de pédagogie appliquée. Chaque fois qu’il entame un pan de sa démonstration, Taylor, en effet, précise en quelques lignes ses objectifs. Chaque fois qu’il en a terminé avec cette étape, il en résume le contenu. Il présente ainsi l’équivalent de ces plans qui, au seuil d’un labyrinthe bureaucratique, viennent à notre secours : « Vous êtes ici ». En plus, l’auteur coiffe son périple d’un utile index thématique. Le lecteur qui souhaite retrouver la page qui traitait de l’humanisme exclusif, ou celle où Taylor s’expliquait au sujet des « histoires par soustraction », ou encore celle où se déploie la conception baroque de l’ordre développée avant Durkheim, ce lecteur tenace n’a qu’à consulter cet index d’une quinzaine de pages.
Sans dissimuler ses convictions de croyant, jamais Taylor ne frustre l’exigence humaine de compréhension. Ses derniers chapitres insistent sur les mérites de la chrétienté, mais il n’en a pas omis les laideurs.
1. Charles Taylor, L’âge séculier, trad. de l’anglais par Patrick Savidan, Boréal, Montréal, 2011, 1344 p. ; 44,95 $.