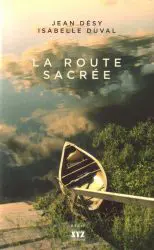Malgré l’ampleur de leurs vues, l’élévation de leurs pensées et leur patente sincérité, une question délicate s’attache à la quête de nos trois pèlerins : leur attachement à la foi catholique les conduit-elle à répéter inconsciemment certains raccourcis souvent reprochés au clergé québécois d’hier ? Certes, Jean Désy, Isabelle Duval et Pierre-Olivier Tremblay veulent analyser « le malaise actuel à l’égard du religieux et de la vie missionnaire ». Certes, ils entendent « aller aux sources de l’identité spirituelle des gens de notre collectivité, remonter le courant, en espérant trouver certaines réponses quant à un avenir commun que nous souhaitons le plus harmonieux possible ». Certes, enfin, ils se dissocient fermement des comportements qui ont fait la honte, presque jusqu’à nos jours, des pensionnats imposés aux enfants autochtones.
Est-ce suffisant ? Fallait-il, hier, qu’un jésuite marque du sceau catholique l’Antre de marbre, lieu chamanique vibrant d’un culte multiethnique et panthéiste, et fallait-il, aujourd’hui, marquer par des croix (fort belles) le passage en ce temple d’un trio de Blancs ? On aura beau dire que Jacques Cartier, en plantant une croix à Gaspé, n’entendait pas mépriser les Premières Nations, il bousculait quand même mœurs et croyances autochtones. Pareille appropriation ne se répète-t-elle pas lorsque l’Antre de marbre sert à un culte particulier plus qu’à une spiritualité universelle ? Qu’il soit permis de poser la question.
Cela dit, réjouissons-nous qu’ait eu lieu le contact à la base du pèlerinage. Hasard ? On se tromperait en soupçonnant sa touche dans le livre que signent Jean Désy et Isabelle Duval sous l’œil complice de Pierre-Olivier Tremblay, alias Pierrot. Si leur rencontre semble fortuite, leurs fines complémentarités se cherchaient depuis toujours.
Isabelle Duval, novice en immersion historique comme en géographie québécoise, cherche, après l’accueil offert à son documentaire Le prêtre et l’aventurier, le thème d’une nouvelle trouée cinématographique. Elle connaît donc déjà Désy, l’aventurier, et Pierrot, le prêtre. Manque l’étincelle qui allumera un nouveau brasier ; quand elle surgira, ils se lanceront tous trois dans onze jours d’exaltante intimité et de quasi-panthéisme. Onze jours de contacts avec la nature et la culture autochtone. Onze jours de ferveur vers un lieu propice à la ferveur.
L’étincelle viendra du récit que donne Jean Désy d’une entrevue avec Louis-Edmond Hamelin, géographe et chantre de la nordicité. La cinéaste et le prêtre vont spontanément au cœur de l’expérience vécue par Désy : il est des lieux où souffle l’esprit et où l’âme s’élève en vivant sa fusion avec le cosmos. De cette révélation, la cinéaste, le nomade et le prêtre tirent un même emballement : « Choisissons au Québec un de ces lieux inspirés (dirait Barrès) et allons-y ! » Sitôt séduites par ce dénominateur commun, trois compétences distinctes passent au geste : Désy, nomade pragmatique et pourtant poète, trace l’itinéraire et le marque de son respect des décors et de la vie ; Isabelle, nourrie de lectures et d’intuition poétique, identifie les textes qui assureront la convergence des âmes et prévoit les techniques modernes grâce auxquelles le trio transmettra sa ferveur au public ; Pierrot, discret au chapitre du compte-rendu, soutient l’aventure de ses connaissances scripturaires et de sa musique. Minutieuse préparation d’un pèlerinage voué à trois objectifs : « […] la quête religieuse et identitaire, les liens avec l’autochtonie et l’exploration du territoire sur le mode aventurier et géopoétique ».
Le choix du trio se porte sur l’Antre de marbre, caverne nordique honorée depuis des millénaires par les nomades autochtones. Le jésuite Laure y aurait célébré une messe en 1730. S’y rendre exigera le recours au canot, à la roulotte, à la voiture, au portage… D’étape en étape, les textes de la cinéaste et du médecin refléteront la spiritualité de ce pèlerinage. De fort beaux poèmes naissent de la main de la cinéaste ou sortent des carnets de Pierre Perrault ou de Serge Patrice Thibodeau, les chants scouts émergent du passé de Désy, les conversations font la place la plus généreuse à la spiritualité. La route sacrée mérite pleinement son titre.
L’éditeur (XYZ) soutient finement le pèlerinage. D’un chapitre à l’autre, le bouquin signale sobrement la contribution de chacun : il déplace vers la gauche les réflexions de Jean Désy et vers la droite celles d’Isabelle Duval ; l’œil identifie la plume sans effort ni verbiage.
Ardente quête catholique ? Sûrement. Œcuménique ?
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...