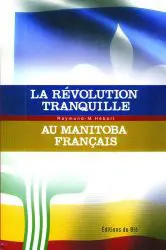Le Québec, qui aime sans les aimer tout en les aimant les minorités francophones du Canada et qui en ignore à peu près tout, n’appréciera peut-être pas que cette diaspora lui dérobe sa plus chère fierté : SA révolution tranquille. Pourtant, les secousses québécoise et manitobaine présentent quelques éléments communs. Il faudra cependant faire place aux nuances.
Dans les deux cas, l’éducation constitue un enjeu majeur. Pas le seul, mais le plus voyant. Aussitôt surgissent les contrastes : les francophones manitobains se battent pour l’école et la langue, tandis que le Québec réclame l’éducation supérieure. La parenté entre les deux contextes refait cependant surface : au Manitoba comme au Québec, le clergé est mis en cause. Mais, cette fois encore, les priorités diffèrent : au Québec, le débat, civilisé et patient, porte strictement sur la laïcité ; au Manitoba, à en juger par les documents réunis par Raymond-M. Hébert, le litige est à la fois religieux et linguistique. Au Québec, il s’agit, par exemple, de déterminer quand et comment tel séminaire va s’intégrer au réseau des cégeps ; au Manitoba, les francophones mènent le combat sur (au moins) deux fronts : ils revendiquent à la fois l’instruction en français et sa laïcité.
L’auteur met en lumière un aspect particulier et douloureux de la lutte manitobaine : en plus d’affronter un gouvernement d’abord sensible aux demandes de sa majorité anglophone et protestante, les francophones du Manitoba ne peuvent pas compter sur leur clergé dans leur combat linguistique. Ils doivent même résister à une hiérarchie qui céderait sur le front linguistique si elle pouvait en tirer avantage sur celui de la confessionnalité. Stratégie vaticane déjà observée en Nouvelle-Angleterre où des paroisses peuplées de Québécois déracinés, mais encore francophones, étaient confiées à un clergé irlandais anglophone. Comme alors, Rome affirmait que les catholiques pèseraient plus lourd s’ils unissaient leurs forces en adhérant tous à l’anglais. « Rêve cependant impossible à réaliser pour de petites communautés francophones minoritaires, à moins de les réunir avec des catholiques anglophones… mais pour le père Durocher, cela ne posait aucun problème… » À comparer au sort des francophones manitobains, la révolution québécoise fut vraiment tranquille !
Dans ce domaine comme dans plusieurs autres, l’auteur livre un témoignage à la fois irremplaçable et trop intime : Hébert fut à ce point mêlé au réveil manitobain qu’on ne saurait exiger de lui un parfait recul. Il a beau reconnaître honnêtement et humblement que ses jugements d’aujourd’hui feutrent un peu les courageux et efficaces éditoriaux de sa jeunesse militante, comment exiger de lui qu’il taise sa fierté ? Comme les résultats obtenus grâce à Hébert et à sa génération dépassent les espoirs couvés avant 1960, mieux vaut ce récit sans distance critique qu’un silence forcément injuste.