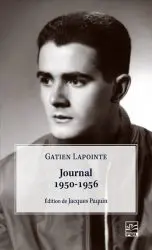Émouvante comme peuvent l’être certains jeunes hommes, d’une candeur touchante dont on n’a pas idée, voici une toute petite perle de notre patrimoine littéraire.Le poète Gatien Lapointe (1931-1983) a tout juste dix-huit ans quand il entreprend ce journal, le plus ancien des documents conservés dans le fonds éponyme à la BAnQ de Trois-Rivières. On ne s’étonne pas des quelques émois et tourments qui font très « années cinquante » et nous rappellent les journaux intimes de Saint-Denys Garneau ou de Fernand Ouellette, par cette proximité avec le religieux ou le spirituel, même quand le jeune Lapointe s’en plaint : « Les curés n’ont jamais su comprendre les problèmes du jeune homme ». Ce rapport trouble et douloureux au corps, à son propre corps, on le comprend aussi : « Je suis étranger à moi-même. Mon corps est distant, je dois être terriblement faux ! », écrit Lapointe. On a l’impression de lire ici l’auteur de Regards et jeux dans l’espace, mais également Kafka, le cynisme décapant en moins. Apparaissent aussi au fil des entrées le sentiment amoureux, son avenir et sa vocation de poète. C’est d’ailleurs sur ce mot que le journal prend fin : « Ô la triste intimité de ma vocation… »Est-ce le genre lui-même qui appelle les nostalgiques ? Le tout jeune homme de vingt ans s’observe et se demande déjà où a fui le temps : « Plaisir indicible de me rappeler longuement mes belles années passées ! Mon bonheur serait-il désormais fini, maintenant que l’ennui et la douleur font de grandes places stériles dans ma tête ! » Il se reproche d’être « incapable de Beauté ». Pourtant. J’hésite entre sourire et m’émouvoir. J’y vais d’une émotion en coin.Le journal renferme des injonctions, des appels durs à soi-même (« Ah ! devenir autre que soi », « essayer de n’être point médiocre »), et de la déception, forcément (« Je suis déçu ; je suis déçu de moi-même et de la vie également »), tant l’exigence s’impose lourdement. On surprend aussi des tranches de son quotidien : le travail (« Je travaille toutes les nuits jusqu’à 3 et 4 heures du matin »), les visites à la famille (« Visite royale chez moi »), des rencontres avec des amis, ses lectures (Gabriel Marcel, Rimbaud, Éluard) et ses projets (une thèse et une pièce de théâtre qui n’aboutiront jamais). Au cours des dernières années (1955 et 1956), la poésie et le lyrisme s’invitent. Si l’on ne trouve à proprement parler qu’un seul poème en bonne et due forme, plusieurs entrées figurent de véritables poèmes en prose : « Trop de grâce décidément, on soulève la terre. J’ai faim. J’ai grand faim. J’alerte toute la ville. Mes compagnons et souverains de classe me croient d’un esprit fantastique ».À un ou deux endroits la chronologie est bousculée et rétablie, nous informent les notes, mais j’avoue que les explications elles-mêmes ne m’éclairent parfois qu’à moitié. Quoi qu’il en soit, j’étais plus attentif à une voix et à un propos, et la question de l’édition matérielle du texte ne m’a pas distrait outre mesure.Une introduction de Jacques Paquin ouvre ce petit ouvrage. Un appareil critique relativement discret balise notre lecture. Quel plaisir de savoir ce que le jeune poète lisait à telle époque, quels cours il a suivis, qui il fréquentait. On sait toute la patience que cette recherche implique : saluons Paquin.Ce journal ne grossira pas les rangs des grands journaux intimes du siècle dernier, ceux des Franz Kafka, Paul Léautaud et Jean-Pierre Guay. On a affaire à autre chose : un élément discret de l’inventaire historique.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...