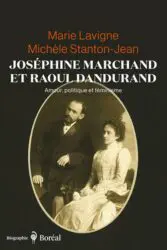Un siècle passionnant, qui va du milieu du XIXe jusqu’à la mi-XXe, et que la riche biographie du couple Marchand-Dandurand fait revivre.
Ces témoignages détaillés permettent de revisiter les évènements significatifs d’un Québec – et d’un Canada – en pleine évolution, à une époque charnière de leur histoire commune.
Joséphine Marchand (1861-1925) et Raoul Dandurand (1861-1942) formaient un couple fascinant, oui, avant-gardiste, sûrement, et comme l’indique le sous-titre de l’ouvrage, un duo hors norme, uni par « l’amour, la politique et le féminisme ». Les historiennes Marie Lavigne et Michèle Stanton-Jean, aux parcours professionnels remarquables, ont fait un colossal travail de recherche, dont témoigne l’impressionnante bibliographie du livre. S’il est vrai qu’elles ont eu accès à de riches archives, dont les autobiographies du couple et son échange épistolaire comptant plus de 700 lettres, encore fallait-il donner un sens à tout cela. Mission accomplie.
Toute leur vie, chacun à sa façon, Joséphine Marchand et Raoul Dandurand ont lutté pour faire valoir leurs idées libérales, et même progressistes, en se heurtant souvent « à l’obstination et aux préjugés des ultramontains et de certains membres des autorités religieuses et du clergé ». Le couple savait bien que, freinés par ces derniers, « les progrès sont lents et retardent l’accession du Québec à la modernité ». Rien ne pouvait pourtant miner leur ardeur.
Toute leur vie, ils seront « des précurseurs de réformes qui se feront attendre encore des décennies ». Fait étonnant, le couple n’aura qu’une seule fille, Gabrielle. Selon les autrices, Joséphine « ne présente pas l’image de l’amour maternel inconditionnel qui prédomine au tournant du XXe siècle ». Elle sera beaucoup plus.
Fille du premier ministre libéral Félix-Gabriel Marchand, Joséphine est surtout écrivaine et journaliste. Elle n’hésite pas à défendre ses idées. À l’époque, les Canadiens français accusaient un retard manifeste par rapport aux investissements faits par les anglophones pour soutenir les arts et la culture, qu’il s’agisse des bibliothèques publiques ou des musées. Joséphine fera du financement des arts un de ses chevaux de bataille : « Nous sommes portées quelquefois à envier les institutions anglaises dotées par des millionnaires ». Elle soutiendra « l’ouverture d’un cours classique aux filles, condition préalable à leur admission aux études universitaires ». Avec son mari, elle œuvrera à ce que les femmes aient le droit de vote, obtenu tardivement au Québec, en 1940.
Diplômé en droit, Raoul est un organisateur politique très près d’Honoré Mercier, dans un premier temps, puis, au fédéral, de Wilfrid Laurier et de Mackenzie King. Nommé au Sénat, il en sera élu président. Devenu diplomate, il s’illustrera à l’étranger et représentera le Canada à la Société des Nations (ancêtre de l’ONU), dont il sera nommé président, et dirigera la section montréalaise du Comité France-Amérique. À l’instar de sa femme, il sera préoccupé d’éducation, un secteur sur lequel le clergé réclamait le seul droit de regard. Il occupera entre autres fonctions celle de président de l’Université de Montréal et sera un des fondateurs du Collège Stanislas.
Si l’incroyable quantité d’informations semble avoir privé le récit d’une certaine fluidité, en revanche, cette savante biographie est un précieux document historique, vraiment.