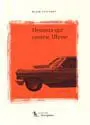Après vingt ans d’interruption, Alain Poissant renoue avec l’écriture romanesque dans Heureux qui comme Ulysse. Il s’agit de son huitième roman, mais l’auteur est demeuré confidentiel, malgré deux œuvres assez réussies et poignantes, qui signalaient déjà son attrait pour la route et la voiture (Vendredi-Friday) et pour la solitude et le froid (Carnaval), dans des récits très ramassés. Si, avec son nouveau roman, Poissant élargit sa palette et conçoit une trame plus complexe (avec les mêmes thèmes), cela se fait à l’encontre des qualités premières de son style : l’efficacité et la concision.
Divisé en quatre parties qui reprennent le cycle saisonnier, du printemps à l’hiver, le roman de Poissant décrit les pérégrinations banales d’un « héros jetable », Pissenlit, parti à la recherche de lui-même. À la suite de l’échec du référendum de 1980, celui-ci prend la route dans une vieille Ford et parcourt les États-Unis et l’Ouest canadien en quête de son mythe américain, de sa régénération. Pissenlit considère qu’il doit renaître en se dispersant, voyant de ce fait dans le voyage le moteur de sa métamorphose, qui hélas tarde à venir. Ce n’est qu’en échouant (littéralement) dans une réserve amérindienne du nord manitobain (Tipeesat), qu’il réapprend le contact avec autrui et qu’il restructure (la métaphore architecturale importe ici) son monde autour d’une demeure délabrée. Aux confins du monde, il s’installe dans le transitoire et s’aménage une géographie intime.
Avec un titre manifestement intertextuel, on s’attend certes à un substrat mythique, mais pas à ces lourdes explications sur l’épopée homérique ni à ces motifs antiques plaqués sur la vie nord-américaine contemporaine où l’atomisation, l’exclusion des autochtones, la soif de l’ailleurs, la peur de l’inconnu acquièrent un sens uniquement par l’Antiquité. Dans un roman de la route, où la réflexion sur l’américanité prédomine (l’étendue, le renouvellement, la toponymie, le truchement amérindien), ces digressions (explications plaquées, jeux narratifs autour des possibles du récit et des zones d’ombre du protagoniste) ralentissent le récit à partir d’un lieu autre, qui pèse sur le texte sans rejoindre les personnages. Dans Heureux qui comme Ulysse, la désertion est une manière américaine de recommencer, mais la désillusion n’est jamais loin. Plus qu’à un dégonflement du héros antique, c’est à la dissolution du chant que procède Poissant, sans réinvestir un imaginaire, dont il ne reste que quelques miettes éparses et empruntées. Les signes des Amériques sont partout, mais jamais saisis dans leur dynamisme, ce qui fait en sorte que la trajectoire de Pissenlit dénote d’abord un statisme, qui se révèle dans l’écriture par cet usage trop appuyé de la trame homérique, véritable mémoire désuète à Tipeesat, alors qu’elle devrait ouvrir des voies diverses d’habitation du monde qui permettraient d’intégrer l’imaginaire amérindien.