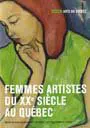Les expositions sont éphémères mais les catalogues qui les accompagnent sont permanents et c’est là, véritablement, que se révèle leur valeur de documents. Dans le cas des deux expositions du Musée national des beaux-arts du Québec consacrées aux femmes artistes au Québec, le catalogue apparaît d’autant plus important que peu d’ouvrages leur ont été consacrés. S’il est vrai qu’il existe des femmes artistes dans le monde depuis le XVIe siècle, qui a vu naître la notion d’artiste, leurs œuvres, considérées mineures, étaient jugées sans intérêt. Même lorsque plus tard, devenues professionnelles, elles appartenaient à l’un ou à l’autre mouvement, elles restaient à l’ombre de leurs contemporains masculins. Au Québec, combien savent que près de la moitié des signataires du Refus global étaient des femmes ? Aujourd’hui encore, si quelques batailles ont été gagnées, la guerre n’est pas finie. Et pour cela aussi, le catalogue apparaît de toute importance. L’un des problèmes qui subsistent est qu’aux femmes on attribue certains genres. Cette idée selon laquelle il existe un art typiquement féminin est ici interrogée. L’archétype est masculin et on entendra dire de certaines qu’elles « peignent comme un homme ». Au Canada, apprend-on, beaucoup de femmes qui pratiquaient les arts révélaient ainsi le niveau de leur éducation et rares étaient les femmes mariées qui faisaient carrière dans les arts, ce qui indiquerait une incompatibilité entre leur rôle d’artiste et celui d’épouse et de mère. La situation des femmes artistes au Québec a évolué lentement mais a connu des changements notoires avec l’intérêt qu’elles ont manifesté pour la modernité et aussi avec l’engagement de certaines dans le féminisme. Entrant dans cette modernité, elles ont profité de l’ouverture entre les différentes disciplines et du développement de formes nouvelles d’expression. Ainsi elles ont pu entreprendre des recherches formelles au même titre que leurs contemporains masculins. Et si l’art créé dans l’effervescence du féminisme est vu comme féminin, c’est qu’à travers leurs créations les femmes ont osé y exposer leurs expériences, leur condition et leurs réalités. Cette évolution est étudiée minutieusement à travers deux textes importants, l’un d’Esther Trépanier, directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec, et l’autre de Pierre Landry, actuel conservateur d’art contemporain au Musée. Le premier considère cette évolution dans le cadre de conditions anesthétiques (culturelles, linguistiques, sociales ) de la première moitié du XXe siècle dans le milieu québécois, ou plus largement canadien, et l’autre parle du contexte des dernières années du siècle avec tout ce qu’elles comportent de changements dans les pratiques artistiques. On note aussi le rôle accru de femmes dans le milieu artistique à titre d’artistes, certes, mais aussi à titre de critiques, de galeristes et de commissaires d’expositions. Suivent les notices biographiques des femmes dont les œuvres marquantes ont été présentées dans l’une ou l’autre des expositions.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...