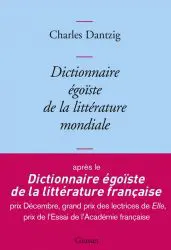L’auteur avait fait paraître en 2005 le Dictionnaire égoïste de la littérature française, qui avait ébloui la critique et lui avait valu une multitude de récompenses dont le prix Décembre, le Grand Prix des lectrices de ELLE et le Prix de l’Essai de l’Académie française.
Quinze ans plus tard, Charles Dantzig récidive et nous revient avec un autre dictionnaire égoïste consacré celui-là à la littérature mondiale.Le Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, comme le précédent ouvrage, n’est pas un dictionnaire conventionnel. Il ne fait pas le tour d’un auteur, d’une œuvre ou d’un courant littéraire. Dantzig choisit plutôt de parler « égoïstement » de ce qui l’intéresse dans le monde des lettres et des leçons qu’il en a tirées pour son propre compte.À la rigueur et à l’austérité du lexicographe, l’auteur oppose une approche plus près du collage impressionniste ou de la promenade érudite avec ses digressions et ses chemins de traverse. Ainsi le lecteur ne se surprendra pas à trouver dans ce dictionnaire savant des notices comme : « Morts de personnages dans la neige », « Enterrements d’écrivains », « Intransigeance de l’impuissant », « Bégaiement », etc.Avec une suprême assurance – le doute ne semble pas être un trait de son caractère – il farcit son discours de formules assassines dont les « stars » du milieu font souvent les frais : Beckett est « l’écrivain de la fatigue d’être » ; Cioran, « une collection de calculs biliaires » ; Duras, « une petite envieuse appliquée » ; Céline, « un petit écrivain à éclats de génie comique » ; Éluard, « un des plus mauvais poètes du XXe siècle » ; Rousseau, « un cabot », etc. On le voit, chez Dantzig, il n’y a pas de vaches sacrées.Plus déroutants sont les enseignements qu’il tire de ses lectures. On en trouve la trace dans les sentences et les aphorismes dont il parsème son texte : « Le réalisme […] est le parc à vieillards de l’amertume intime » ; « Le mélodrame est la consolation des uns au moyen du malheur des autres » ; « Le préjugé c’est l’esprit trompé qui nous fait manquer de cœur » ; « Le naturel n’est qu’un artifice majoritairement admis ». Des assertions comme celles-là figurent à toutes les pages. Il y a beaucoup de doctoral chez ce fils de médecin.À travers ce brillant feu d’artifice intellectuel, l’auteur glisse ici et là des bribes d’informations personnelles. Il dira ainsi de son enfance bourgeoise qu’elle fut « une enfance enfermée dans une tour de malheurs ». Pas étonnant qu’il confie être entré très jeune en littérature comme on dit entrer en religion. Un peu comme Sartre qui disait être devenu posthume à lui-même, alors qu’il était encore enfant, tant il était aspiré par la magie des mots (d’où le titre de son autobiographie). « Toute littérature est un combat de la forme contre la confusion », dit Dantzig pour sa part, affirmant par là que seuls les mots peuvent vaincre le chaos du monde et, de ce fait, donner un sens à la vie.« Dans le premier Dictionnaire égoïste, et dans celui-ci, j’ai avec moi-même des conversations sur la littérature que je ne peux avoir avec les autres […]. On n’imagine pas la solitude du grand lecteur de littérature. On écrit par désespoir de devoir se taire, toute sa vie, sur ce qui vous passionne. » Les 1 200 pages de son Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale devraient atténuer ce désespoir. Pour un temps du moins.