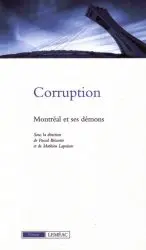Corruption, Montréal et ses démons est un mince mais fort pertinent ouvrage collectif qui réunit les textes de huit universitaires exposant leurs points de vue de philosophes, d’historiens, de politicologues et de sociologues sur le sujet en titre, dans la foulée du rapport de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC), dite commission Charbonneau.
Dans une optique philosophique, Marc-Antoine Dilhac et Robert Sparling s’emploient d’abord à cerner le concept de corruption : celle-ci est « une affaire non de moralité individuelle, mais d’habitudes partagées et d’incitations », et aussi « un problème de culture publique », dit le premier ; elle est « difficile à définir » parce qu’elle est « un problème d’ordre moral […] qui relève de la moralité politique », soutient le second. Interviennent ensuite deux historiens œuvrant au sein du Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) : Mathieu Lapointe retrace les principales enquêtes sur la corruption à Montréal au XXe siècle, en dégageant les influences nord-américaines, tandis que Harold Bérubé décrit le contexte dans lequel l’enracinement de la corruption à Montréal aurait eu lieu. Danielle Morin examine pour sa part les rôles et les responsabilités des quatre leviers de contrôle qui existaient avant la création, en 2014, par le maire Denis Coderre, de la fonction d’inspecteur général : les postes de surveillance ne manquaient pas, infère-t-elle, mais il y avait des failles dans la gouvernance de la ville, comme les a dénoncées la commission Charbonneau. L’article élaboré de Laurence Bherer et Sandra Breux se penche quant à lui sur un double objet : les quatre stratagèmes de corruption dévoilés à Montréal et ailleurs au Québec, avec les réformes proposées pour les endiguer, et les causes structurelles susceptibles d’expliquer le détournement des normes en vigueur, en mettant l’accent sur les besoins des partis politiques municipaux et leurs conséquences. Il faut réviser les règles de financement de ces partis à la lumière des enjeux particuliers des campagnes électorales, concluent les deux professeures. Daniel Weinstock clôt le collectif en soulignant l’excellence du rapport de la CEIC : c’est « une contribution majeure à l’assainissement de certaines des institutions économiques et politiques les plus importantes du Québec ». Il fait écho à l’appréciation des présentateurs de l’opuscule, Mathieu Lapointe et Pascal Brissette, pour qui ce rapport est « une synthèse remarquable » de l’« enquête quasi judiciaire » qui est allée « au fond des problèmes ».
Au terme de la lecture de ce recueil de textes succincts et facilement accessibles à un large public, force est de constater la justesse et la netteté des propos tenus par des auteurs dont la compétence ne fait aucun doute.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...