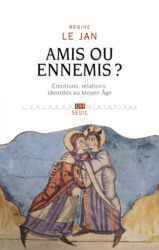Mensonge ou calomnie, les jeunes imputent à Charlemagne l’invention de l’école. C’est tout ce que l’on sait (?) de lui. Les circonstances atténuantes qu’invoque notre ignorance sont cependant convaincantes : d’une part, Charlemagne a précédé de douze bons siècles le bogue de l’an 2000 ; d’autre part, le Français moyen sera, comme nous, surpris d’apprendre que Charlemagne était plus allemand qu’hexagonal et que, faute de goût impardonnable, il préférait Aix à Paris.
À propos d’un tel personnage, Jean Favier avait beau jeu. Il pouvait, à son gré, louer le conquérant, admirer l’empereur à la barbe fleurie ou vanter le protecteur des lettres. Jean Favier fait mieux. Il peint Charlemagne en le gardant à mi-chemin entre le mythe et le tangible, en lui attribuant de merveilleux virages sociaux sans en faire un génie, en lui imputant un sens aigu de la législation qu’ignore la légende sans cependant en faire le précurseur tout azimut qu’aimerait bien canoniser le simplisme.
Jean Favier, surtout, à partir d’une culture immense et chaleureuse, ressuscite l’époque de Charlemagne en même temps que sa personne. Il permet de voir, derrière l’empereur, la vie des paysans de l’époque, le mode de gestion qu’était la guerre annuelle, le bras de fer auquel donnait lieu, avec des fortunes variables, l’affrontement entre le pape et les couronnes nationales, le prestige et la mobilité des intellectuels à une époque que l’on croirait frileuse et qui était tout le contraire.
Lire Favier, c’est absorber une époque, avec ses dépaysements, son vocabulaire, ses regards pointus sur toutes choses. Une merveille pour qui a de l’appétit.