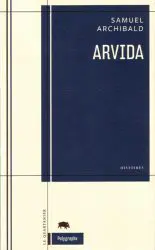Jacques Ferron qualifiait l’ancienne Ville-Jacques-Cartier de far-west avant qu’elle soit relativement policée au sein de Longueuil. L’Arvida de Samuel Archibald a cette qualité rare de présenter la sauvagerie et la folie d’un lieu sans tomber dans la caricature, le jugement lapidaire, le coup de gueule et le règlement de compte. Parler d’une petite ville, narrer les archives orales et dispersées d’une région, faire de la monographie paroissiale le socle d’une écriture vive, qui contourne, détourne, retourne les mille récits qui fondent tout lieu, voilà le défi bien relevé dans ce recueil d’histoires. L’ensemble acquiert sa valeur, son unité non pas de personnages, de manières de dire, mais bien du génie un brin débraillé du lieu, cet Arvida utopique, puis obsolète, puis agglutiné à Jonquière.
Ville fondée pour des besoins industriels, autour d’une usine, dans un lieu où « les routes interminables ne mènent nulle part », Arvida sert d’assise à l’entrée en littérature d’un raconteur d’histoires fort d’une belle capacité à écouter celles des autres. La ville ne trouve pas son relief dans une chronologie locale, dans une description des monuments d’importance ; aucun folklore, aucune nostalgie du terroir ne fondent ces histoires autour du pittoresque, du réalisme et du touristique. Au contraire, c’est la valeur de la transmission, c’est l’examen des témoignages fugaces de citoyens à la fois banals et forts en gueule qui permettent à Archibald d’arrimer son patelin d’origine à toutes les aventures mondiales, du 11 septembre à la Seconde Guerre mondiale en passant par Marcel Proust et le Canadien de Montréal.
Écouter la rumeur du monde à partir d’Arvida, c’est être contemporain d’un univers qui n’efface pas le passé, et agir d’une périphérie des choses qui transforme le regard porté sur les combines à faire, les manifestations du mystère, les exploits sportifs du passé, les sous vite faits et perdus, les voyages débridés et insatisfaisants, les pulsions sexuelles, violentes. C’est surtout construire un langage qui amalgame la parlure locale, les legs de grands romanciers, le vocabulaire familial dans le but de construire une fête des mots, des sons, où l’humour suinte à chaque page. Archibald file la métaphore de la madeleine proustienne pour montrer le déficit littéraire, voire culturel, qui guette le conteur d’histoires formé à Arvida, mais il sait aussi, en nomade de ces chemins américains vers nulle part et en lecteur de Stephen King, que les vertiges de l’immensité et les mystères encore à découvrir dans un lieu construit en une centaine de jours laissent place à d’autres formes syncopées de mémoire, formes qu’il possède d’instinct.