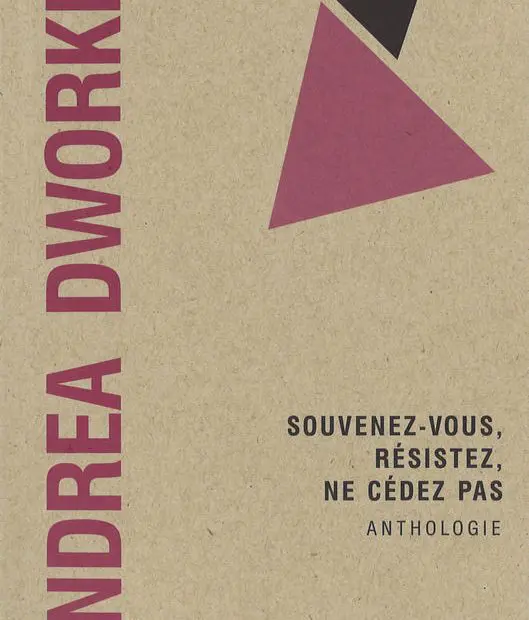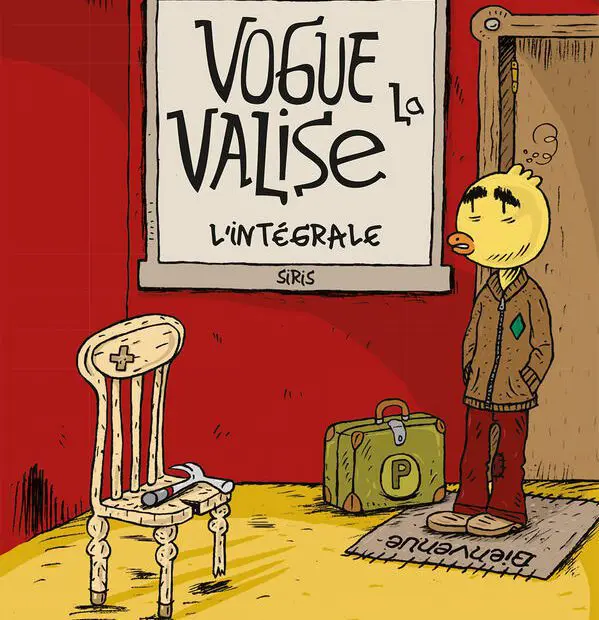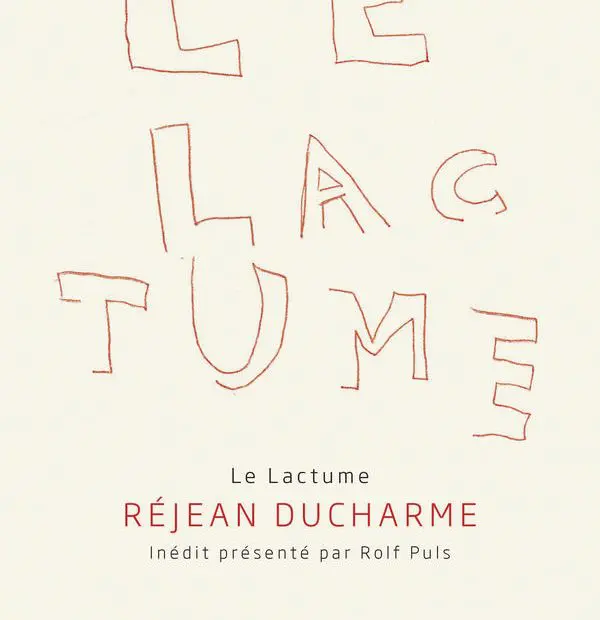De l’attrait du réel au désir d’absolu
En dix ans à peine, Judy Quinn a publié sept ouvrages, tant de poésie que de fiction narrative, pour lesquels elle a reçu des prix importants. Avec la constance de la marcheuse de fond, celle… De l’attrait du réel au désir d’absolu