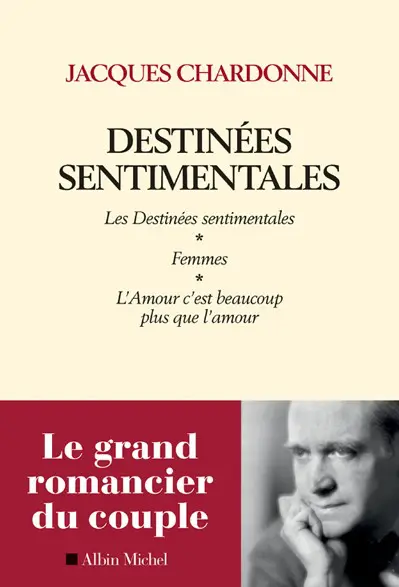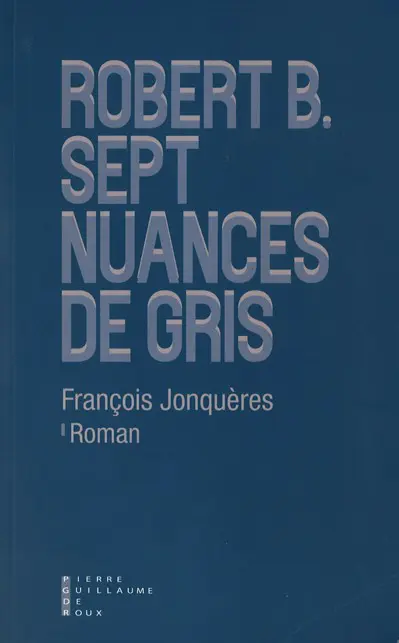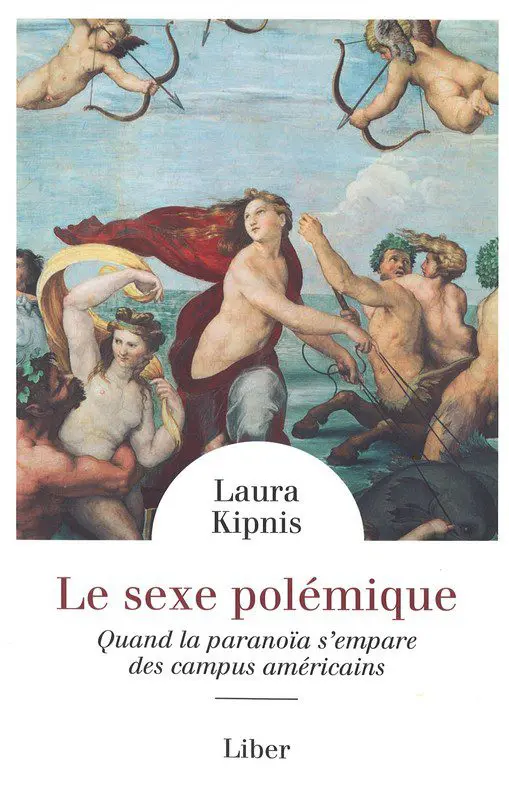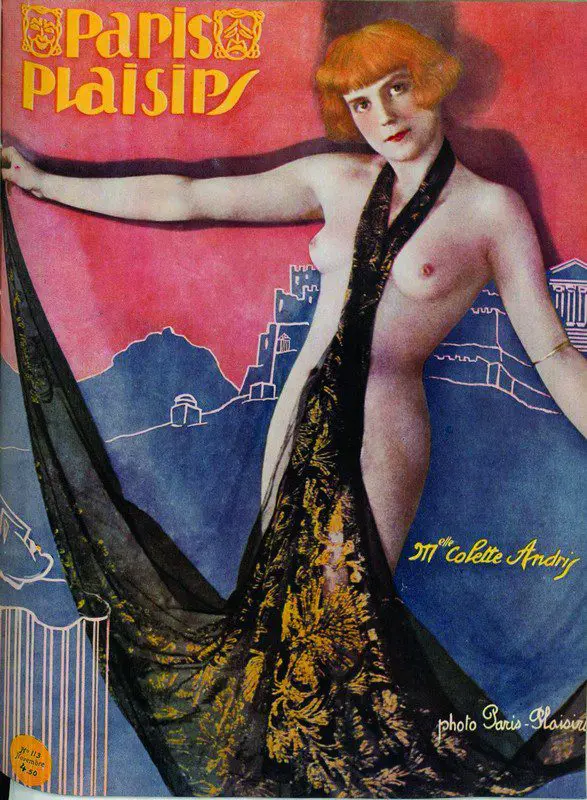Raconte-moi, Jean-François Lisée
Le saut en politique de Jean-François Lisée, chef du Parti québécois de 2016 à 2018, s’est plus ou moins terminé en cul-de-sac. Mais l’homme a plus d’un tour dans celui-ci. C’est ainsi que cette fatalité… Raconte-moi, Jean-François Lisée