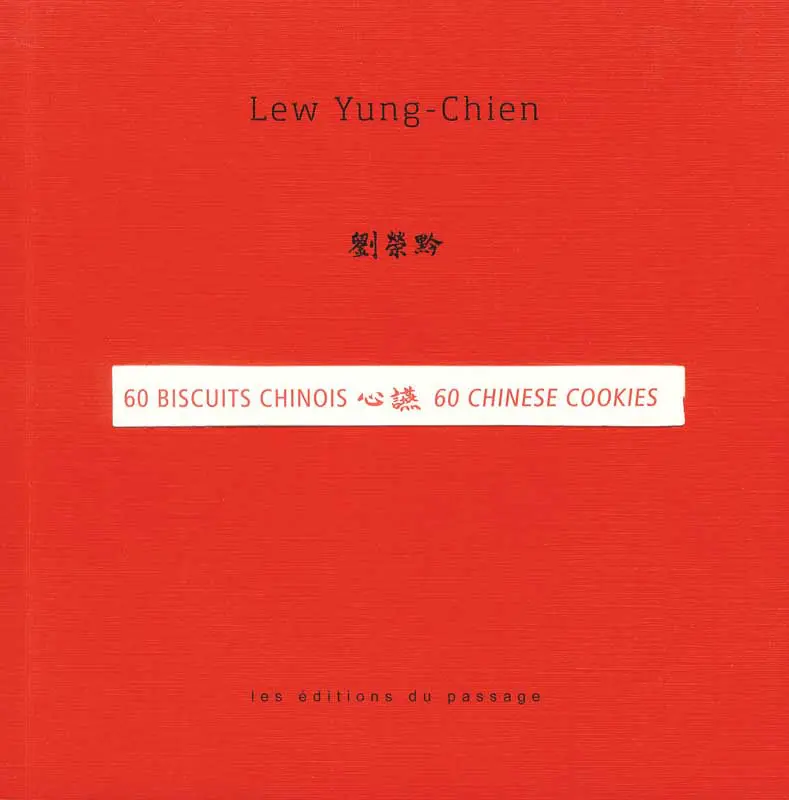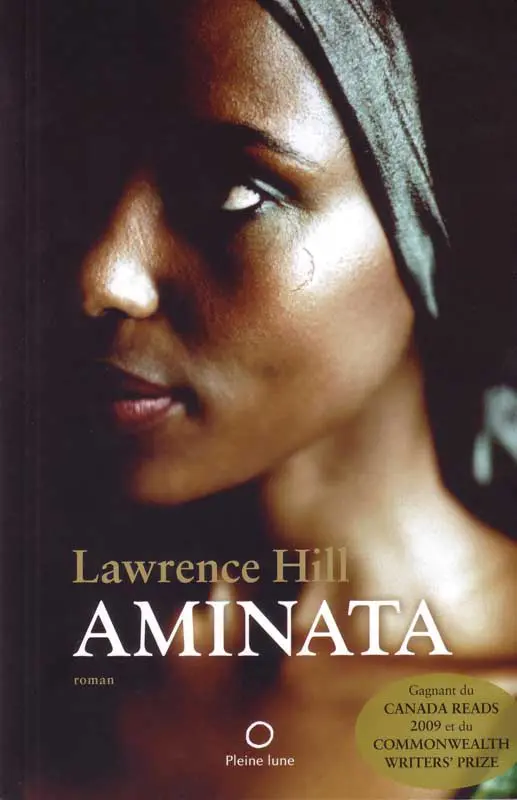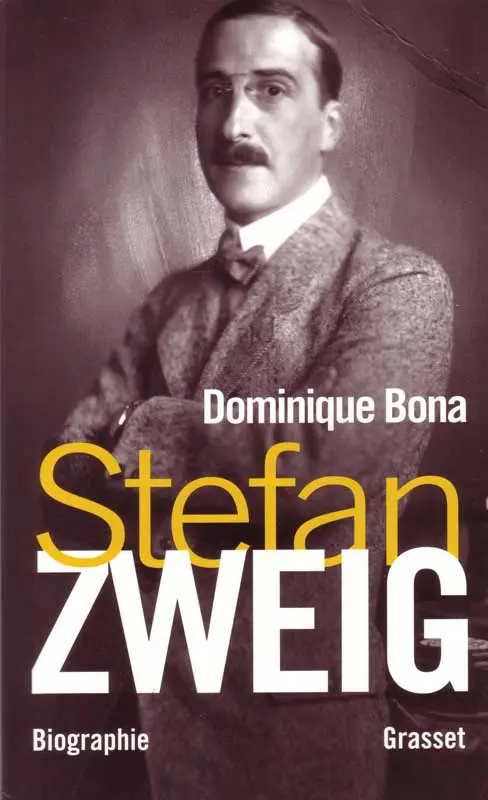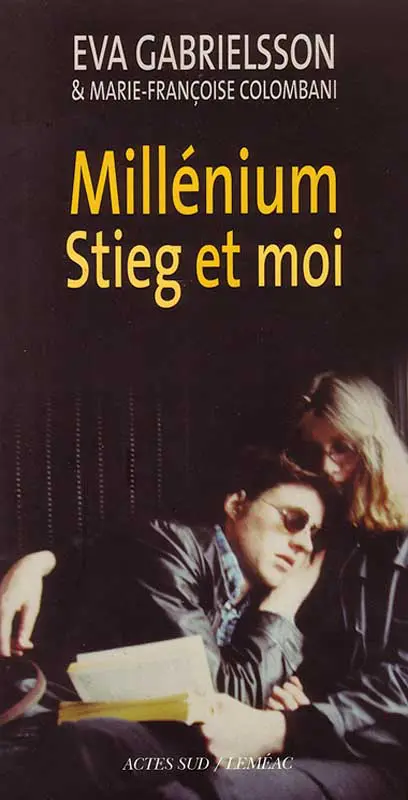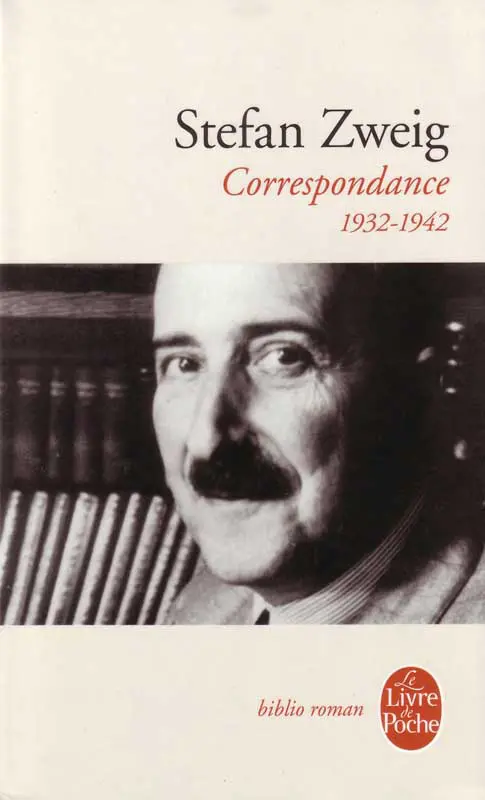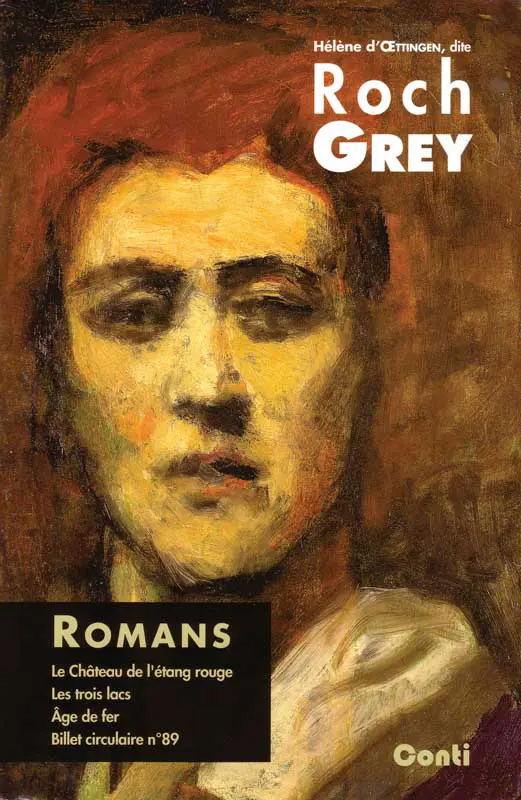Mon cœur et Douglas Adams à San Francisco
« – Une vie nouvelle s’étend devant vous. – Oh non. Pas une autre. » Douglas Adams Je suis intransigeante. Il y a des livres que je refuse tout bonnement d’ouvrir. Les livres religieux, par exemple. Il… Mon cœur et Douglas Adams à San Francisco