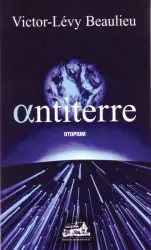Antiterre, tel est le titre du remarquable nouveau roman de Victor-Lévy Beaulieu. Avec Bibi, publié en 2009, Antiterre forme un diptyque qui vient clore, apparemment, les aventures d’Abel Beauchemin inaugurées il y a une quarantaine d’années avec Race de monde !
Il y a deux grandes périodes romanesques chez Beaulieu. La première va de Don Quichotte de la démanche (1974) aux trois volumes de Monsieur Melville (1978) en passant par N’évoque plus que le désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre Abel (1976). La seconde a été entamée par le monumental James Joyce, l’Irlande, le Québec, les mots, en 2006 (ouvrage qui est autant, sinon davantage, un roman qu’un essai et le chef-d’œuvre absolu de la littérature québécoise, rien de moins), et aboutit aujourd’hui à Antiterre1.
Tout n’est pourtant pas parfait dans Antiterre. Il y a une certaine lourdeur, surtout dans le premier quart, où le romancier s’efforce de mettre en place les éléments de son univers romanesque, quitte à laisser des zones d’ombre que la suite éclairera. Puis cette écriture abondante en néologismes et en jeux de mots agace avec ses tics et ses déviations morphologiques quelque peu banales. Disons que, parfois, la leçon joycienne atteint facilement ses limites. Mais il y a aussi chez Beaulieu un réel bonheur de style, une émotion palpable et une densité d’écriture qui font sa grandeur, et notamment d’Antiterre un roman capital dans l’ensemble de l’œuvre.
Beaulieu a accolé au roman le générique : « utopium ». Tout un programme, qui donne une idée de la galère dans laquelle Abel s’embarque, et qui, depuis cette idée pythagoricienne de l’antiterre jusqu’à la théorie des supercordes, encombre peut-être Antiterre. Du reste, l’intérêt du roman n’est pas dans la théorie utopiste, mais dans l’effet de celle-ci sur Abel et le repositionnement du romancier par rapport au nationalisme québécois.
Victime d’un « syndrome post-poliomyélite » à la fin de son aventure africaine (racontée dans Bibi), Abel émerge du coma dans les premières pages d’Antiterre, puis retrouve sa maison de Trois-Pistoles. Que fait-il de ses jours ? Peu de choses. Les jours d’Abel coulent dans une solitude ardemment défendue, où la compagnie des bêtes est préférable à celle que procure une société abrutie par « la mondialisation économique des esprits et des corps ». La campagne électorale dans laquelle il se laisse entraîner lui fait perdre ses dernières illusions : il se heurte aussi bien au cynisme et à la corruption des politiciens qu’à « l’indigence d’esprit » des citoyens, à cette « veulerie citoyenne qui ne revendique que la sécurité corporatiste dont la santé est à tout prix le fondement ». Il y a dans Antiterre une charge contre le capitalisme et le « Dieu-Économie » qui n’est pas nouvelle ; à cet égard le discours d’Abel rappelle celui de Manu Morency dans Bouscotte, mais avec une conscience écologique et planétaire en plus. À la fin d’Antiterre, grâce à un héritage faramineux et inspiré par le traité d’architecture de Claude Nicolas Ledoux (architecte néoclassique et promoteur d’une utopie sociale), Abel choisit de racheter les terres de l’arrière-pays, d’y installer sa maison et projette d’y faire construire un village d’une centaine d’habitations, sorte de Nouveau Monde autosuffisant et totalement en retrait de la société « hystérique ».
Antiterre est un ouvrage à première vue curieux et inattendu, comme a pu l’être La grande tribu il y a trois ans. Mais ces deux livres, qui paradoxalement se font écho et se tournent le dos, sont marqués par une seule logique, celle de la faillite du discours national et du pays. Si toute l’œuvre de Beaulieu est portée par une volonté nationaliste, par un désir d’accompagner la fondation du pays québécois, il est tout aussi vrai, inversement, que l’écriture de cette œuvre a été déterminée par le contexte nationaliste qui prend forme à la fin des années 1960. Autrement dit, le pays à venir fait écrire sur le pays à venir. Et dans cette symbiose entre l’œuvre et le pays, l’écriture témoigne du pays, comme celui-ci, en retour, vient justifier la grandeur du projet littéraire. L’écriture d’Antiterre, qui inscrit la fin d’un long cycle romanesque, est profondément marquée par cette dichotomie. Car à partir du moment où il n’y a plus de pays en vue, où l’idée du pays semble s’effondrer lamentablement, les élites politiques autant que la population ne sachant plus comment régénérer le discours national, il ne saurait y avoir encore, chez Beaulieu, de l’écriture. C’est ce double décès – pays et écriture – qu’enregistre Abel, alter ego du romancier, et que sanctionne Antiterre, ultime roman d’un personnage vieillissant qui dorénavant ne saurait plus écrire, qui s’étonne d’abord de ne plus trouver une seule ligne à écrire, puis pour qui la question de l’écriture se trouve réglée quand il fait le choix de s’exiler dans un espace-temps qui se situe à l’extérieur des frontières nationales. En d’autres termes, dans cet espace utopique qu’il colonise non sans une certaine jouissance, Abel ne consent pas moins à la mort. L’utopie d’Antiterre n’est rien d’autre qu’une forme de suicide.
Si le roman est extrêmement émouvant, s’il est riche de tout ce poids de vie qui fait si souvent défaut à la jeune littérature nombriliste qui nous accable depuis plusieurs années, c’est avant tout peut-être parce qu’il témoigne avec force d’un désenchantement profond, où l’utopie n’est que le revers de la perte de foi dans le pays québécois ; l’utopie naît non seulement à l’encontre d’un modèle social régi par cet abominable règne économique qui réduit de plus en plus la part d’humanité de l’univers, mais surtout à l’encontre d’un Québec « hystérique » qui n’a jamais cessé de se nier lui-même et qui paraît aliéné à demeure. Antiterre est finalement une réponse fictionnelle, qui se veut définitive, à la sortie médiatisée de l’écrivain en 2008, au moment de la publication de La grande tribu. « S’il fallait que j’en vienne à la conclusion que je me suis véritablement trompé, qu’il nous est impossible de sortir de notre schizophrénie, je ferai symboliquement ce que je vais faire aujourd’hui : brûler dans mon poêle à bois non seulement La grande tribu, mais tous les livres que j’ai écrits. Je ne veux pas me survivre juste pour moi-même. Sans véritable patrie, sans liberté, sans souveraineté et sans indépendance, l’individu n’est qu’une statistique, et les statistiques ne sont que les débris que laisse derrière elle l’histoire des autres. Ça ne m’intéresse pas, mais pas pantoute, de devenir un débris de l’histoire des autres. Si les livres que j’ai écrits dans ma vie n’ont rien voulu dire pour mon pays, parce que ça n’a pas changé grand-chose, j’aime autant qu’ils disparaissent comme moi je vais disparaître2. » Disparaître. Abel, qui se laisse avaler par le royaume utopique, dans le « frette » de la lumière noire, complète « symboliquement » le geste de l’écrivain brûlant ses livres, jetant au feu son écriture.
Un roman désespéré, Antiterre ? Sans doute, comme peut l’être toute forme d’utopie, et parce que les grandes sommes romanesques ne font jamais bon ménage avec les bons sentiments, comme on le sait. Du point de vue de Beaulieu, un roman désespéré pour un Québec désespérant.
1. Victor-Lévy Beaulieu, Antiterre, Trois-Pistoles, Trois-Pistoles, 2011, 408 p. ; 29,95 $.
2. Beaulieu cité par Chantal Guy, « L’ultimatum de VLB », La Presse, Cahier « Lectures », 2 mars 2008, p. 8.
EXRAITS D’Antiterre
Attention : VLB n’emploie pas de majuscules et fait un usage assez particulier des tirets. Et je crois que des extraits relativement longs sont nécessaires pour bien faire voir le style.
actif, véritablement actif je l’ai été, mais je n’éprouve plus aucun besoin de l’être, je suis un mort aux yeux éveillés, mon cœur s’est arrêté de battre, de combattre, je suis lourd, mais c’est sans bonheur : ni désirs, ni illusions, ni jouissances : l’oubli, l’anéantissement, la fugacité, la frugalité ! — et surtout rien de ces moments de connaissance un peu prolongés voyageant par trou de vert-de-grisé — un trou noir plutôt, solitaire en bordure cosmique ! —
p. 213
ouvrant la porte, puis sortant — la compassion, le mot d’entre tous les mots que je déteste le plus ! — l’esti de compassion ! — depuis qu’ils ne gouvernent plus rien, les politiciens ne font que compatir ! — depuis que le capitalisme a converti l’homme en cette marchandise dont on peut se débarrasser sans honte ni culpabilité, les hommes d’affaires, tous des clones à l’uranium enrichi, ne font que compatir ! — compatir ! — un mot inventé par l’église judéo-chrétienne ! — à partir d’un autre mot : souffrir ! — tu souffres et je compatis à ta souffrance, non par un acte qui t’en libérerait, mais par l’idée fausse que je partage avec toi ta souffrance ! — je suis compatissant, ce qui revient à dire que je souhaite que tu te résignes au moins de ce que tu es, que je souhaite te voir accepter volontairement les maux que je t’ai infligés et dont je fais semblant de me repentir ! — pâtir, compatir, la bonne conscience de l’hypocrisie ! —
p. 229