Mark Twain a écrit qu’un mensonge avait le temps de faire le tour du monde pendant que la vérité laçait ses chaussures. C’était bien avant l’avènement des médias sociaux, qui ont déclenché depuis l’équivalent d’un saut quantique dans l’histoire des technologies de communication, mais aussi dans la prolifération de l’information, fausse comme avérée. Certains parlent à ce propos d’« infobésité ».
En réalité, la citation de Twain ne vient pas vraiment de lui. Apocryphe, elle est un moyen parmi d’autres de détourner la vérité, de nos jours. Quoiqu’une fausse citation puisse témoigner d’une vraie vérité. Qu’à cela ne tienne. Twain, le vrai de vrai cette fois, disait réellement du mensonge qu’il en existait trois sortes : les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. La pandémie de coronavirus nous aura d’ailleurs permis d’apprécier la validité de sa typologie. Certains déplorent, à ce propos, que le contexte ait accouché d’une non moins virulente « infodémie ».
Pour être honnête, il n’est pas sûr non plus que cette classification soit l’œuvre de l’impayable romancier. Son origine est plutôt confuse. N’empêche que ce dont elle témoigne est, pour le cas, plein d’enseignements. Les mensonges, faut-il entendre, ne sont pas tous de la même eau. La fausseté est protéiforme. De même, la sacro-sainte objectivité des faits prêchée en chœur par les universitaires et les journalistes serait, à en croire Anne-Cécile Robert, le résultat d’un enfumage concerté : « L’idée selon laquelle les faits ne trompent pas est un mythe », déclare-t-elle sans plus de détour dans ses Dernières nouvelles du mensonge1.
Entre les rivages du vrai et les écueils du faux, nous naviguons à vue, portés par une déferlante d’informations. Comment alors s’y retrouver ? Et la question qui tue (mais pas pour vrai) : est-ce seulement possible de s’y retrouver ?
Quelle vérité ? Quel mensonge ?
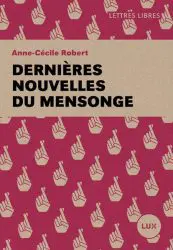 Les faits nus, porteurs d’une vérité immanente, n’existent pas, soutient l’autrice de La stratégie de l’émotion. Qui plus est, la vérité n’a rien à voir avec cette représentation, aussi simpliste qu’idéalisée, d’une « sorte de trésor caché qu’on ne pourrait découvrir qu’au terme d’une longue expédition avec carte et boussole ». Elle émane plutôt d’une construction sociale, intersubjective, faite d’avancées et de reculs, de recalculs et de dissensus, de mesures et d’ajustements établis sur la base d’autres faits et connaissances.
Les faits nus, porteurs d’une vérité immanente, n’existent pas, soutient l’autrice de La stratégie de l’émotion. Qui plus est, la vérité n’a rien à voir avec cette représentation, aussi simpliste qu’idéalisée, d’une « sorte de trésor caché qu’on ne pourrait découvrir qu’au terme d’une longue expédition avec carte et boussole ». Elle émane plutôt d’une construction sociale, intersubjective, faite d’avancées et de reculs, de recalculs et de dissensus, de mesures et d’ajustements établis sur la base d’autres faits et connaissances.
Voilà pourquoi la journaliste au prestigieux Monde diplomatique dénonce également les prétentions scientistes sur lesquelles s’est érigé le mythe de l’objectivité. Selon elle, l’objectivité a perdu de son lustre pour avoir trop souvent paré en vérité inébranlable des jugements de valeur partisans. Une fois admis, ce paradoxe digne de Socrate est peut-être l’unique vérité qui tienne : la seule vérité, c’est qu’il n’y a pas de vérité.
Contre l’absoluité, Robert fait donc jouer le relativisme, un relativisme qui trouve aujourd’hui son terme perverti – le relativisme absolu – dans le règne de l’hypervérité, c’est-à-dire dans le triomphe de l’opinion personnelle, au détriment d’une mise en perspective raisonnée des événements. Chacun a désormais droit à « sa » vérité, conséquence de la place inédite que tiennent l’ego et l’individu dans les sociétés néolibérales. Résultat, également, d’un scepticisme généralisé à l’encontre du pouvoir et des sources d’information officielles.
Il faut dire que le mensonge d’État ne date pas d’hier et que cela n’a rien pour racheter la faveur citoyenne. Toute vérité est-elle pour autant bonne à dire ? Tout mensonge est-il nécessairement mauvais ? Références philosophiques à l’appui, Anne-Cécile Robert pose la question du vrai et du faux en termes éthiques. On connaît les faits alternatifs trompettés par Trump tout au long de son mandat ; on sait les pirouettes maladroites d’un Macron contraint de nier les liens commerciaux entre la France et l’Arabie saoudite. Mais le « mensonge vertueux », la « bienveillante » dissimulation étaient reconnus dès Sun Tzu, l’auteur de L’art de la guerre. Machiavel en saluait l’utilité, quand c’était pour le bien de la cité. Benjamin Constant allait encore plus loin en admettant qu’appliquée à la lettre, l’idée d’un devoir de vérité rendrait toute société impossible.
Cet irénisme facile, de bon aloi, qui sanctionne l’usage du faux et les bienfaits de l’enfarinage, on le reconnaît dans la novlangue de bois politicienne, dans les formules creuses de discours qui tournent à vide. Le mensonge, dans ce cas, résiderait dans les espaces blancs, dans ce qui est volontairement tu. Parfois même, mensonge et vérité cohabitent dans un même énoncé. Ainsi, durant un conflit, la gravité d’une situation dépeinte changera selon que l’on parle d’un bombardement ou d’une simple frappe, sans pourtant que cela altère l’essence du message. Autant de libertés prises par rapport à la vérité auraient engendré des « sociétés sophistiques », d’après l’expression d’Anne-Cécile Robert.
Parlant de sophistique, Robert ne l’évite pas toujours. En France, par exemple, des voix se sont élevées au cours des dernières années dans le but de rayer les références à Jean-Baptiste Colbert de la toponymie ou des espaces publics. L’homme, pour mémoire, a offert avec le Code noir (1685) un cadre législatif à l’esclavage. L’éminente spécialiste de l’Afrique, cependant, retient deux importants biais qui teintent cette position. L’anachronisme, d’abord : à l’époque, toutes les grandes puissances pratiquaient l’esclavage, car les normes morales n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. La hiérarchie des faits, ensuite : Colbert a fait avancer plusieurs dossiers d’envergure – protection des forêts, fondation de l’Académie des sciences – et serait en cela « un très grand serviteur de l’État ».
En prenant position sur ces faits historiques, Robert rappelle que la vérité est un caméléon à la queue glissante. Sa lecture s’appuie en effet sur un paralogisme, celui de l’appel à la majorité : toutes les puissances mondiales pratiquent l’esclavage, donc cela ne doit forcément pas être si amoral. Elle fait peu de cas, l’habitude est tenace, de la position des personnes réduites en esclavage dans cet examen de la moralité. Quant au biais inhérent à la hiérarchie des faits, il est volontiers réversible. Que vaut l’esclavage de quelques centaines de milliers de personnes contre un sanctuaire dédié à l’Esprit scientifique ? Que pèse l’œuvre insignifiante de la vérole en Amérique devant la découverte de la cochenille et du chocolat ? Pangloss lui-même n’a pas fait mieux.
À ce compte, la vérité est bel et bien comme la moralité. Ce sont les voix les plus portantes qui l’établissent. « La vérité est, à tous moments, rappelle Robert avec les mots de Brice Couturier, ce que décide le plus fort, parce que la représentation du réel imposée est celle qui sert le mieux ses intérêts ». L’histoire de la propagande est d’ailleurs là pour le rappeler.
« L’organe exécutif du pouvoir invisible2 »
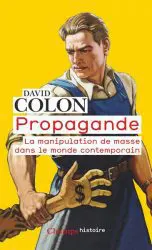 Sous sa forme sociale, la propagande, affirme David Colon dans la réédition de son époustouflante synthèse historique sur le sujet, est guidée par cette idée qui rappelle le principe gramscien d’hégémonie culturelle. Cela revient à dire que, diffusés par un groupe qui détient le pouvoir, des idéologies, des systèmes de valeurs, une vision du monde filtrent à travers l’économie, la culture, les représentations sociales d’une époque, avec pour finalité de maintenir intacte la position de cette même classe dominante.
Sous sa forme sociale, la propagande, affirme David Colon dans la réédition de son époustouflante synthèse historique sur le sujet, est guidée par cette idée qui rappelle le principe gramscien d’hégémonie culturelle. Cela revient à dire que, diffusés par un groupe qui détient le pouvoir, des idéologies, des systèmes de valeurs, une vision du monde filtrent à travers l’économie, la culture, les représentations sociales d’une époque, avec pour finalité de maintenir intacte la position de cette même classe dominante.
La propagande est aussi politique, selon la distinction adoptée par le professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, à la suite de Jacques Ellul. Elle sert également, dans ce second cas, à infléchir le comportement de personnes en faveur d’une organisation, en usant d’informations bien souvent partiales. En suivant cette conception extensive, Colon oriente sa lecture historique autant sur des événements politiques plus anciens – la commission Creel, acte de naissance de la propagande moderne – qu’en fonction des nouvelles techniques d’influence nées des avancées technologiques récentes – l’astroturfing, le trollisme ou le data smog.
Traditionnellement, ces deux types de propagande traduisent, tel que le mentionne plus haut Couturier, la vérité du plus fort. Il faudrait toutefois se garder, selon les avertissements d’un Noam Chomsky, par exemple, d’associer trop rapidement ce pouvoir à quelque régime autoritaire que ce soit. Dans une formule qui a fait date, celui-ci écrivait que la propagande est aux démocraties ce que la matraque est aux régimes totalitaires3. Qu’elle s’invite dans les médias de masse ou sous-tende une stratégie marketing, la propagande, retient-on de cette lecture, repose donc essentiellement sur la volonté des élites, politiques comme économiques, d’imposer en douce des idées et des comportements à la population, plutôt que d’avoir à conjuguer avec l’opinion de cette même population, comme le voudraient les principes élémentaires de la démocratie.
C’est que la propagande est une forme particulièrement efficace de soft power. Au tournant du XXe siècle en effet, de plus en plus de gens s’instruisent et l’élargissement progressif du suffrage laisse planer une certaine crainte au-dessus des têtes dirigeantes, celle d’une possible perte de pouvoir aux mains des masses. En réaction à cet éveil, de tout nouveaux spin doctors tels qu’Edward Bernays et Walter Lippmann créent un « gouvernement invisible » inédit en mettant bientôt la main basse sur l’opinion publique afin de la modeler pour en tirer profit4. Des four minute men au sondage, du storytelling en passant par le nudge, les techniques d’influence n’ont eu de cesse depuis de s’affiner, profitant des développements de la psychologie sociale, de la psychologie cognitive et de la rhétorique, mais aussi des moyens de communication (presse, radio, télévision, Internet). C’est à cette évolution que s’attache Colon avec doigté, maîtrisant une immense quantité d’informations qu’il surplombe avec aise et dont il rend compte avec une clarté exemplaire.
Le point de chute de cette histoire nous entraîne tout naturellement au seuil de l’ère numérique, qui a radicalement changé la donne en matière de propagande. Depuis l’avènement du 2.0, l’homme devient un média pour l’homme, avec les conséquences que l’on sait sur la rigueur de l’information transmise. Surtout, alors que, dans sa version première, la propagande était un facteur de cohésion sociale, jamais elle n’a autant divisé que depuis que la toile l’a démocratisée. Désormais, plaide Colon en conclusion, nous assistons avec les médias sociaux à la fabrique du dissentiment et de la division. Sur le web prolifèrent d’ailleurs, les frasques récentes de QAnon en témoignent, les théories complotistes les plus saugrenues, qui prennent l’information officielle à rebrousse-poil afin d’en proposer une version alternative.
Histoires de complots5
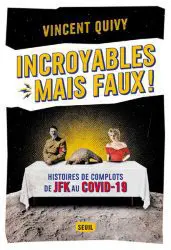 Avis aux âmes crédules. Adolf Hitler ne s’est jamais suicidé par un jour souriant d’avril 1945, pelotonné au creux de son bunker. Après avoir constaté sa défaite, il a plutôt filé vers le Brésil avec le concours du Vatican, où il s’est converti en paysan et rebaptisé Adolf Leipzig. Et tandis qu’on est dans les secrets, rapprochez-vous et tendez bien l’œil. Plus près. Encore plus près. Voilà. Personne, chers amis, n’a réellement marché sur la Lune ; les images qui laissent entendre le contraire sont ni plus ni moins que le fruit d’une mise en scène. L’accident d’auto qui a coûté la vie à Albert Camus, dites-vous ? C’est le KGB, sans aucun doute ! Et pour cause. Le journaliste avait publiquement dénoncé les grenouillages de Dmitri Chepilov, le ministre des Affaires étrangères soviétique. En pleine guerre froide, c’est le genre d’impair qui ne pardonne pas.
Avis aux âmes crédules. Adolf Hitler ne s’est jamais suicidé par un jour souriant d’avril 1945, pelotonné au creux de son bunker. Après avoir constaté sa défaite, il a plutôt filé vers le Brésil avec le concours du Vatican, où il s’est converti en paysan et rebaptisé Adolf Leipzig. Et tandis qu’on est dans les secrets, rapprochez-vous et tendez bien l’œil. Plus près. Encore plus près. Voilà. Personne, chers amis, n’a réellement marché sur la Lune ; les images qui laissent entendre le contraire sont ni plus ni moins que le fruit d’une mise en scène. L’accident d’auto qui a coûté la vie à Albert Camus, dites-vous ? C’est le KGB, sans aucun doute ! Et pour cause. Le journaliste avait publiquement dénoncé les grenouillages de Dmitri Chepilov, le ministre des Affaires étrangères soviétique. En pleine guerre froide, c’est le genre d’impair qui ne pardonne pas.
Comme les fake news, le complotisme, dont relève chacun des énoncés qui précèdent, fait son nid dans le creux de légitimité qui afflige les institutions démocratiques et les grands médias d’information : « Le ‘bon sens populaire’ contre les médias aux ordres de l’État, tel est le théorème de base de toute démonstration complotiste. Le gouvernement nous manipule et la presse nous ment », tel est le postulat de base de la plupart des théories du complot, explique Vincent Quivy, l’auteur d’un ouvrage ludique sur la question.
Incroyables mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19, publié aux éditions du Seuil, propose une collection de récits complotistes qui ont marqué la deuxième moitié du XXe siècle. La fausse vraie mort d’Elvis, la fausse fausse mort de Paul McCartney, les extraterrestres de Roswell, la Zone 51, les reptiliens, l’origine étatique du sida et des chemtrails ne sont que quelques exemples passés en revue par le journaliste.
Sous son approche anthologique percent ici et là des pistes d’interprétation de ce phénomène dont l’ampleur est aujourd’hui inédite. Ainsi, apprend-on, plusieurs complots sont le fruit d’une insatisfaction face à un phénomène demeuré inexpliqué. L’esprit humain s’accommode mal de l’absence de réponses ; en réaction, il se crée des explications pour combler l’angoisse ressentie devant le vide, l’avenir, le « progrès » ou les abstraits arcanes du pouvoir, par exemple. Pour David Colon, ces histoires à dormir debout représentent le legs postmoderne de ces métarécits dont Jean-François Lyotard a décrété la fin dans La condition postmoderne.
Aussi, les théories du complot apparaissent régulièrement pendant des périodes de transition historique, de conflits ou d’inquiétudes. Règle générale, leurs auteurs n’inventent pas complètement les faits, mais les agencent pour offrir une explication unique à des phénomènes complexes. S’appuyant sur les idées de la sociologue Marina Maestrutti, Quivy évoque à ce propos les biais de conjonction et d’intentionnalité, qui incitent respectivement à amalgamer des faits qui n’ont aucun lien causal et à privilégier des explications liées à la volonté humaine.
Plusieurs théories du complot employant une structure similaire sont d’ailleurs là pour le rappeler : le nouvel ordre mondial, les Illuminati, le complot maçonnique, plus tard judéo-maçonnique, le deep state, etc., usent d’un même schème explicatif dans lequel un pouvoir humain, secret de surcroît, se trouve à la source des pires déconvenues. La pandémie de COVID-19, encore elle, aura remis cette idée à l’avant-scène.
Pour Anne-Cécile Robert, la lutte contre les fake news et le complotisme exige que la société accorde une place centrale à l’exercice de la pensée critique, qu’elle en valorise l’enseignement afin de garantir un exercice démocratique éclairé. Elle s’en remet également à Descartes et au doute méthodique : « Pour examiner la vérité, conseillait le philosophe, il est besoin, une fois dans sa vie, de mettre toute chose en doute autant qu’il se peut ». Or, c’est bien, paradoxalement, ce que fait tout bon complotiste qui se respecte devant l’information quotidienne : « Douter des informations, des médias, du gouvernement, des autorités, des élites est désormais le b.a.-ba du citoyen vigilant, le dernier réflexe salutaire du véritable démocrate », poursuit Quivy.
À la lumière de ces trois essais, il appert que la propagande politique, par son traitement cavalier des faits et le monopole du mensonge légitime auquel elle participe depuis des décennies, a peut-être ouvert la voie aux débordements contemporains des fake news et du complotisme. Quelle différence y a-t-il, sur l’échelle de la vérité, entre proclamer l’existence d’armes de destruction massive en Irak afin de motiver son invasion et décréter que la CIA a organisé les attaques du 11 septembre pour pouvoir envahir le Moyen-Orient ? Charles-Joseph de Ligne – ou était-ce Pinocchio ? – distinguait à ce propos deux sortes de sots en ce bas monde : celui qui ne doute de rien ; celui qui doute de tout. Dans les mises en garde de Robert, de Colon et de Quivy, tous les sots se retrouveront, les petits comme les grands. Ça, cela ne fait aucun doute.
1. Anne-Cécile Robert, Dernières nouvelles du mensonge, Lux, Montréal, 2021, 224 p. ; 21,95 $.
2. Edward Bernays cité par David Colon, Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain, Flammarion, Paris, 2021, 448 p. ; 22,95 $.
3. Voir Noam Chomsky et Robert W. McChesney, Propagande, médias et démocratie, Écosociété, Montréal, 2005, 216 p. ; 18 $.
4. Voir sur le sujet le plus récent ouvrage de Colon, Les maîtres de la manipulation. Un siècle de persuasion de masse, Tallandier, Paris, 2021, 352 p. ; 42,95 $.
5. Vincent Quivy, Incroyables mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19, Seuil, Paris, 2020, 343 p. ; 36,95 $.
EXTRAITS
La vérité n’est pas un absolu, mais une construction sociale, une relation entre diverses variables ; c’est-à-dire qu’elle évolue en fonction des connaissances accumulées collectivement et dans les échanges libres et raisonnés qui les mettent à l’épreuve, les vivifient et les fortifient.
Dernières nouvelles du mensonge, p. 17.
La massification des sociétés occidentales conduit les communicants à chercher à toucher les individus non pas individuellement, mais en tant qu’ils font partie d’une masse, et à toucher les foules en ce qu’elles sont composées d’individus. La propagande, en d’autres termes, tient compte de l’un des plus grands paradoxes des sociétés démocratiques modernes, à savoir la conjugaison de l’individualisme exacerbé avec le goût inconscient du conformisme.
Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain, p. 108.
À l’ère numérique, en effet, il ne s’agit plus tant de contrôler l’information que de saper chez l’ennemi la notion de vérité, et d’altérer sa vision du monde de sorte à faire plus facilement admettre son point de vue. L’une des techniques privilégiées pour ce faire est le data smog, qui consiste à saturer l’espace informationnel de faits. Car, surinformer, c’est mésinformer en privant bien souvent le public cible de la capacité même de se faire une opinion en semant le doute dans son esprit.
Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain, p. 363.
La tendance actuelle veut que toute remise en cause de « vérités officielles » soit le signe d’un réflexe citoyen. Le salut de la démocratie. Étrange salut qui passe par la défiance générale envers les institutions mais aussi et surtout envers le savoir et la connaissance. Cette défiance, elle finit par ressembler à un immense patchwork de croyances et d’ignorances, de théories absurdes et de thèses que rien, sinon la conviction, ne vient étayer.
Incroyables mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19, p. 13.
À la règle du « tout est lié » s’ajoutent celles du « rien n’arrive par hasard » et du « les choses ne semblent pas ce qu’elles semblent être » […] pour former « l’univers des complots fantasmés ».
Incroyables mais faux ! Histoires de complots de JFK au Covid-19, p. 315.











